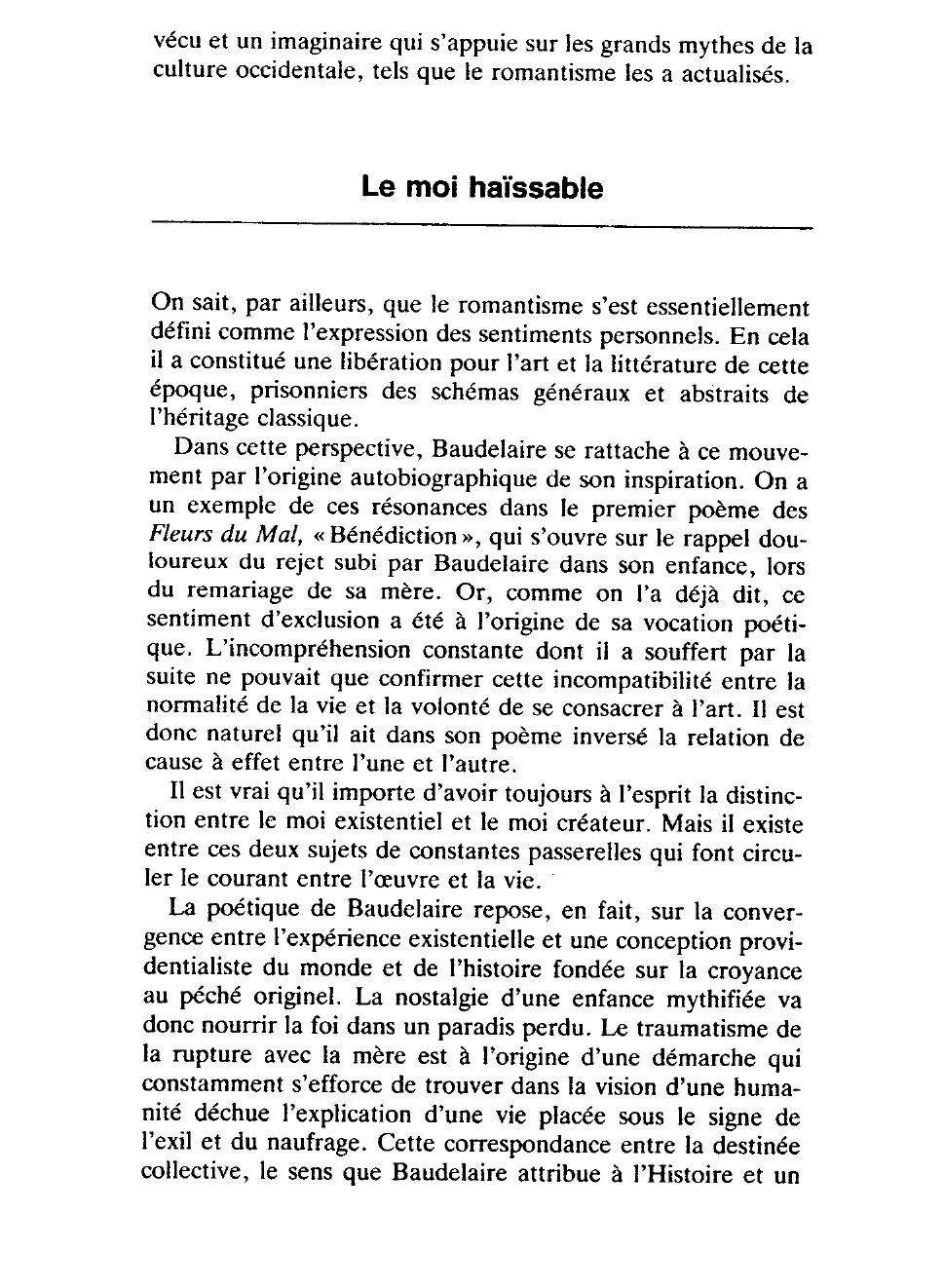La déconstruction des modèles chez Baudelaire
Publié le 07/09/2013

Extrait du document

Les thèmes qui, dans Les Fleurs du Mal, proviennent du romantisme
sont repensés et renouvelés au sein d'une évolution
créatrice qui se définit avant tout par sa singularité. Dans
cette perspective, la distinction habituelle entre la tradition et
la nouveauté se révèle peu pertinente. Dès lors on ne verra
pas d'opposition entre les différentes étapes de cette évolution,
mais l'approfondissement et l'amplification de quelques
notions fondamentales qui se définissent comme l'expression
d'une nécessité intérieure et non comme un signe d'appartenance
à une école littéraire quelconque. Cela confirme que
les grandes oeuvres sont grandes justement en cela qu'elles
sont inclassables. Le rapport de Baudelaire au romantisme
est un magnifique exemple de la force que la création poétique
puise dans la déconstruction des modèles, dans la désacralisation
des idées reçues et des formes héritées du passé.
Il en est ainsi de l'aspiration à l'idéal aussi bien que de la
purification par la souffrance ou du rôle de l'inspiration dans
la création poétique. Ces trois grands axes proviennent effectivement
du romantisme, mais ils se chargent dans la poétique
baudelairienne de significations nouvelles. On peut
même dire que la première différence entre la poétique baudelairienne
et le mythe romantique apparaît dans la transformation
objective des matériaux empruntés à l'expérience individuelle
que le poète s'emploie à couler dans des formes qui
les «transcendent«. Il y a contamination incessante entre le
vécu et un imaginaire qui s'appuie sur les grands mythes de la
culture occidentale, tels que le romantisme les a actualisés.
Le moi haïssable
On sait, par ailleurs, que le romantisme s'est essentiellement
défini comme l'expression des sentiments personnels. En cela
il a constitué une libération pour l'art et la littérature de cette
époque, prisonniers des schémas généraux et abstraits de
l'héritage classique.
Dans cette perspective, Baudelaire se rattache à ce mouvement
par l'origine autobiographique de son inspiration. On a
un exemple de ces résonances dans le premier poème des
Fleurs du Mal, «Bénédiction«, qui s'ouvre sur le rappel douloureux
du rejet subi par Baudelaire dans son enfance, lors
du remariage de sa mère. Or, comme on l'a déjà dit, ce
sentiment d'exclusion a été à l'origine de sa vocation poétique.
L'incompréhension constante dont il a souffert par la
suite ne pouvait que confirmer cette incompatibilité entre la
normalité de la vie et la volonté de se consacrer à l'art. Il est
donc naturel qu'il ait dans son poème inversé la relation de
cause à effet entre l'une et l'autre.
Il est vrai qu'il importe d'avoir toujours à l'esprit la distinction
entre le moi existentiel et le moi créateur. Mais il existe
entre ces deux sujets de constantes passerelles qui font circuler
le courant entre l'oeuvre et la vie.
La poétique de Baudelaire repose, en fait, sur la convergence
entre l'expérience existentielle et une conception providentialiste
du monde et de l'histoire fondée sur la croyance
au péché originel. La nostalgie d'une enfance mythifiée va
donc nourrir la foi dans un paradis perdu. Le traumatisme de
la rupture avec la mère est à l'origine d'une démarche qui
constamment s'efforce de trouver dans la vision d'une humanité
déchue l'explication d'une vie placée sous le signe de
l'exil et du naufrage. Cette correspondance entre la destinée
collective, le sens que Baudelaire attribue à !'Histoire et un
destin personnel constitue le fondement de sa poétique.
Grâce à cette analogie rassurante, le poète, d'une part, rattache
les méandres de sa propre histoire au cours de !'Histoire
universelle. On comprend donc qu'il ait adhéré avec enthousiasme
au système d'interprétation qu'il trouvait dans la philosophie
de Joseph de Maistre. Baudelaire donnait ainsi une
signification rationnelle à une expérience qui, sans cela, aurait
sombré dans une gratuité absurde. Cette relation sousjacente
entre l'abstrait et le concret, entre la sphère des
émotions et le monde des idées, est l'axe qui génère la réversibilité
baudelairienne, cette conversion incessante des élans
vers l'idéal en retombées du spleen et réciproquement. La
création poétique aura la tâche de régulariser, d'harmoniser
ce mouvement cyclothymique.

«
vécu et un imaginaire qui s'appuie sur les grands mythes de la
culture occidentale, tels que
le romantisme les a actualisés.
Le moi haïssable
On sait, par ailleurs, que le romantisme s'est essentiellement
défini comme l'expression des sentiments personnels.
En cela il a constitué une libération pour l'art et la littérature de cette
époque, prisonniers des schémas généraux et abstraits de
l'héritage classique.
Dans cette perspective, Baudelaire se rattache à
ce mouve
ment par l'origine autobiographique de son inspiration.
On a
un exemple de ces résonances dans le premier poème des Fleurs du Mal, «Bénédiction», qui s'ouvre sur le rappel dou
loureux du rejet subi par Baudelaire dans son enfance, lors
du remariage de sa mère.
Or, comme on l'a déjà dit, ce
sentiment d'exclusion a été à l'origine de sa vocation poéti
que.
L'incompréhension constante dont
il a souffert par la
suite ne pouvait que confirmer cette incompatibilité entre la
normalité de
la vie et la volonté de se consacrer à l'art.
Il est
donc naturel qu'il ait dans son poème inversé la relation de
cause à effet entre l'une et l'autre.
Il est vrai qu'il importe d'avoir toujours à l'esprit la distinc
tion entre le moi existentiel et
le moi créateur.
Mais il existe
entre ces deux sujets de constantes passerelles qui font circu
ler
le courant entre l'œuvre et la vie.
La poétique de Baudelaire repose, en fait, sur la conver
gence entre l'expérience existentielle et une conception provi
dentialiste du monde et de l'histoire fondée sur la croyance
au péché originel.
La nostalgie d'une enfance mythifiée va
donc nourrir la foi dans un paradis perdu.
Le traumatisme de
la rupture avec la mère est à l'origine d'une démarche qui
constamment s'efforce de trouver dans la vision d'une huma
nité déchue l'explication d'une vie placée sous
le signe de
l'exil et du naufrage.
Cette correspondance entre la destinée
collective, le sens que Baudelaire attribue
à !'Histoire et un.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Baudelaire et les femmes : Le poète et ses modèles
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- Analyse linéaire Bac Français A une passante de Baudelaire
- explication linéaire charogne baudelaire
- Baudelaire, A un passante, analyse linéaire