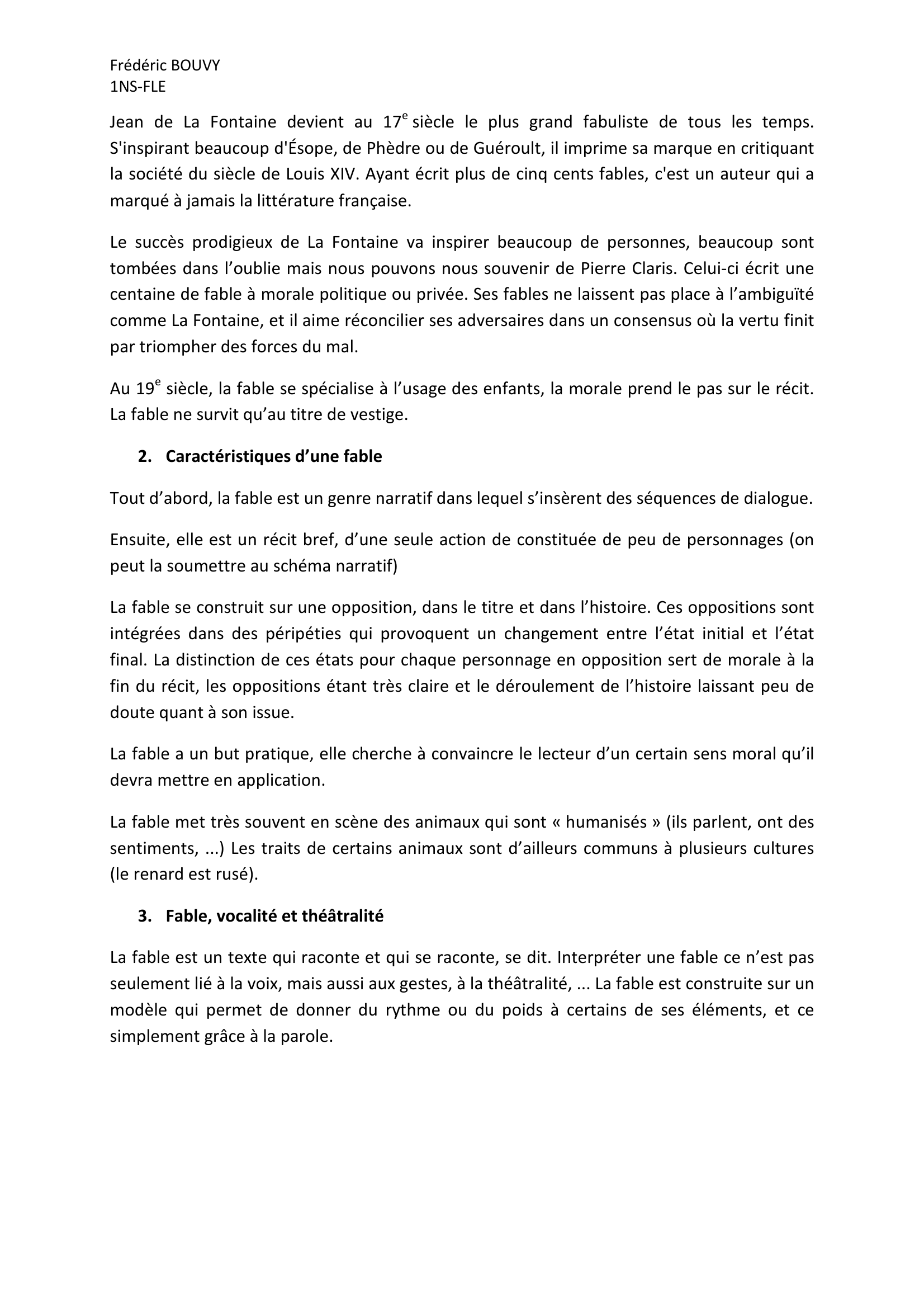La Fable (CANVAT K. & VANDENDORPE C.)
Publié le 07/04/2012

Extrait du document

Histoire de la fable
« La fable est un récit fictif qui, à l’aide de personnages de nature animale, le plus souvent, vise à dégager explicitement une leçon de type moral, ou à représenter sous la forme d’un récit allégorique une vérité proverbiale
Les témoignages les plus anciens de la fable nous viennent de Mésopotamie, près de 2000 ans avant notre ère, sur des tablettes évoquant déjà des histoires familières à base d’animaux.
La fable apparaît ensuite très tôt dans la littérature grecque (8e siècle avant J.-C.) Les récits sont construits sur des aventures d’animaux débouchant sur une morale. On peut citer parmi les auteurs célèbre de l’époque : Hésiode (Le rossignol et l’épervier).
Nul ne sait si Ésope, qui serait une personne né en -572 et qui utiliserait régulièrement la fable à son avantage, a réellement existé, mais selon la fable « La vie d’Ésope le Phrygien «, celui-ci serait le précurseur de la fable, grâce à son utilisation des mots et des tournures de phrase qui amenaient à la réflexion. Nous savons seulement d’Ésope qu’il était originaire de Thrace.

«
Frédéric BOUVY
1NS-FLE
Jean de La Fontaine devient au 17 esiècle le plus grand fabuliste de tous les temps.
S'inspirant beaucoup d'Ésope, de Phèdre ou de Guéroult, il imprime sa marque en critiquant
la société du siècle de Louis XIV.
Ayant écrit plus de cinq cents fables, c'est un auteur qui a
marqué à jamais la littérature française.
Le succès prodigieux de La Fontaine va inspirer beaucoup de personnes, beaucoup sont
tombées dans l’oublie mais nous pouvons nous souvenir de Pierre Claris.
Celui-ci écrit une
centaine de fable à morale politique ou privée.
Ses fables ne laissent pas place à l’ambiguïté
comme La Fontaine, et il aime réconcilier ses adversaires dans un consensus où la vertu finit
par triompher des forces du mal.
Au 19 esiècle, la fable se spécialise à l’usage des enfants, la morale prend le pas sur le récit.
La fable ne survit qu’au titre de vestige.
2. Caractéristiques d’une fable
Tout d’abord, la fable est un genre narratif dans lequel s’insèrent des séquences de dialogue.
Ensuite, elle est un récit bref, d’une seule action de constituée de peu de personnages (on
peut la soumettre au schéma narratif)
La fable se construit sur une opposition, dans le titre et dans l’histoire.
Ces oppositions sont
intégrées dans des péripéties qui provoquent un changement entre l’état initial et l’état
final.
La distinction de ces états pour chaque personnage en opposition sert de morale à la
fin du récit, les oppositions étant très claire et le déroulement de l’histoire laissant peu de
doute quant à son issue.
La fable a un but pratique, elle cherche à convaincre le lecteur d’un certain sens moral qu’il
devra mettre en application.
La fable met très souvent en scène des animaux qui sont « humanisés » (ils parlent, ont des
sentiments, ...) Les traits de certains animaux sont d’ailleurs communs à plusieurs cultures
(le renard est rusé).
3. Fable, vocalité et théâtralité
La fable est un texte qui raconte et qui se raconte, se dit.
Interpréter une fable ce n’est pas
seulement lié à la voix, mais aussi aux gestes, à la théâtralité, ...
La fable est construite sur un
modèle qui permet de donner du rythme ou du poids à certains de ses éléments, et ce
simplement grâce à la parole..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- fiche de révision:: style, fable, vers, hiatus
- FABLE DE L’HOMME CONFIANT (résumé)
- Elements contre Fable
- Le Paysan de Paris d'Aragon: une fable surréaliste (résumé & analyse)
- HISTOIRE ET LA FABLE (L’)