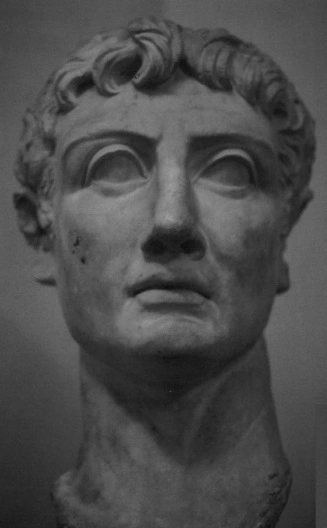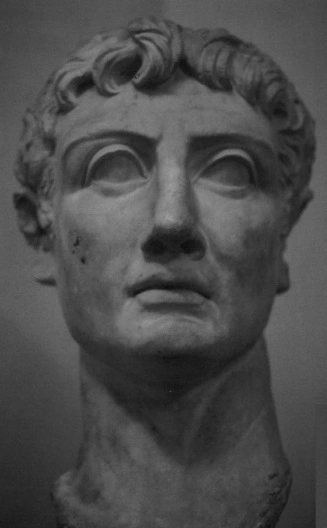LA FARE Charles Auguste, marquis de (1644-1712). «Je sais, sans me flatter d’une vaine apparence,/Que c’est à mes défauts que je dois mes vertus », dit La Fare de lui-même dans une « Ode à la vérité ». L’orgueilleuse modestie de ces vers peint parfaitement un homme qui échappa à toutes les gloires par une sorte d'inadvertance. Saint-Simon dit de lui : « Tout le monde l’aimait », mais il trouva le moyen de ruiner sa carrière en s’attirant la haine de Louvois.
Né à Valgorge, en Vivarais, issu d'une ancienne et illustre maison languedocienne, il parut à la Cour à dix-huit ans, promis au plus brillant avenir, comblé de tous les dons, ajoutant à la naissance la prestance, la valeur et un esprit poli par une éducation soignée. Il chercha la faveur sur les champs de bataille, d’abord, en 1664, avec le contingent d’aristocrates envoyé par Louis XIV à l’empereur pour combattre les Turcs et qui se fit décimer en Hongrie à la bataille de Raab. Puis, de 1671 à 1674, il se distingua dans la guerre contre la Hollande, avec
Condé à Senef, avec Turenne en Alsace. En vain. On retenait ses affaires de duel, on oubliait ses mérites.
Destitué des jouissances de l'ambition, il lui restait les plaisirs du corps, du cœur et de l’esprit. Avec son inséparable, l’abbé de Chaulieu, il les cultiva pendant près de quarante années. La Fare est une figure marquante de la société libertine de la fin du siècle, férue de science, de poésie et de débauche. On le trouve dans l'entourage de Mmc de La Sablière d’abord, à qui le lia une passion exemplaire; de la duchesse du Maine et des Vendôme ensuite.
Il vint tard à l’écriture. Il se dit lui-même, dans une « Ode à la Muse lyrique », « né poète à cinquante ans ». Ses poésies circulèrent longtemps en manuscrit. Les hardiesses de leur contenu et la modestie de leur auteur les vouaient à une existence clandestine. Les premières à être éditées le seront avec les œuvres de Chaulieu, en 1724 et 1731 ; il faudra attendre 1755 pour voir un recueil assez complet des poésies de La Fare paraître à Londres. Chaulieu le considère comme un « Maître libertin de la rime,/Sur qui Phébus a répandu/Le badinage et le sublime ». Il définit ainsi la double vocation de sa poésie. La Fare revendique, en effet, l’héritage de Marot, qu’il trouve moins « gothique » que Ronsard. Mais, outre des pièces légères et galantes, madrigaux, chansons, on trouve chez lui un ensemble important d'Odes, à contenu philosophique, où s’exprime un épicurisme profond qui renoue avec la doctrine authentique. Avec des accents empruntés à Lucrèce, il chante la volupté, « âme de toute la nature, reine de la terre et des cieux ». Il dénonce le scandale de l’intolérance religieuse et formule, dans une « Ode à l’honneur de la religion », une profession de foi déiste :
Heureux qui, respectant la majesté suprême. Se livrant tout entier aux mains d'un Dieu qu'il aime, Aux lois de sa raison accorde ses désirs.
Jamais dans ses besoins le ciel ne l'abandonne,
La volupté le sert, le calme l'environne,
Et toute la nature a soin de ses plaisirs.
Voltaire s’est trop hâté de trouver ses vers mauvais, peut-être pour éviter de reconnaître la dette, considérable, qu’il a envers lui. On trouve chez La Fare, remarquable précurseur des idées du xvme siècle, non seulement les thèmes voltairiens de la tolérance et du rationalisme, mais aussi les thèmes rousseauistes, plus affectifs, de la primitive bonté de l’homme et de la vanité des ambitions. Ce lyrisme philosophique, où l’on perçoit cependant le frémissement discret d’une âme sensible, a été mal reconnu. Hector Malot, au XIXe siècle, tranche avec sévérité : « Ses vers ne méritent pas d’être lus aujourd’hui ».
Il ajouta à son œuvre de nombreuses traductions en vers de poèmes d'Horace, Virgile. Lucrèce, Tibulle, Catulle, Lucain, qui ne sont pas indignes de leurs modèles, ainsi que le livret d’une tragédie lyrique, Penthée.
L'autre volet de son œuvre, les Mémoires et réflexions sur les principaux événements du règne de Louis XIV et sur le caractère de ceux qui y ont la principale part, parus à Rotterdam en 1716, quatre ans après sa mort, ont beaucoup fait pour sa réputation. C’est un contresens que d’y voir, comme certains l’ont fait, l’œuvre d’un courtisan aigri par la disgrâce. Il se flattait seulement de « penser librement et même d'oser écrire la vérité » et possédait la lucidité et la franchise d’un spectateur observant sans prévention ni indulgence la politique de son temps. A aucun moment, dans son livre, La Fare ne pratique un dénigrement systématique, et l’éloge, sous sa plume, s’il refuse l’hyperbole dans le superlatif même, n’en prend que plus de relief. Il dira par exemple de Turenne : « De tous les hommes que j’ai connus, c’est celui qui m’a paru approcher le plus de la perfection ». Les Mémoires, dans lesquels souffle constamment un esprit de liberté, expriment une extrême sévérité contre