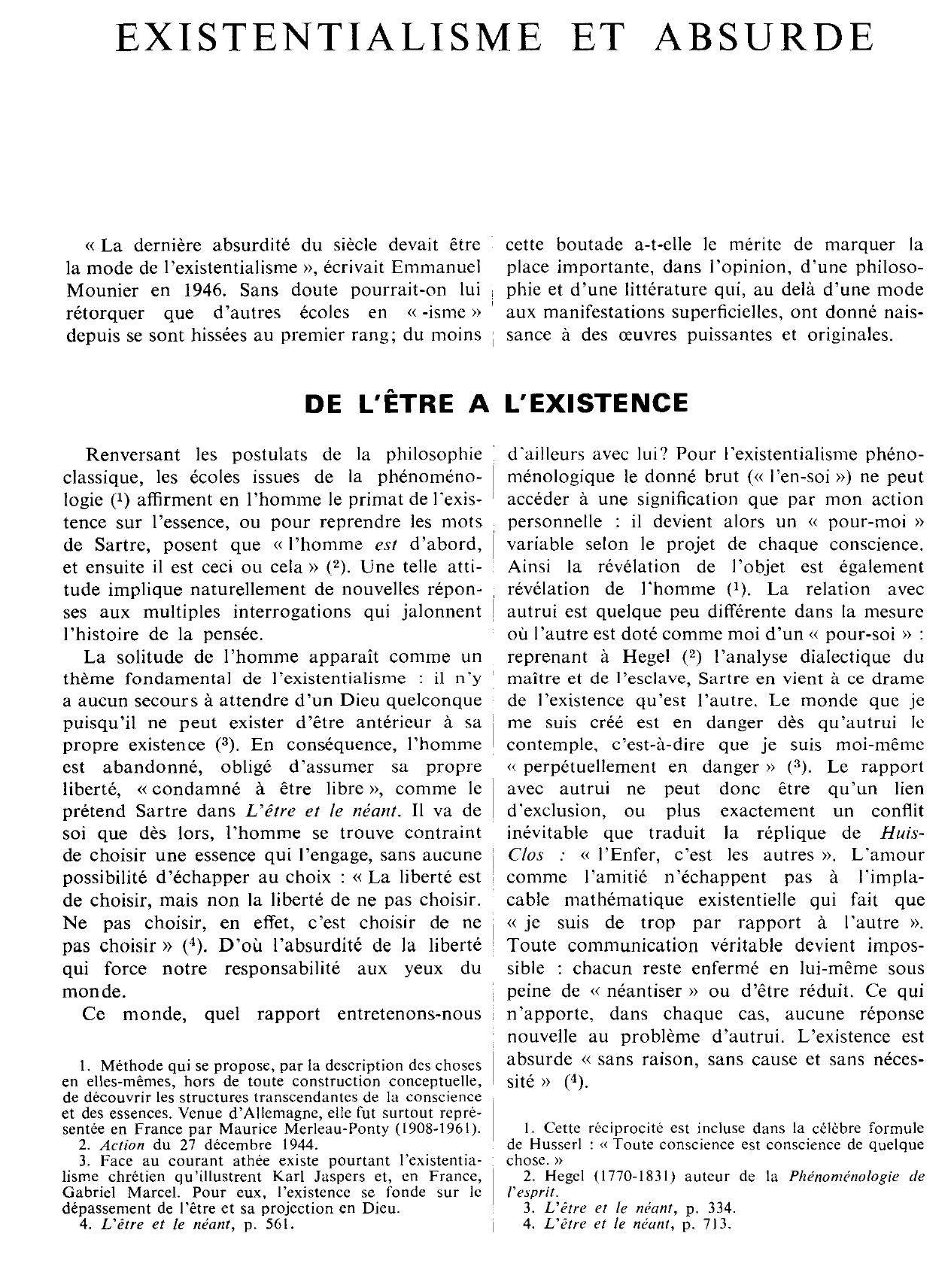LA LITTÉRATURE, LA POÉSIE ET LE THÉÂTRE APRÈS 1939 (Histoire littéraire)
Publié le 13/04/2012

Extrait du document

OEUVRES : De nombreux essais critiques des années 60 comportent une préface ou des remarques éparses sur leur méthode. Ne sont rappelés ici que quelques ouvrages qui servent à amorcer la réflexion : Roland BARTHES, Critique et vérité, Seuil, 1966 (réponse à R. Picard). - Cerisy (colloque de), Les chemin actuels de la critique, 10/18, 1968 (des dialogues éclairants). - Serge DOUBROVSKY, Pourquoi la nouvelle critique? Mercure de France, 1966 (contre 1 a déshumanisation de la critique). -Gilbert DURAND, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, Bordas; L'imagination symbolique, P. U. F., coll. SUP, 1964 (excellente initiation au renouveau de l'imaginaire : Freud, Jung, Bachelard ... ). - FAGES J.-B., Comprendre le structuralisme, Privat, 1968; Le structuralisme en procès, Privat, 1970; Comprendre Lacan, Privat, 1970 (présentation claire de domaines difficiles).- Roger FAYOLLE, La critique, A. Colin, coll. U., 1964 (excellent panorama). - Lucien GoLDMANN, Pour une sociologie du roman, Gallimard, << Idées«, 1964 (réflexion théorique, application à Malraux, à RobbeGrillet). - Charles MAURON, Des métaphores obsédantes au mythe personnel, Corti, 1964 (une préface importante sur sa méthode, comparée à celles de Sartre, Bachelard, Richard ... ).- Nouvelle Revue Française, oct. 1970 (numéro spécial sur la critique). - Raymond PICARD, Nouvelle critique ou nouvelle imposture?, Pauvert, 1965, (le brillant pamphlet qui a suscité les réponses de Barthes, Doubrovsky ... )- Vladimir PROPP, Morphologie du conte, Seuil, coll. Points, 1970 (les origines et, en annexe, l'évolution des analyses de récits); Théorie de la littérature, Seuil, 1965 (recueil de textes des formalistes russes). - Vincent THERRIEN, La révolution de Gaston
Bachelard en critique littéraire, Klincksieck, 1970 (la première grande synthèse).

«
EXISTENTIALISME ET ABSURDE
« La dernière absurdité du siècle devait être
la mode de l'existentialisme», écrivait Emmanuel
Mounier en 1946.
Sans doute pourrait-on lui
rétorquer que d'autres écoles en « -isme »
depuis se sont hissées au premier rang; du moins 1
cette boutade a-t-elle le mérite de marquer la
place
importante, dans l'opinion, d'une philoso
phie et
d'une littérature qui, au delà d'une mode
aux manifestations superficielles, ont donné nais
sance à des œuvres puissantes et originales.
DE L'ÊTRE A L'EXISTENCE
Renversant les postulats de la philosophie
classique, les écoles issues de la
phénoméno
logie (1) affirment en l'homme Je primat de l"exis
tence sur 1 'essence, ou pour reprendre les mots
de Sartre, posent que «l'homme est d'abord,
et ensuite il est ceci ou cela » (2).
Une telle atti
tude implique naturellement de nouvelles répon
ses aux multiples interrogations qui jalonnent
1 'histoire de la pensée.
La solitude de 1 'homme apparaît comme un
thème fondamental de l'existentialisme : il n'y
a aucun secours à attendre d'un Dieu quelconque
puisqu'il ne peut exister d'être antérieur à sa
propre existence ( 3).
En conséquence, l'homme
est abandonné, obligé d'assumer sa propre
liberté, «condamné à être libre », comme le
prétend Sartre dans L'être et le néant.
Il va de
soi
que dès lors, l'homme se trouve contraint
de choisir une essence qui l'engage, sans aucune
possibilité d'échapper au choix : « La liberté est
de choisir, mais non la liberté de ne pas choisir.
Ne pas choisir, en effet, c'est choisir de ne
pas choisir» (4).
D'où l'absurdité de la liberté
qui force
notre responsabilité aux yeux du
monde.
Ce monde, quel rapport entretenons-nous
1.
Méthode qui se propose, par la description des choses en elles-mêmes, hors de toute construction conceptuelle, de découvrir les structures transcendantes de la conscience et des essences.
Venue d'Allemagne, elle fut surtout repré sentée en France par Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).
2.
Action du 27 décembre 1944.
3.
Face au courant athée existe pourtant l'existentia lisme chrétien qu'illustrent Karl Jaspers et, en France, Gabriel Marcel.
Pour eux, l'existence se fonde sur le dépassement de 1 'être et sa projection en Dieu.
4.
L'être et le néant, p.
561.
d'ailleurs avec lui? Pour 1 'existentialisme phéno
ménologique le donné brut («l'en-soi») ne peut
accéder à une signification que par mon action
personnelle : il devient alors un « pour-moi »
variable selon Je projet de chaque conscience.
Ainsi
la révélation de l'objet est également
révélation de J'homme (1 ).
La relation avec
autrui est quelque peu différente dans la mesure
où 1 'autre est doté comme moi d'un « pour-soi » :
reprenant à Hegel (2) l'analyse dialectique du
maître et de 1 'esclave, Sartre en vient à ce drame
de 1 'existence qu'est 1 'autre.
Le monde que je
me suis créé est en danger dès qu'autrui le
contemple, c'est-à-dire que je suis moi-même
« perpétuellement en danger » (3).
Le rapport
avec autrui ne peut donc être qu'un lien
d'exclusion,
ou plus exactement un conflit
inévitable
que traduit la réplique de Huis
Clos :
« l'Enfer, c'est les autres».
L'amour
comme l'amitié n'échappent pas à 1 'impla
cable mathématique existentielle qui fait que
« je suis de trop par rapport à l'autre ».
Toute communication véritable devient impos
sible :
chacun reste enfermé en lui-même sous
peine de
« néantiser » ou d'être réduit.
Ce qui
n'apporte, dans chaque cas, aucune réponse
nouvelle au problème d'autrui.
L'existence est
absurde « sans raison, sans cause et sans néces
sité
» (4).
l.
Cette réciprocité est incluse dans la célèbre formule de Husserl :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Que ce soit dans le domaine du roman, de l'autobiographie, du théâtre ou de la poésie, la littérature fait souvent de larges emprunts à l'Histoire : Corneille fait revivre dans ses pièces des héros romains, Mme de La Fayette nous dépeint dans La Princesse de Clèves une fresque de la Cour d'Henri II, Ronsard, d'Aubigné, Hugo, et bien d'autres rehaussent parfois leur lyrisme de souvenirs ou de témoignages historiques ; en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures, vous
- LE THÉÂTRE DE 1919 à 1939 (Histoire littéraire)
- Que ce soit dans le domaine du roman, de l'autobiographie, du théâtre ou de la poésie, la littérature fait souvent de larges emprunts à l'Histoire : Corneille fait revivre dans ses pièces des héros romains, Mme de la Fayette nous dépeint dans « La Princesse de Clèves » une fresque de la cour d'Henri II, Ronsard, d'Aubigné, Hugo, et bien d'autres rehaussent parfois leur lyrisme de souvenirs ou de témoignages historiques; en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures, vo
- La littérature du Moyen-Orient au XXe siècle par Alan Chatham de Bolivar Le roman est un genre littéraire relativement récent dans la littérature arabe plus marquée par le conte ou la poésie, qui induisent une rupture par rapport aux formes classiques.
- « L'étude de l'histoire littéraire est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe des Oeuvres de l'esprit humain. » A cette affirmation de Renan, Lanson répond dans l'avant-propos de son Histoire de la Littérature française : « Je voudrais que cet ouvrage ne fournît pas une dispense de lire les Oeuvres originales, mais une raison de les lire, qu'il éveillât les curiosités au lieu de les éteindre. » Étudier ces deux jugements. ?