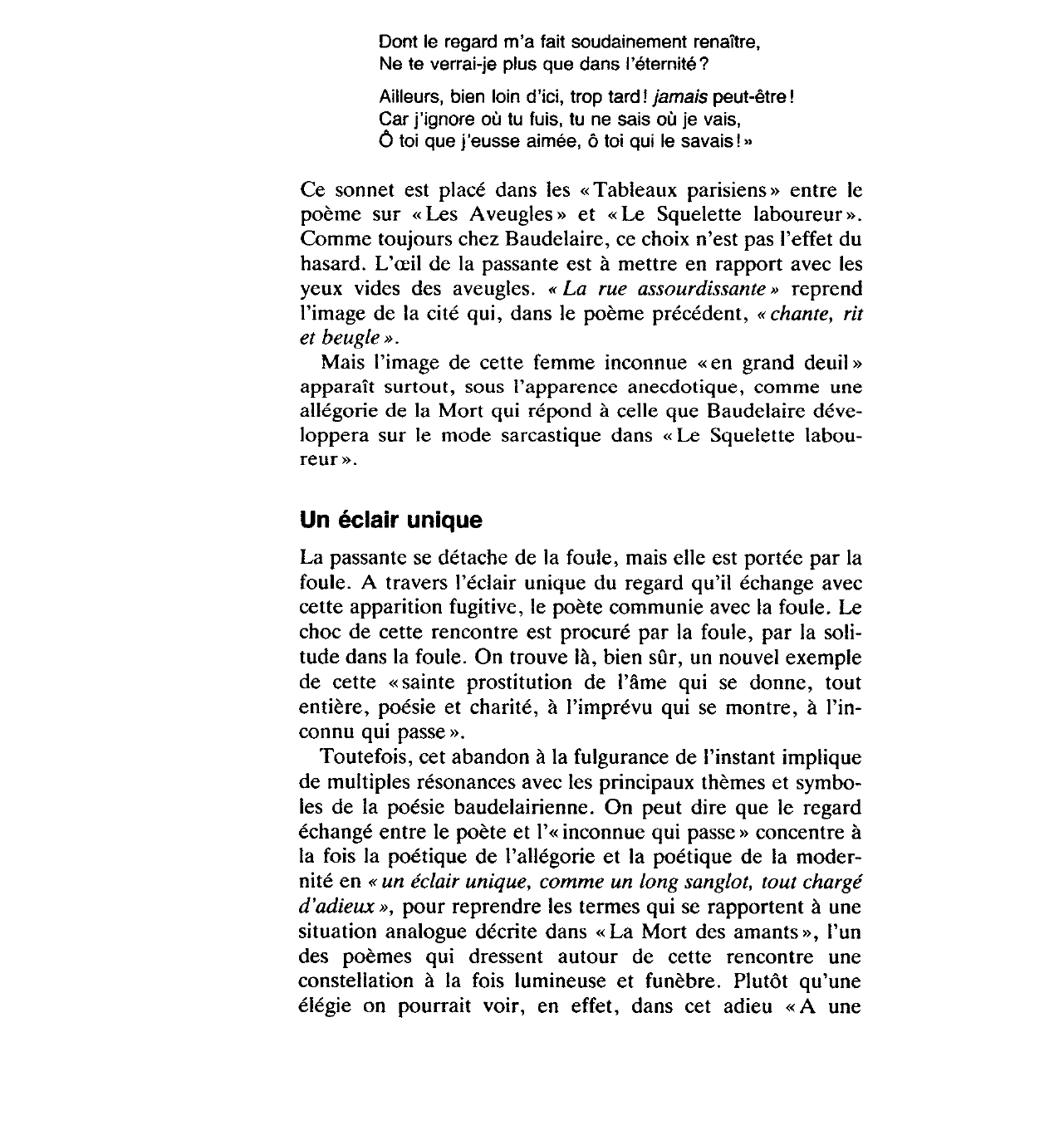La modernité comme expérience du deuil chez Baudelaire
Publié le 07/09/2013

Extrait du document

Le premier effet des miroirs est d'abolir les lointains. La
triple fusion que cette image réalise ici supprime la distance
qui séparait le poète de l'idéal mais qui en même temps
engendrait la représentation de celui-ci. Cette union des sens,
des esprits et des coeurs, qui n'est concevable que dans la
mort, ne prend son sens que par la foi dans la résurrection.
Mais l'éternité dans l'instant évoquée dans ces vers, si elle est
projetée dans l'avenir, est surtout tournée vers le passé. Le
cercle des temps se referme sur le triomphe de «l'aura«, la
splendeur retrouvée d'une antériorité étouffée sous la pesanteur
de la vie mutilée. Bien que les correspondances ne soient
pas au centre de ce poème, elles en constituent l'indispensable
arrière-plan évoqué par le «bleu mystique«. Seule la
sublimation du souvenir peut expliquer le dernier tercet.
Le ciel livide
Rien de tel dans le poème «A une passante«, beaucoup plus
tardif et qui traduit sans doute une évolution dans le sens du
désenchantement et de la lucidité. On y retrouve toutes les
composantes du sonnet précédent, mais au lieu de culminer
dans une apothéose glorieuse, elles se fondent dans un éclair
unique et sans lendemain. Le désir et le souvenir s'y rencontrent
pareillement mais pour y mourir ensemble dans un éclat
instantané qui brille au-dessus de l'abîme éternel comme un
défi aux puissances suprêmes.
Alors que les yeux des «Aveugles« sont des miroirs qui
reflètent une double absence, celle du Ciel et celle du regard
humain, l'oeil de la passante est devenu lui-même le «ciel
livide«.
Ce qui était jadis un artifice de la poésie précieuse est
devenu le moyen de la dévalorisation d'un idéal jugé illusoire.
Par ce brusque rapprochement, toute la force du désir,
toute la magie du souvenir se rabattent sur l'instant présent
dans un mouvement de concentration qui le détache de la
durée comme la passante elle-même se détache de la foule.
Cet éclair qui perce la nuit du temps, qui la départage entre
un avant et un après, prend toute la force d'un «infini diminutif
«. On assiste à un rétrécissement analogue à celui qui est
décrit dans la première strophe du «Voyage«:
"Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,
L'univers est égal à son vaste appétit,
Ah! que le monde est grand à la clarté des lampes!
Aux yeux du souvenir que le monde est petit ! "

«
Dont le regard m'a fait soudainement renaître, Ne te verrai-je plus que dans l'éternité?
Ailleurs,
bien loin d'ici, trop tard! jamais peut-être!
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais!"
Ce sonnet est placé dans les «Tableaux parisiens» entre le
poème sur «Les Aveugles» et «Le Squelette laboureur».
Comme toujours chez Baudelaire, ce choix n'est pas l'effet du
hasard.
L'œil de
la passante est à mettre en rapport avec les
yeux vides des aveugles.
«La rue assourdissante» reprend
l'image de la cité qui, dans le poème précédent,
«chante, rit
et
beugle».
Mais l'image de cette femme inconnue «en grand deuil»
apparaît surtout, sous l'apparence anecdotique, comme une
allégorie de la Mort qui répond
à celle que Baudelaire déve
loppera sur
le mode sarcastique dans «Le Squelette labou
reur».
Un éclair unique
La passante se détache de la foule, mais elle est portée par la
foule.
A travers l'éclair unique du regard qu'il échange avec
cette apparition fugitive,
le poète communie avec la foule.
Le
choc de cette rencontre est procuré par la foule, par
la soli
tude dans la foule.
On trouve là, bien sûr, un nouvel exemple
de cette
«sainte prostitution de l'âme qui se donne, tout
entière, poésie et charité, à l'imprévu qui
se montre, à l'in
connu qui
passe».
Toutefois, cet abandon à la fulgurance de l'instant implique
de multiples résonances avec les principaux thèmes et symbo
les de la poésie baudelairienne.
On peut dire que le regard
échangé entre le poète et
I' «inconnue qui passe» concentre à
la fois
la poétique de l'allégorie et la poétique de la moder
nité en
«un éclair unique, comme un long sanglot, tout chargé
d'adieux», pour reprendre les termes qui se rapportent à une
situation analogue décrite dans
«La Mort des amants», l'un
des poèmes qui dressent autour de cette rencontre une
constellation à
la fois lumineuse et funèbre.
Plutôt qu'une
élégie on pourrait voir, en effet, dans cet adieu
«A une.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le poète en chiffonnier de la modernité (Baudelaire)
- «Un long avenir se préparait pour (la culture française) du XVIIe (siècle). Même encore au temps du romantisme, les œuvres classiques continuent à bénéficier d'une audience considérable ; l'époque qui les a vu naître bénéficie au premier chef du progrès des études historiques ; l'esprit qui anime ses écrivains, curiosité pour l'homme, goût d'une beauté harmonieuse et rationnelle, continue à inspirer les créatures. Avec cette esthétique une autre ne pourra véritablement entrer en concur
- Comment Baudelaire ouvre-t-il la poésie à la modernité ?
- Comment Baudelaire ouvre-t-il la poésie à la modernité ?
- Baudelaire et la modernité: Le Peintre de la vie moderne