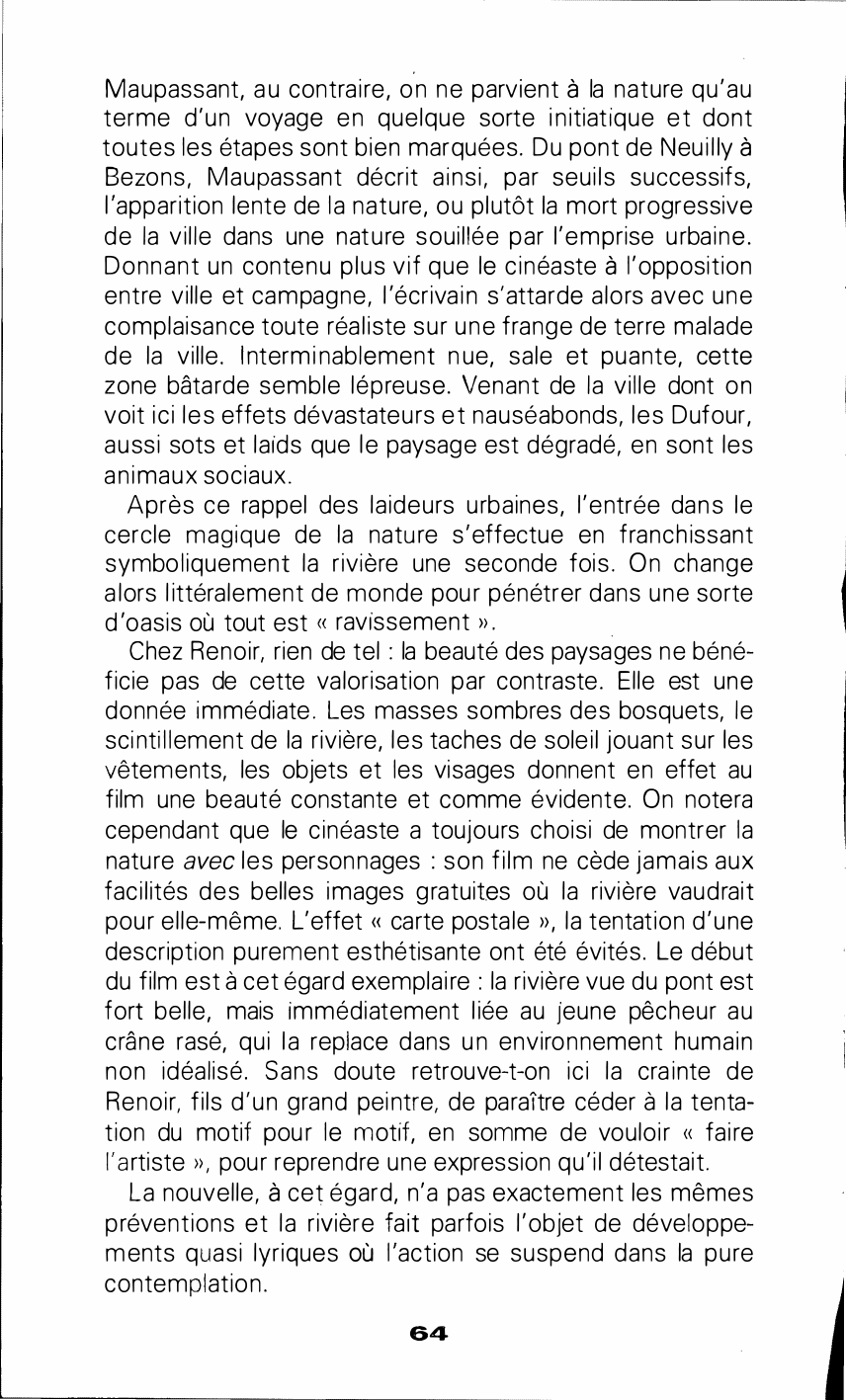La nature dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
Publié le 05/12/2019

Extrait du document
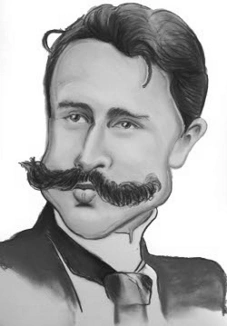
Cette importance, qui de nos jours peut paraître aller de soi, s'inscrit dans un cadre idéologique bien précis. C'est en effet à partir de la fin du XVI118 siècle que l'image de la nature s'infléchit en Occident. Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau, philosophes, artistes et écrivains vont concevoir et célébrer une nature désormais toute bienfaisante, au sein de laquelle l'homme meurtri par l a ville et dégradé par les méfaits d'une civilisation corrompue pourra se ressourcer. La modeste histoire de la famille Dufour fuyant les miasmes de la rue des Martyrs pour aller respirer un air plus sain, est donc globalement conditionnée par cette vision philosophique anti-urbaine : on attend de la nature une sorte de purification générale des corps et des esprits.
Maupassant et Renoir restent largement tributaires de cette conception. La nature, bienfaisante par définition, joue également pour l'homme un rôle de révélateur. Elle apporte ainsi à chacun sa vérité particulière. Mais c'est aussi dans cette révélation que l'euphorie se dissipe et que l'homme, rendu par la nature à sa nature propre, découvre le malheur des passions et le non-sens de la vie.
LA NATURE BIENFAISANTE
Beauté de la nature
En accord sur l'image d'une nature belle et bienfaisante, la nouvelle et le film divergent cependant sur la façon de l'introduire. Chez Renoir, en effet. la beauté des paysages est immédiatement présente : dès que la carriole arrive sur le pont, on voit la rivière et ses berges boisées. Chez
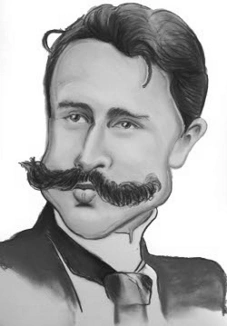
«
Mau
passant, au contr aire, on ne parvient à la natur e qu'au
terme d'un voyage en quelque sorte initia tique et dont
toutes les étapes sont bien marquées.
Du pont de Neuilly à
Bez ons, Maup assant décrit ainsi, par seuils suc cessifs,
l' apparition lente de la natur e, ou plutôt la mor t progressive
de la ville dans une natur e souillée par l'emp rise urbaine.
Donnant un contenu plus vif que le ciné aste à l'o ppos ition
entr e ville et camp agne, l'écriv ain s'atta rde alors avec une
complais ance toute réaliste sur une frange de terr e malade
de la ville.
Interm inablement nue, sale et pua nte, cette
zone bâta rd e semble lépreuse.
Venant de la ville dont on
voit ici les effets dévastate urs et naus éabonds, les Dufour,
aus si sots et la1ds que le paysa ge est dégr adé, en sont les
anim aux sociaux.
Après ce rappel des laideur s urbaines, l'entrée dans le
cercle magique de la natu re s'effect ue en franch issant
symb oliquement la rivièr e une seconde fois.
On change
al ors littér alement de monde pour péné trer dans une sorte
d' oasis où tout est '' rav
1ssement , .
Chez Renoir , rien de tel : la beauté des paysa ges ne béné
ficie pas de cette valoris ation par contr aste.
Elle est une
donné e im média te.
Les masses sombres des bosque ts, le
sci ntillement de la rivière, les taches de sole il jouant sur les
vête ments, les objets et les visages donnent en effet au
film une beauté constante et comme évidente.
On notera
cep endant que le ciné aste a tou jour s choisi de montrer la
natu re avec les perso nnages : son film ne cède jamais aux
fa cil ités des belles images gratuit es où la rivi ère va udr ait
po ur elle -même.
L'effet « ca rte posta le », la tent ation d'une
description purement esthétisa nte ont été évités.
Le début
du film est à cet égard exempla ire : la rivi ère vue du pont est
for t belle, mais Immé diatement liée au jeune pêcheur au
cr âne rasé, qui la replace dans un envir onnement humain
non idéalisé.
Sans doute retrou ve-t-o n ici la crainte de
Renoir , fils d'un grand peintre.
de paraître céder à la tent a
tion du motif pour le mo t1f, en somme de vouloi r.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L' impressionnisme chez Maupassant et Renoir dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Adaptation ou création ? dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Analyse comparée de la rencontre finale dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Résumés en parallèle dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Les personnages dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)