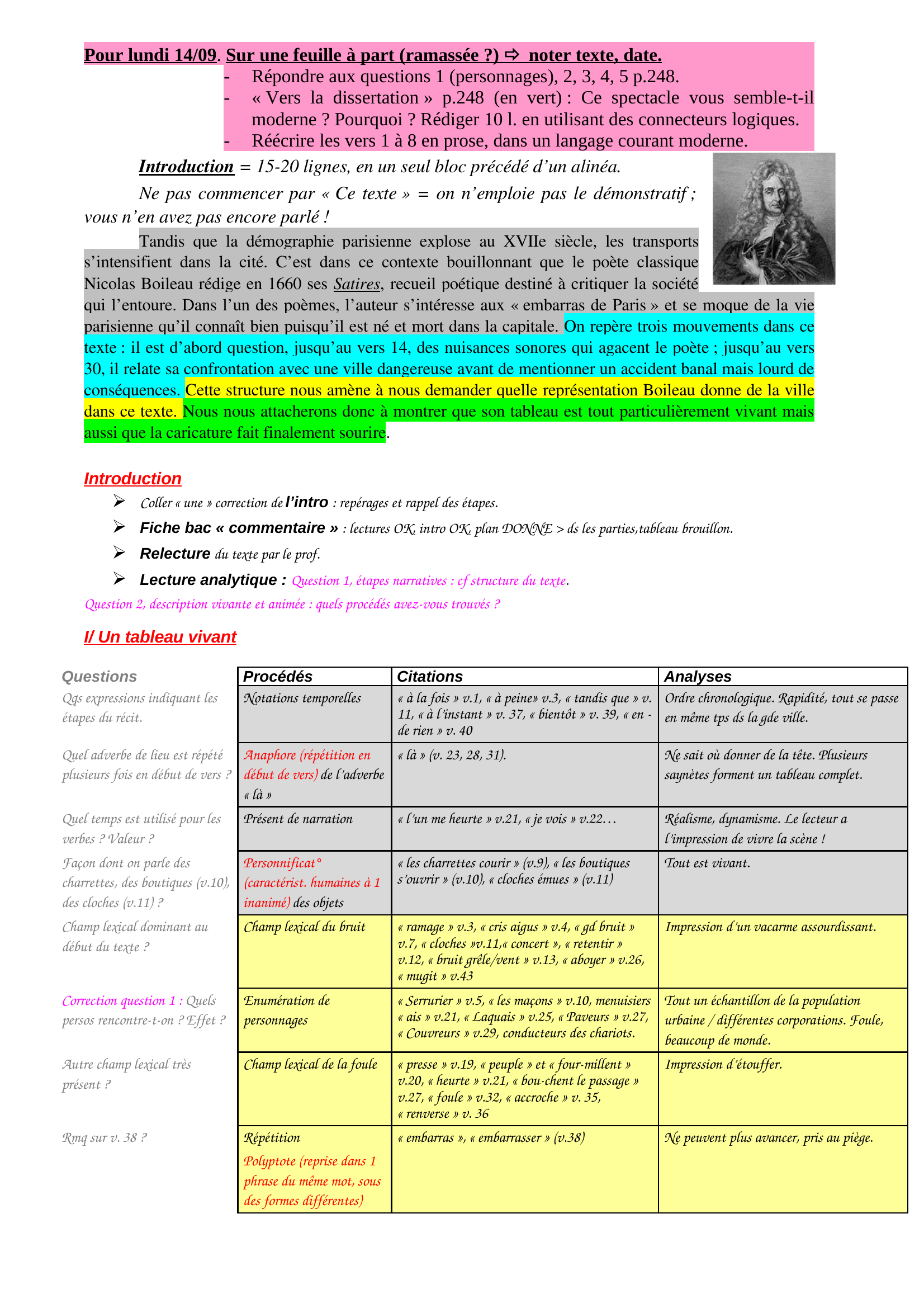La poésie
Publié le 16/01/2013

Extrait du document
«
Pour lundi 14/09 .
Sur une feuille à part (ramassée ?) noter texte, date.
- Répondre aux questions 1 (personnages), 2, 3, 4, 5 p.248.
- « Vers la dissertation » p.248 (en vert) : Ce spectacle vous semble-t-il
moderne ? Pourquoi ? Rédiger 10 l.
en utilisant des connecteurs logiques.
- Réécrire les vers 1 à 8 en prose, dans un langage courant moderne.
Introduction = 1520 lignes, en un seul bloc précédé d’un alin éa.
Ne pas commencer par « Ce texte » = on n’emploie pas le d
émonstratif ;
vous n’en avez pas encore parl
é !
Tandis que la d
émographie parisienne explose au XVIIe si ècle, les transports
s’intensifient dans la cit
é.
C’est dans ce contexte bouillonnant que le po ète classique
Nicolas Boileau r
édige en 1660 ses Satires , recueil po étique destin é à critiquer la soci été
qui l’entoure. Dans l’un des po
èmes, l’auteur s’int éresse aux « embarras de Paris » et se moque de la vie
parisienne qu’il conna
ît bien puisqu’il est n é et mort dans la capitale. On rep ère trois mouvements dans ce
texte : il est d’abord question, jusqu’au vers 14, des nuisances sonores qui agacent le po
ète ; jusqu’au vers
30, il relate sa confrontation avec une ville dangereuse avant de mentionner un accident banal mais lourd de
cons
équences. Cette structure nous am ène à nous demander quelle repr ésentation Boileau donne de la ville
dans ce texte.
Nous nous attacherons donc
à montrer que son tableau est tout particuli èrement vivant mais
aussi que la caricature fait finalement sourire .
Introduction
Coller « une » correction de l’intro : rep
érages et rappel des étapes.
Fiche bac « commentaire » : lectures OK, intro OK, plan DONNE > ds les parties,tableau brouillon.
Relecture du texte par le prof.
Lecture analytique : Question 1,
étapes narratives : cf structure du texte .
Question 2, description vivante et anim
ée : quels proc édés avezvous trouv és ?
I/ Un tableau vivant
Questions Procédés Citations Analyses
Qqs expressions indiquant les
é
tapes du r écit.
Notations temporelles «
à la fois » v.1, « à peine» v.3, « tandis que » v.
11, « à
l’instant » v. 37, « bient ôt » v. 39, « en
de rien » v. 40 Ordre chronologique. Rapidit
é, tout se passe
en m
ême tps ds la gde ville.
Quel adverbe de lieu est r
épété
plusieurs fois en d
ébut de vers ? Anaphore (r
épétition en
d
ébut de vers) de l’adverbe
« l
à » « l
à » (v. 23, 28, 31).
Ne sait o ù donner de la t ête. Plusieurs
sayn
ètes forment un tableau complet.
Quel temps est utilis
é pour les
verbes ? Valeur ? Pr ésent de narration « l’un me heurte » v.21, « je vois » v.22… R éalisme, dynamisme. Le lecteur a
l’impression de vivre la sc
ène !
Fa
çon dont on parle des
charrettes, des boutiques (v.10),
des cloches (v.11) ? Personnificat °
(caract
érist. humaines à 1
inanim
é) des objets « les charrettes courir » (v.9), « les boutiques
s’ouvrir » (v.10), « cloches
émues » (v.11) Tout est vivant.
Champ lexical dominant au
d
ébut du texte ? Champ lexical du bruit « ramage » v.3, « cris aigus » v.4, « gd bruit »
v.7, « cloches »v.11,« concert », « retentir »
v.12, « bruit gr êle/vent » v.13, « aboyer » v.26,
« mugit » v.43 Impression d’un vacarme assourdissant.
Correction question 1 : Quels
persos rencontreton ? Effet ? Enum
ération de
personnages « Serrurier » v.5, « les ma çons » v.10, menuisiers
« ais » v.21, « Laquais » v.25, « Paveurs » v.27,
« Couvreurs » v.29, conducteurs des chariots.
Tout un échantillon de la population
urbaine / diff
érentes corporations. Foule,
beaucoup de monde.
Autre champ lexical tr
ès
pr
ésent ? Champ lexical de la foule « presse » v.19, « peuple » et « fourmillent »
v.20, « heurte » v.21, « bouchent le passage »
v.27, « foule » v.32, « accroche » v. 35,
« renverse » v. 36 Impression d’
étouffer.
Rmq sur v. 38 ? R
épétition
Polyptote (reprise dans 1
phrase du m
ême mot, sous
des formes diff
érentes) « embarras », « embarrasser » (v.38) Ne peuvent plus avancer, pris au pi
ège..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La beauté dans la laideur en poésie _ Séance 14 : Du Parnasse ... au Symbolisme
- Une étude de la poésie à la lumière de l'esthétique phénoménologique : l'exemple de Francis Ponge
- Fiche sur la poésie
- La poésie du XIXème au XXIème siècle
- Méthodologie– La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle