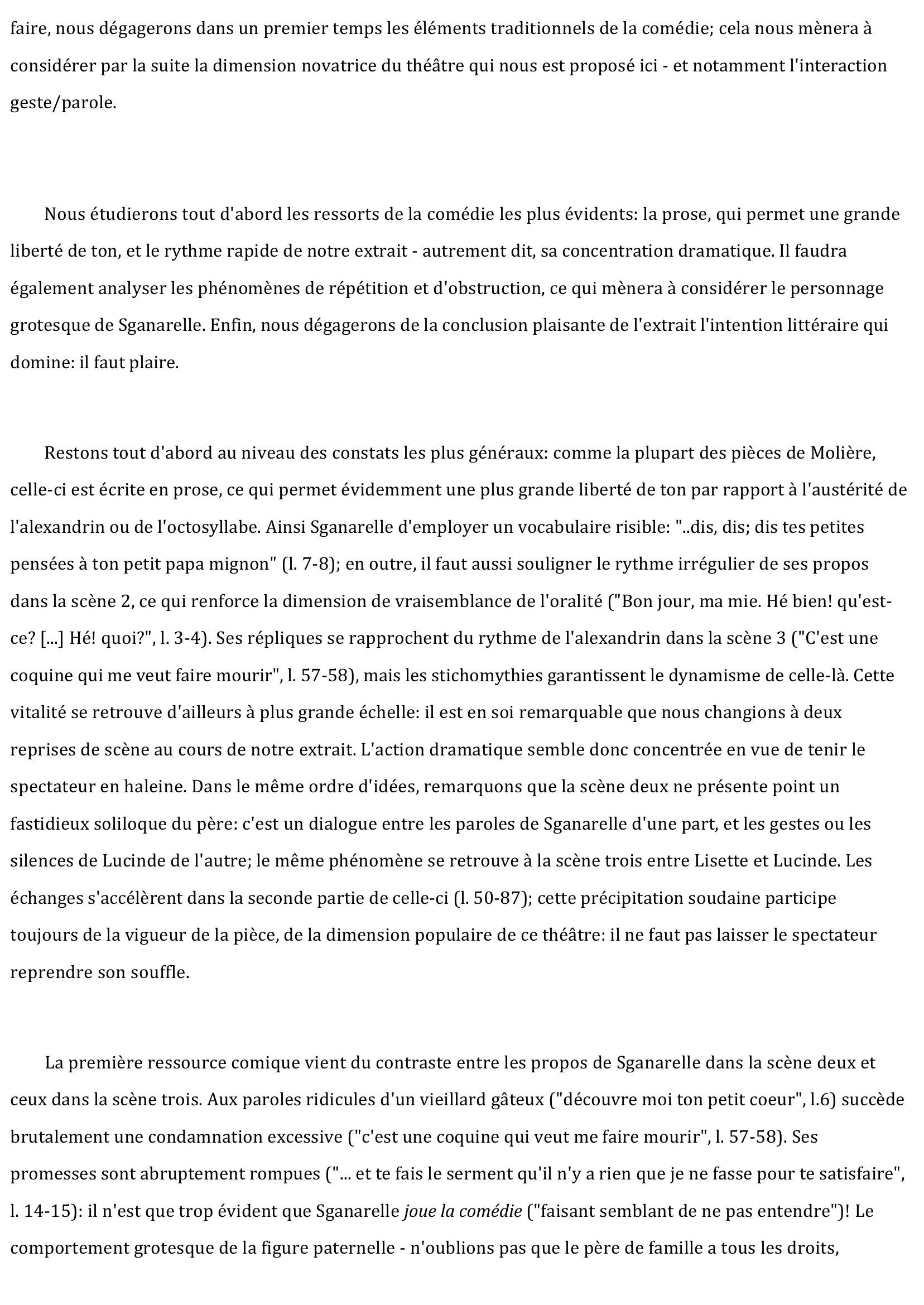« L'Amour Médecin », Acte I, Molière
Publié le 24/05/2011
Extrait du document

« Un silence, voilà qui est suffisant pour expliquer un cœur, déclare Molière; c'est particulièrement le cas dans notre extrait - d'autant plus que Lucinde n'a de toute façon aucune possibilité d'exprimer de vive voix ses désirs. C'est que son père, dans notre extrait de l'acte I de L'Amour médecin, joue ostensiblement l'offusqué: son grotesque changement de comportement entre la scène deux et la trois est ici à la base du procédé comique. Bref, nous avons donc un théâtre léger au sujet trivial, à savoir le consentement paternel au projet de mariage de la fille; est-ce à dire pour autant que cette dimension populaire révèle un profond manque d'originalité, et nous renvoie aux archétypes canoniques des comédies antiques (pensons à Aristophane ou à Plaute)? Certes non, car les pièces de Molière ont leurs singularités - et notre extrait semble particulièrement atypique: c'est que la parole théâtrale a ici perdu toute valeur performative.

«
faire, nous dégagerons dans un premier temps les éléments traditionnels de la comédie; cela nous mènera à
considérer par la suite la dimension novatrice du théâtre qui nous est proposé ici - et notamment l'interaction
geste/parole.
Nous étudierons tout d'abord les ressorts de la comédie les plus évidents: la prose, qui permet une grande
liberté de ton, et le rythme rapide de notre extrait - autrement dit, sa concentration dramatique.
Il faudra
également analyser les phénomènes de répétition et d'obstruction, ce qui mènera à considérer le personnage
grotesque de Sganarelle.
Enfin, nous dégagerons de la conclusion plaisante de l'extrait l'intention littéraire qui
domine: il faut plaire.
Restons tout d'abord au niveau des constats les plus généraux: comme la plupart des pièces de Molière,
celle-ci est écrite en prose, ce qui permet évidemment une plus grande liberté de ton par rapport à l'austérité de
l'alexandrin ou de l'octosyllabe.
Ainsi Sganarelle d'employer un vocabulaire risible: "..dis, dis; dis tes petites
pensées à ton petit papa mignon" (l.
7-8); en outre, il faut aussi souligner le rythme irrégulier de ses propos
dans la scène 2, ce qui renforce la dimension de vraisemblance de l'oralité ("Bon jour, ma mie.
Hé bien! qu'est-
ce? [...] Hé! quoi?", l.
3-4).
Ses répliques se rapprochent du rythme de l'alexandrin dans la scène 3 ("C'est une
coquine qui me veut faire mourir", l.
57-58), mais les stichomythies garantissent le dynamisme de celle-là.
Cette
vitalité se retrouve d'ailleurs à plus grande échelle: il est en soi remarquable que nous changions à deux
reprises de scène au cours de notre extrait.
L'action dramatique semble donc concentrée en vue de tenir le
spectateur en haleine.
Dans le même ordre d'idées, remarquons que la scène deux ne présente point un
fastidieux soliloque du père: c'est un dialogue entre les paroles de Sganarelle d'une part, et les gestes ou les
silences de Lucinde de l'autre; le même phénomène se retrouve à la scène trois entre Lisette et Lucinde.
Les
échanges s'accélèrent dans la seconde partie de celle-ci (l.
50-87); cette précipitation soudaine participe
toujours de la vigueur de la pièce, de la dimension populaire de ce théâtre: il ne faut pas laisser le spectateur
reprendre son souffle.
La première ressource comique vient du contraste entre les propos de Sganarelle dans la scène deux et
ceux dans la scène trois.
Aux paroles ridicules d'un vieillard gâteux ("découvre moi ton petit coeur", l.6) succède
brutalement une condamnation excessive ("c'est une coquine qui veut me faire mourir", l.
57-58).
Ses
promesses sont abruptement rompues ("...
et te fais le serment qu'il n'y a rien que je ne fasse pour te satisfaire",
l.
14-15): il n'est que trop évident que Sganarelle joue la comédie ("faisant semblant de ne pas entendre")! Le
comportement grotesque de la figure paternelle - n'oublions pas que le père de famille a tous les droits,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LL4, l’Amour Médecin, I, 6 de Molière
- BAHIS de Molière l'Amour médecin
- MEDECINS (les). Personnages de la comédie de Molière l'Amour médecin
- Le personnage de CLITANDRE de Molière l'Amour médecin
- Le Sicilien ou L'Amour peintre de Molière : Commentaire scène VI acte I