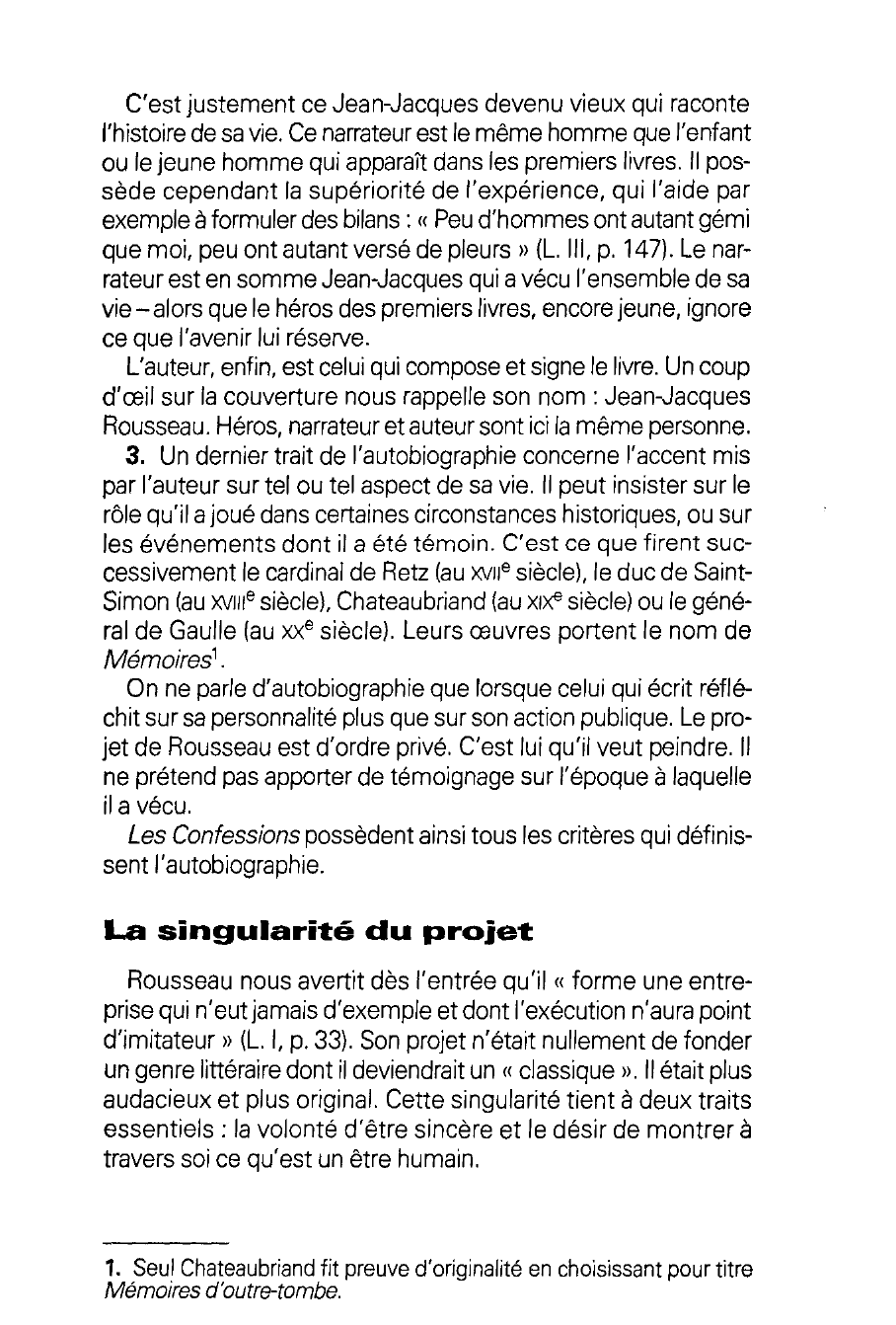L'autobiographie selon Rousseau
Publié le 23/06/2015

Extrait du document


«
C'est justement ce Jean-Jacques devenu vieux qui raconte
l'histoire de sa vie.
Ce narrateur est le même homme que l'enfant
ou le jeune homme qui apparaît dans les premiers livres.
Il pos
sède cependant la supériorité de l'expérience, qui l'aide par
exemple à formuler des bilans : « Peu d'hommes ont autant gémi
que moi, peu ont autant versé de pleurs>> (L.
Ill, p.
147).
Le nar
rateur est en somme Jean-Jacques qui a vécu l'ensemble de sa
vie -alors que le héros des premiers livres, encore jeune, ignore
ce que l'avenir lui réserve.
L'auteur, enfin, est celui qui compose et signe le livre.
Un coup
d'œil sur la couverture nous rappelle son nom: Jean-Jacques
Rousseau.
Héros, narrateur et auteur sont ici la même personne.
3.
Un dernier trait de l'autobiographie concerne l'accent mis
par l'auteur sur tel ou tel aspect de sa vie.
Il peut insister sur le
rôle qu'il a joué dans certaines circonstances historiques, ou sur
les événements dont il a été témoin.
C'est ce que firent suc
cessivement
le cardinal de Retz (au XVIIe siècle).
le duc de Saint
Simon (au XVIIIe siècle).
Chateaubriand (au XIX" siècle) ou le géné
ral de Gaulle (au xxe siècle).
Leurs œuvres portent le nom de
Mémoires 1
•
On ne parle d'autobiographie que lorsque celui qui écrit réflé
chit sur sa personnalité plus que sur son action publique.
Le pro
jet de Rousseau est d'ordre privé.
C'est lui qu'il veut peindre.
Il
ne prétend pas apporter de témoignage sur /'époque à laquelle
il a vécu.
Les Confessions possèdent ainsi tous les critères qui définis
sent
l'autobiographie.
La singularité du projet
Rousseau nous avertit dès l'entrée qu'il« forme une entre
prise qui n'eut jamais d'exemple et dont 1 'exécution n'aura point
d'imitateur» (L.
1, p.
33).
Son projet n'était nullement de fonder
un genre littéraire dont il deviendrait un« classique».
Il était plus
audacieux et plus original.
Cette singularité tient à deux traits
essentiels :
la volonté d'être sincère et le désir de montrer à
travers soi ce qu'est un être humain.
1.
Seul Chateaubriand fit preuve d'originalité en choisissant pour titre Mémoires d'outre-tombe.
26.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L' autobiographie, un genre littéraire nouveau LES CONFESSIONS DE ROUSSEAU
- Autobiographie et vérité dans les Confessions de Rousseau
- Les Confessions de Rousseau: une autobiographie ?
- On considère généralement Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau comme la première autobiographie de la littérature française. Si l'on définit l'autobiographie comme le récit par un auteur de sa propre vie, ces termes suffisent-ils alors pour rendre compte des livres que vous avez étudiés ?
- L'écrivain Michel Leiris, dans la préface de son autobiographie L'Âge d'homme, écrit qu'il essaie de trouver dans le lecteur « moins un juge qu'un complice». Pensez-vous que Rousseau cherche à établir, dans les quatre premiers livres des Confessions, le même type de relation avec son lecteur ?