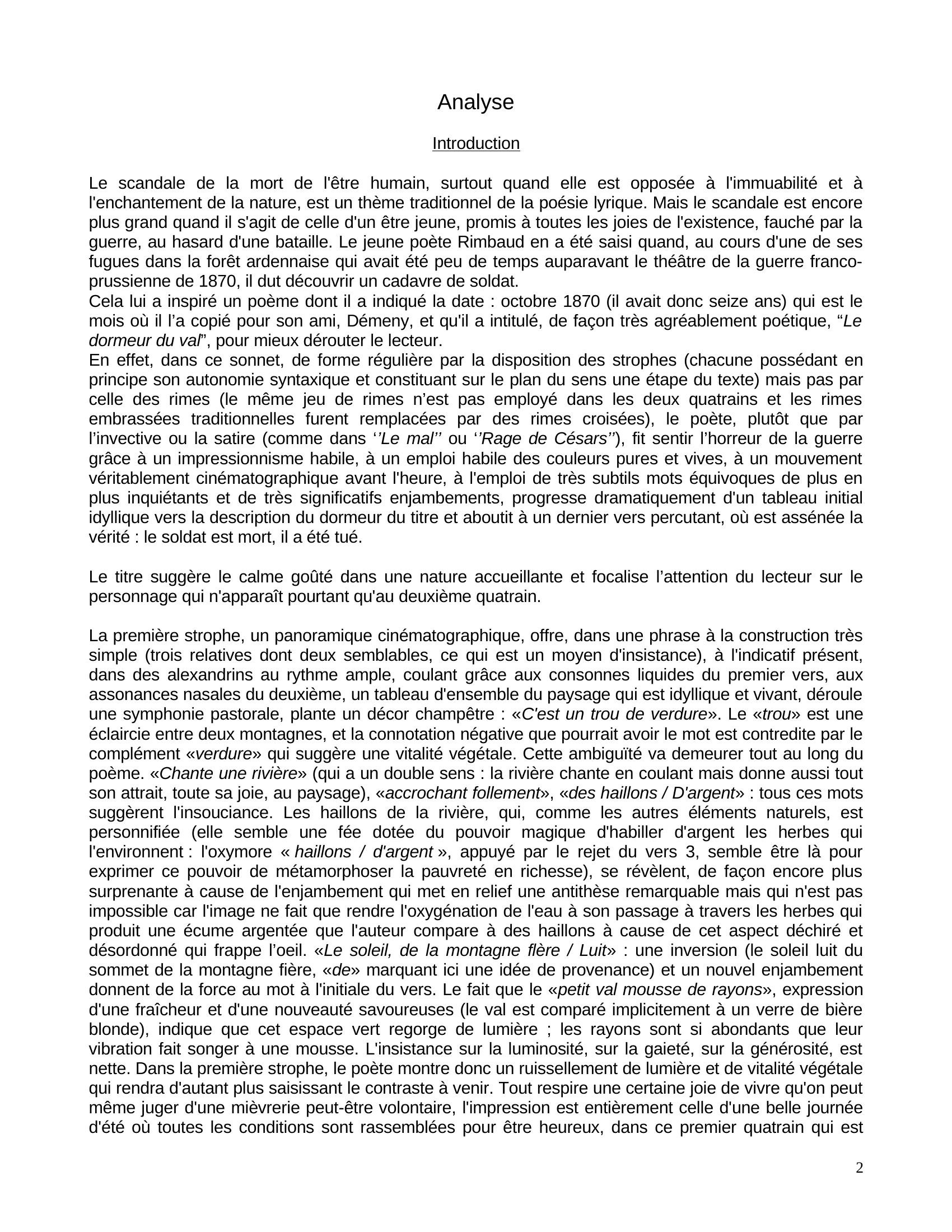"Le Dormeur du Val" Rimbaud
Publié le 28/10/2012

Extrait du document
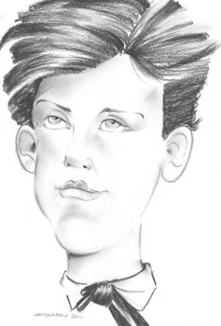
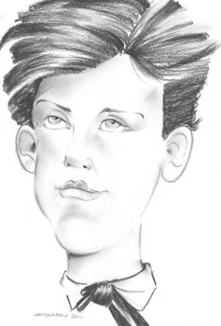
«
Analyse
Introduction
Le scandale de la mort de l'être humain, surtout quand elle est opposée à l'immuabilité et à
l'enchantement de la nature, est un thème traditionnel de la poésie lyrique.
Mais le scandale est encore
plus grand quand il s'agit de celle d'un être jeune, promis à toutes les joies de l'existence, fauché par la
guerre, au hasard d'une bataille.
Le jeune poète Rimbaud en a été saisi quand, au cours d'une de ses
fugues dans la forêt ardennaise qui avait été peu de temps auparavant le théâtre de la guerre franco-
prussienne de 1870, il dut découvrir un cadavre de soldat.
Cela lui a inspiré un poème dont il a indiqué la date : octobre 1870 (il avait donc seize ans) qui est le
mois où il l’a copié pour son ami, Démeny, et qu'il a intitulé, de façon très agréablement poétique, “ Le
dormeur du val ”, pour mieux dérouter le lecteur.
En effet, dans ce sonnet, de forme régulière par la disposition des strophes (chacune possédant en
principe son autonomie syntaxique et constituant sur le plan du sens une étape du texte) mais pas par
celle des rimes (le même jeu de rimes n’est pas employé dans les deux quatrains et les rimes
embrassées traditionnelles furent remplacées par des rimes croisées), le poète, plutôt que par
l’invective ou la satire (comme dans ‘ ’Le mal’’ ou ‘ ’Rage de Césars’’ ), fit sentir l’horreur de la guerre
grâce à un impressionnisme habile, à un emploi habile des couleurs pures et vives, à un mouvement
véritablement cinématographique avant l'heure, à l'emploi de très subtils mots équivoques de plus en
plus inquiétants et de très significatifs enjambements, progresse dramatiquement d'un tableau initial
idyllique vers la description du dormeur du titre et aboutit à un dernier vers percutant, où est assénée la
vérité : le soldat est mort, il a été tué.
Le titre suggère le calme goûté dans une nature accueillante et focalise l’attention du lecteur sur le
personnage qui n'apparaît pourtant qu'au deuxième quatrain.
La première strophe, un panoramique cinématographique, offre, dans une phrase à la construction très
simple (trois relatives dont deux semblables, ce qui est un moyen d'insistance), à l'indicatif présent,
dans des alexandrins au rythme ample, coulant grâce aux consonnes liquides du premier vers, aux
assonances nasales du deuxième, un tableau d'ensemble du paysage qui est idyllique et vivant, déroule
une symphonie pastorale, plante un décor champêtre : « C'est un trou de verdure ».
Le « trou » est une
éclaircie entre deux montagnes, et la connotation négative que pourrait avoir le mot est contredite par le
complément « verdure » qui suggère une vitalité végétale.
Cette ambiguïté va demeurer tout au long du
poème.
« Chante une rivière » (qui a un double sens : la rivière chante en coulant mais donne aussi tout
son attrait, toute sa joie, au paysage), « accrochant follement », « des haillons / D'argent » : tous ces mots
suggèrent l'insouciance.
Les haillons de la rivière, qui, comme les autres éléments naturels, est
personnifiée (elle semble une fée dotée du pouvoir magique d'habiller d'argent les herbes qui
l'environnent : l'oxymore « haillons / d'argent », appuyé par le rejet du vers 3, semble être là pour
exprimer ce pouvoir de métamorphoser la pauvreté en richesse), se révèlent, de façon encore plus
surprenante à cause de l'enjambement qui met en relief une antithèse remarquable mais qui n'est pas
impossible car l'image ne fait que rendre l'oxygénation de l'eau à son passage à travers les herbes qui
produit une écume argentée que l'auteur compare à des haillons à cause de cet aspect déchiré et
désordonné qui frappe l’oeil.
« Le soleil, de la montagne flère / Luit » : une inversion (le soleil luit du
sommet de la montagne fière, « de » marquant ici une idée de provenance) et un nouvel enjambement
donnent de la force au mot à l'initiale du vers.
Le fait que le « petit val mousse de rayons », expression
d'une fraîcheur et d'une nouveauté savoureuses (le val est comparé implicitement à un verre de bière
blonde), indique que cet espace vert regorge de lumière ; les rayons sont si abondants que leur
vibration fait songer à une mousse.
L'insistance sur la luminosité, sur la gaieté, sur la générosité, est
nette.
Dans la première strophe, le poète montre donc un ruissellement de lumière et de vitalité végétale
qui rendra d'autant plus saisissant le contraste à venir.
Tout respire une certaine joie de vivre qu'on peut
même juger d'une mièvrerie peut-être volontaire, l'impression est entièrement celle d'une belle journée
d'été où toutes les conditions sont rassemblées pour être heureux, dans ce premier quatrain qui est
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Plan détaillé : "Le dormeur du val", A.Rimbaud (1870)
- Rimbaud dormeur du val
- Commentaire: Le Dormeur du Val, Arthur Rimbaud
- Analyse du poème : « le dormeur du Val » Arthur Rimbaud
- Lecture Analytique - Rimbaud "Le dormeur du Val"