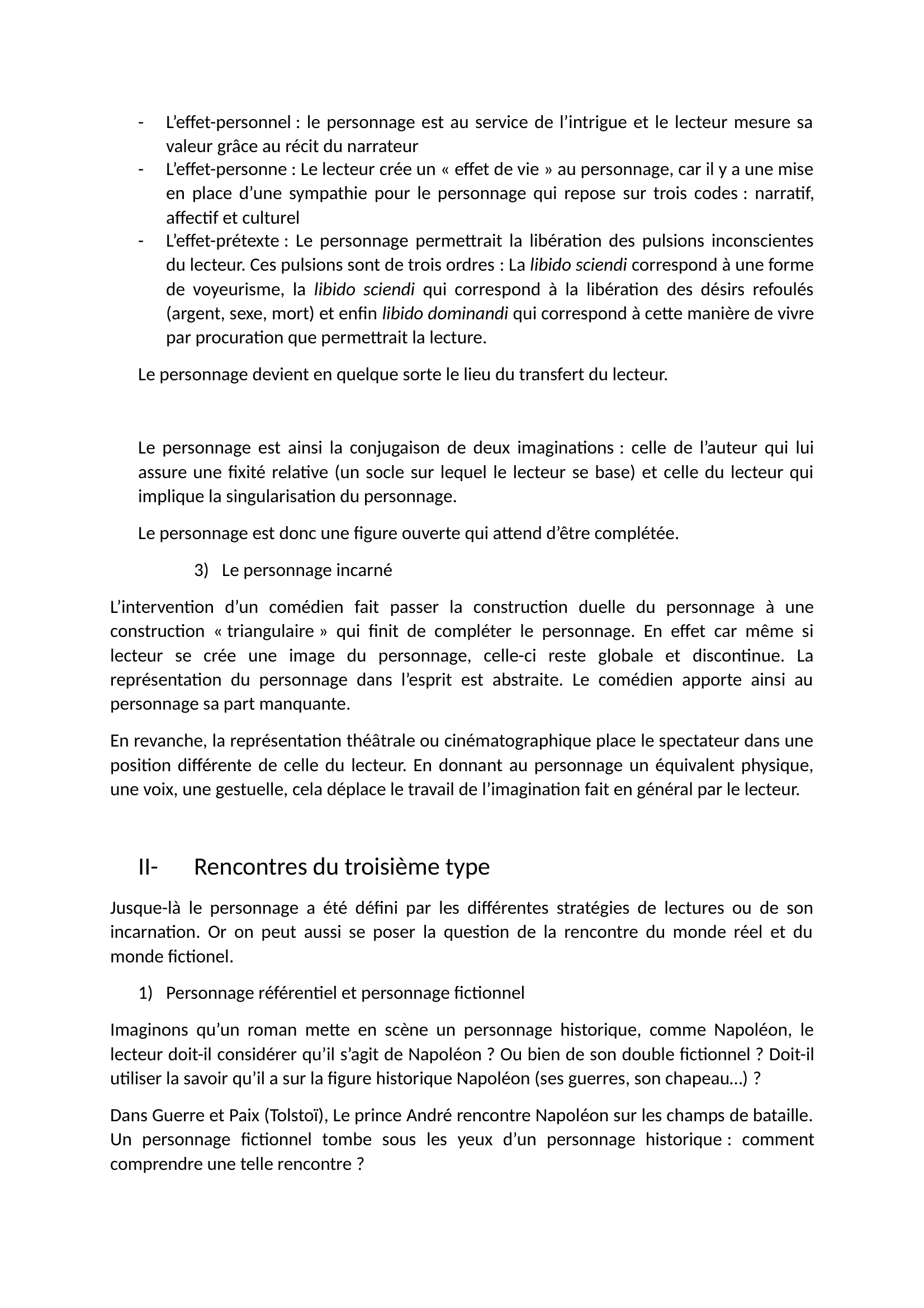Le personnage
Publié le 01/10/2015

Extrait du document
...
Le personnage, corpus de textes choisis et présentés par Christine Montalbetti. GF flammrion (254 pages)
I- Complétude et incomplétude du personnage.
1) Le personnage épuisé (la position textualiste)
Le personnage est un élément du texte fixe, par conséquent il n’a pas d’autre passé que celui qui lui est donné, il n’a pas d’autre famille qui celle qui nous est présentée et il n’a pas d’autre avenir que celui qui nous est conté.
Le personnage est en quelque sorte une somme d’énoncé qui remplit une fonction dans le texte. Le héros joue le rôle d’un fil conducteur. Il oriente le lecteur à travers les différents motifs du récit.
Il est possible qu’il y est une incohérence dans l’écriture du personnage (exemple : Lady Macbeth dit une fois « J’ai allaité des enfants « et plus tard elle dit qu’elle n’a pas d’enfants), mais tant cette optique textualiste la cohérence d’un personnage importe peu tant qu’il assure sa fonction. Le personnage dans cette optique devient le support de l’action.
Il fait l’objet d’une définition rationnelle, dans laquelle il est définit uniquement par la fonction qu’il remplit dans l’histoire. Le personnage apparait donc comme une entité du texte qui assure le mouvement de la narration, lie les différents épisodes de l’histoire et coïncide entièrement avec la somme des énoncés qui l’évoquent.
2) Le personnage ouvert (définition pragmatique)
Le personnage n’est pas juste un élément de ton texte fixe, le lecteur par sa lecture participe à la constitution du personnage. Pour reprendre les termes d’Umberto Eco « le personnage devient l’objet d’une fabrication duelle «.
Le personnage est alors une figure inachevée dans le texte, et ne s’achève que par cette construction mixte. Il est pris entre les contraintes du texte et l’imagination du lecteur qui se le représente. Il n’existe donc pas juste un personnage par texte, il existe un personnage par lecture, car chacun se le représente différemment. Le personnage est donc multiple.
Jouve distingue trois lectures du personnage :
L’effet-personnel : le personnage
«
- L’effet-personnel : le personnage est au service de l’intrigue et le lecteur mesure sa
valeur grâce au récit du narrateur
- L’effet-personne : Le lecteur crée un « effet de vie » au personnage, car il y a une mise
en place d’une sympathie pour le personnage qui repose sur trois codes : narratif,
affectif et culturel
- L’effet-prétexte : Le personnage permettrait la libération des pulsions inconscientes
du lecteur.
Ces pulsions sont de trois ordres : La libido sciendi correspond à une forme
de voyeurisme, la libido sciendi qui correspond à la libération des désirs refoulés
(argent, sexe, mort) et enfin libido dominandi qui correspond à cette manière de vivre
par procuration que permettrait la lecture.
Le personnage devient en quelque sorte le lieu du transfert du lecteur.
Le personnage est ainsi la conjugaison de deux imaginations : celle de l’auteur qui lui
assure une fixité relative (un socle sur lequel le lecteur se base) et celle du lecteur qui
implique la singularisation du personnage.
Le personnage est donc une figure ouverte qui attend d’être complétée.
3) Le personnage incarné
L’intervention d’un comédien fait passer la construction duelle du personnage à une
construction « triangulaire » qui finit de compléter le personnage.
En effet car même si
lecteur se crée une image du personnage, celle-ci reste globale et discontinue.
La
représentation du personnage dans l’esprit est abstraite.
Le comédien apporte ainsi au
personnage sa part manquante.
En revanche, la représentation théâtrale ou cinématographique place le spectateur dans une
position différente de celle du lecteur.
En donnant au personnage un équivalent physique,
une voix, une gestuelle, cela déplace le travail de l’imagination fait en général par le lecteur.
II- Rencontres du troisième type
Jusque-là le personnage a été défini par les différentes stratégies de lectures ou de son
incarnation.
Or on peut aussi se poser la question de la rencontre du monde réel et du
monde fictionel.
1) Personnage référentiel et personnage fictionnel
Imaginons qu’un roman mette en scène un personnage historique, comme Napoléon, le
lecteur doit-il considérer qu’il s’agit de Napoléon ? Ou bien de son double fictionnel ? Doit-il
utiliser la savoir qu’il a sur la figure historique Napoléon (ses guerres, son chapeau…) ?
Dans Guerre et Paix (Tolstoï), Le prince André rencontre Napoléon sur les champs de bataille.
Un personnage fictionnel tombe sous les yeux d’un personnage historique : comment
comprendre une telle rencontre ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Personnage principal et personnage admirable
- En quoi Antoine apparait comme le personnage le plus sincere dans la pièce de Jean Luc La Garce, Juste la fin du monde ?
- la société et la morale du temps du personnage romanesque doivent-elles être en confrontation avec ce dernier afin de captiver le lecteur ?
- Le personnage de Lorenzo
- Français commentaire: Un portrait idéalisé du personnage de Gueule d’or