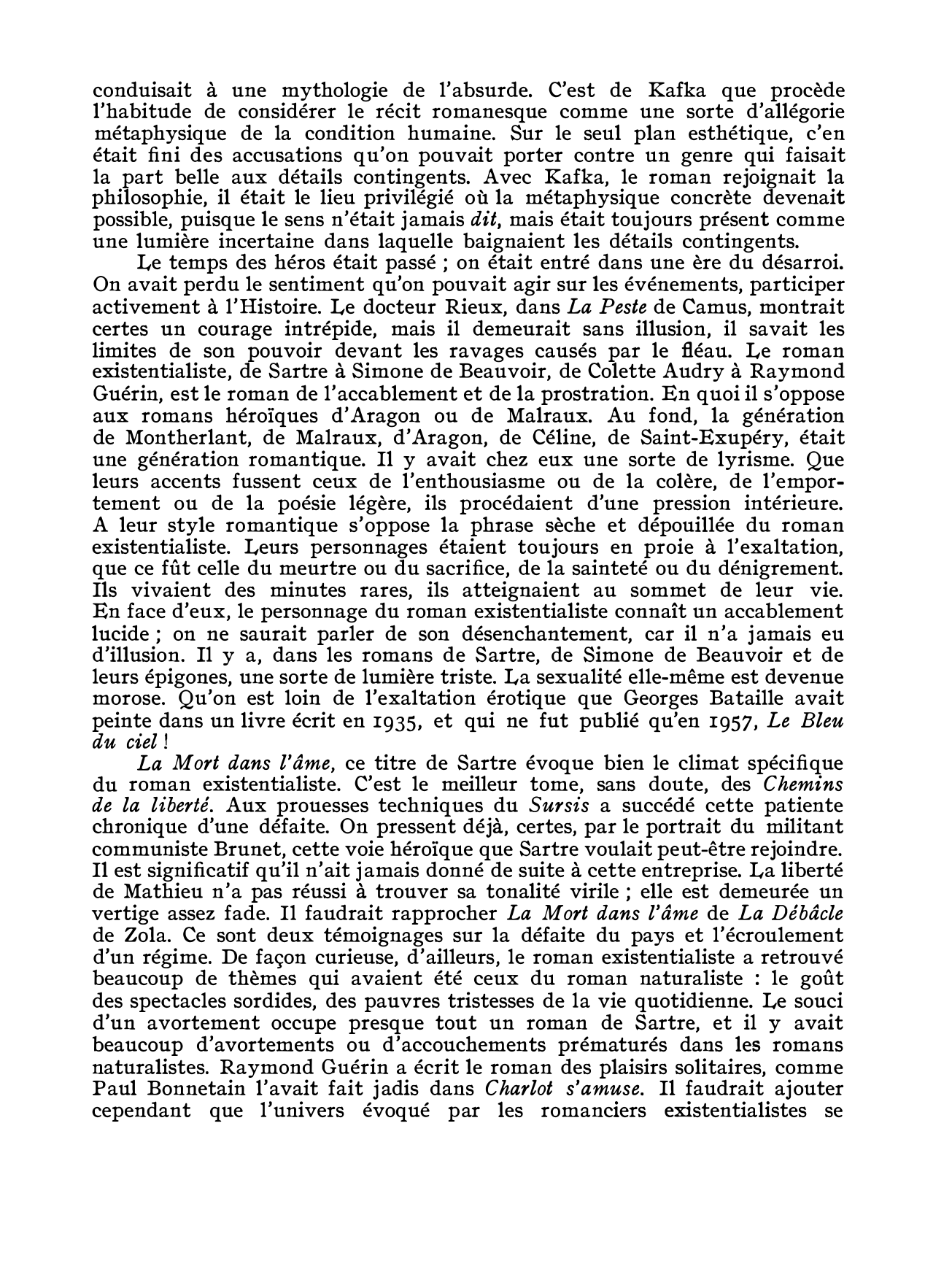Le roman existentialiste
Publié le 14/01/2018

Extrait du document
toujours les événements rapportés à leur vraie nature contingente. Si ternes que les désirent les romanciers, ils brillent, ils rayonnent doucement dans cet espace imaginaire auquel nous donne accès une suite de mots et de phrases. Roquentin lit La Chartreuse de Parme. Il dit : << J'essayais de m'absorber dans ma lecture, de trouver un refuge dans la claire Italie de Stendhal. J'y parvenais par à-coups, par courtes hallucinations, puis je retombais dans cette journée menaçante ». Que l'on compare avec les lectures du narrateur de la Recherche ! Elles ravissent l'esprit, elles sont promesses de révélation, elles annoncent qu'il y a dans la vie des « moments parfaits ». Chez Proust, la vie est oubliée, d'abord, puis retrouvée dans l'imaginaire, aperçue dans un éclairage romanesque qui lui confère son éclat. Pour Roquentin, la lecture n'est pas ravissement mais effort ; elle souligne le contraste entre le romanesque et le vécu. Il y avait, jusqu'à Sartre, communication entre l'imagination et la vie, illumination réciproque de celle-ci par celle-là. Il y a bien, dans La Nausée, une tentation esthétique, mais elle ne saurait constituer un moyen de salut. Loin de pouvoir exhausser la vie jusqu'à l'art, les expériences esthétiques manifestent le déchirement entre la vie et l'art. Elles donnent seulement (qu'il s'agisse de la peinture, de la musique ou de la lecture) l'envie et la nostalgie d'un monde nécessaire et rigoureux. <1 J'ai du bonheur, note Roquentin, quand une négresse chante : quels sommets n'atteindrais-je point, si ma propre vie faisait la matière de la mélodie ! » Mais cet absolu qu'est l'art est <8 de l'autre côté de l'existence, dans cet autre monde, qu'on peut voir de loin sans jamais s'approcher ! ».
Dans l'histoire du roman français, La Nausée est comme le dernier sommet d'une vaste chaîne : Balzac, Flaubert, Proust, Sartre. Chez Balzac, l'existence est romanesque. L'imaginaire se déploie, dans La Comédie humaine, à même la vie. Les héros ont des existences mouvementées, ils connaissent des passions fiévreuses, c'est pourquoi ils exercent tant de séduction sur nos esprits. Jules Vallès, avant Sartre, avait déjà dénoncé, et avec quel accent pathétique, les mensonges du romanesque balzacien, la puissance de la fascination qu'il exerçait. Chez Flaubert, surtout dans L’Education sentimentale, le romanesque cesse d'être dans les événements : il ne se passe plus rien ; mais il affleure constamment comme un possible. Frédéric Moreau coule une vie monotone en ne cessant de rêver à une existence romanesque. Il y a en lui un Rastignac qui sommeille, — ou plutôt un Rastignac qui, au lieu d'agir, se contente de rêver. On trouve chez Flaubert un romanesque rentré des événements qui pourraient avoir lieu, des exaltations qu'on pourrait connaître, des moments parfaits qu'on pourrait atteindre. Chez Proust, le romanesque n'est plus situé dans le rêve d'une vie autre que celle-ci : il touche au poétique, en plus d'un endroit, quand le réel se pare des prestiges qu'on trouve ordinairement dans l'imaginaire. Il y a des moments où l'existence devient romanesque, non dans les événements qu'elle produit, ni dans les rêves qu'elle suscite, mais dans les émotions qu'elle procure. La vraie vie, chez Proust, serait une vie constituée de ces seuls moments parfaits. Chez Sartre, il y a un absolu de l'art, mais on en est à jamais séparé. L'existence n'est plus ce qui séduit, mais ce qui surgit ; elle n'est pas ce qui émeut, mais ce qui accable. Nous entretenons avec elle une sorte de complicité sournoise. Elle est cette chose fade qui se glisse en nous. Ce sont les romans, — fussent-
conduisait à une mythologie de l'absurde. C'est de Kafka que procède l'habitude de considérer le récit romanesque comme une sorte d'allégorie métaphysique de la condition humaine. Sur le seul plan esthétique, c'en était fini des accusations qu'on pouvait porter contre un genre qui faisait la part belle aux détails contingents. Avec Kafka, le roman rejoignait la philosophie, il était le lieu privilégié où la métaphysique concrète devenait possible, puisque le sens n'était jamais dit, mais était toujours présent comme une lumière incertaine dans laquelle baignaient les détails contingents.
Le temps des héros était passé ; on était entré dans une ère du désarroi. On avait perdu le sentiment qu'on pouvait agir sur les événements, participer activement à l'Histoire. Le docteur Rieux, dans La Peste de Camus, montrait certes un courage intrépide, mais il demeurait sans illusion, il savait les limites de son pouvoir devant les ravages causés par le fléau. Le roman existentialiste, de Sartre à Simone de Beauvoir, de Colette Audry à Raymond Guérin, est le roman de l'accablement et de la prostration. En quoi il s'oppose aux romans héroïques d'Aragon ou de Malraux. Au fond, la génération de Montherlant, de Malraux, d'Aragon, de Céline, de Saint-Exupéry, était une génération romantique. Il y avait chez eux une sorte de lyrisme. Que leurs accents fussent ceux de l'enthousiasme ou de la colère, de l'emportement ou de la poésie légère, ils procédaient d'une pression intérieure. A leur style romantique s'oppose la phrase sèche et dépouillée du roman existentialiste. Leurs personnages étaient toujours en proie à l'exaltation, que ce fût celle du meurtre ou du sacrifice, de la sainteté ou du dénigrement. Ils vivaient des minutes rares, ils atteignaient au sommet de leur vie. En face d'eux, le personnage du roman existentialiste connaît un accablement lucide ; on ne saurait parler de son désenchantement, car il n'a jamais eu d'illusion. Il y a, dans les romans de Sartre, de Simone de Beauvoir et de leurs épigones, une sorte de lumière triste. La sexualité elle-même est devenue morose. Qu'on est loin de l'exaltation érotique que Georges Bataille avait peinte dans un livre écrit en 1935, et qui ne fut publié qu'en 1957, Le Bleu du ciel !
La Mort dans l'âme, ce titre de Sartre évoque bien le climat spécifique du roman existentialiste. C'est le meilleur tome, sans doute, des Chemins de la liberté. Aux prouesses techniques du Sursis a succédé cette patiente chronique d'une défaite. On pressent déjà, certes, par le portrait du militant communiste Brunet, cette voie héroïque que Sartre voulait peut-être rejoindre. Il est significatif qu'il n'ait jamais donné de suite à cette entreprise. La liberté de Mathieu n'a pas réussi à trouver sa tonalité virile ; elle est demeurée un vertige assez fade. Il faudrait rapprocher La Mort dans l’âme de La Débâcle de Zola. Ce sont deux témoignages sur la défaite du pays et l'écroulement d'un régime. De façon curieuse, d'ailleurs, le roman existentialiste a retrouvé beaucoup de thèmes qui avaient été ceux du roman naturaliste : le goût des spectacles sordides, des pauvres tristesses de la vie quotidienne. Le souci d'un avortement occupe presque tout un roman de Sartre, et il y avait beaucoup d'avortements ou d'accouchements prématurés dans les romans naturalistes. Raymond Guérin a écrit le roman des plaisirs solitaires, comme Paul Bonnetain l'avait fait jadis dans Chariot s'amuse. Il faudrait ajouter cependant que l'univers évoqué par les romanciers existentialistes se
«
con
duisait à une mythologie de l'absurde.
C'est de Kafka que procède
l' habitude de considérer le récit romanesq ue comme une sorte d'allégorie
métaphysique de la condition humaine.
Sur le seul plan esthétique, c'en
était fini des accusations qu'on pouvait porter contre un genre qui faisait
la part belle aux détails contingents.
Avec Kafka, le roman rejoignait la
philosophie, il était le lieu privilégié où la métaphysique concrète devenait
possible, puisque le sens n'était jamais dit, mais était toujours présent comme
une lumière incertaine dans laquelle baignaient les détails contingents.
Le temps des héros était passé ; on était entré dans une ère du désarroi.
On avait perdu le sentiment qu'on pouvait agir sur les événements, participer
activement à l'Histoire.
Le docteur Rieux, dans La Peste de Camus, montrait
certes un courage intrépide, mais il demeurait sans illusion, il savait les
limites de son pouvoir devant les ravages causés par le fléau.
Le roman
existentialist e, de Sartre à Simone de Beauvoir, de Colette Audry à Raymond
Guérin, est le roman de l'acc ablement et de la prostrati on.
En quoi il s'oppose
aux romans héroïques d'Aragon ou de Malraux.
Au fond, la génération
de Montherlant, de Malraux, d'Aragon, de Céline, de Saint-Exupéry, était
une génération romantique.
Il y avait chez eux une sorte de lyrisme.
Que
leurs accents fussent ceux de l'enthousiasme ou de la colère, de l'em por
tement ou de la poé sie légère, ils procéda ient d'une pression intérieure.
A leur style romantique s'oppose la phrase sèche et dépouillée du roman
existentiali ste.
Leurs personna ges étaient toujours en proie à l'exaltation,
que ce fût celle du meurtre ou du sacri fice, de la sainteté ou du dénigrement.
Ils vivaient des minutes rares, ils atteignaient au somm et de leur vie.
En face d'eux, le personnage du roman existentialiste connaît un accablement
lucide ; on ne saurait parler de son désenchantement, car il n'a jamais eu
d' illusi on.
Il y a, dans les romans de Sartre, de Simone de Beauvoir et de
leurs épigones, une sorte de lumière triste.
La sexualité elle-même est devenue
morose.
Qu'on est loin de l'ex altat ion érotique que Georges Bataille avait
peinte dans un livre écrit en rg35, et qui ne fut publié qu'en rg57, Le Bleu
du ciel l
La Mort dans l'âme, ce titre de Sartre évoque bien le climat spécifique
du roman existentialis te.
C'est le meilleur tome, sans doute, des Chemins
de la liberté.
Aux prouesses techniques du Sursis a succédé cette patiente
chronique d'une défaite.
On pressent déjà, certes, par le portrait du militant
communiste Brunet, cette voie héroïque que Sartre voulait peut-être rejoindre.
Il est signi ficatif qu'il n'ait jamais donné de suite à cette entreprise.
La liberté
de Mathieu n'a pas réussi à trouver sa tona lité virile ; elle est demeurée un
vertige assez fade.
Il faudrait rapprocher La Mort dans l'âme de La Débâc le
de Zola.
Ce sont deux témoignages sur la défaite du pays et l'écroulement
d'un régime.
De façon curieuse, d'ailleurs , le roman existentialiste a retrouvé
beaucoup de thèmes qui avaient été ceux du roman naturaliste : le goût
des spectacles sordides, des pauvres tristesses de la vie quotidienne.
Le souci
d'un avortement occupe presque tout un roman de Sartre, et il y avait
beaucoup d'avortements ou d'acco uchements prématurés dans les romans
naturalis tes.
Raymond Guérin a écrit le roman des plaisirs solitaires, comme
Pa ul Bonn etain l'avait fait jadis dans Charlot s'amuse.
Il faudrait ajouter
cependant que l'univers évoqué par les roman ciers existentialistes se.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse du roman Thérèse Desqueyroux de François Mauriac
- La morale et l'amour, un mariage impossible avec le roman le diable au corps de raymond radiguet
- le lecteur a-t-il besoin de s’identifier aux personnages principaux et de partager ses sentiments pour apprécier un roman ?
- Evolution des caractéristiques du héros de roman du XVII ème siècle au XXIème siècle
- Le récit et le roman du XVIIème au XXIème