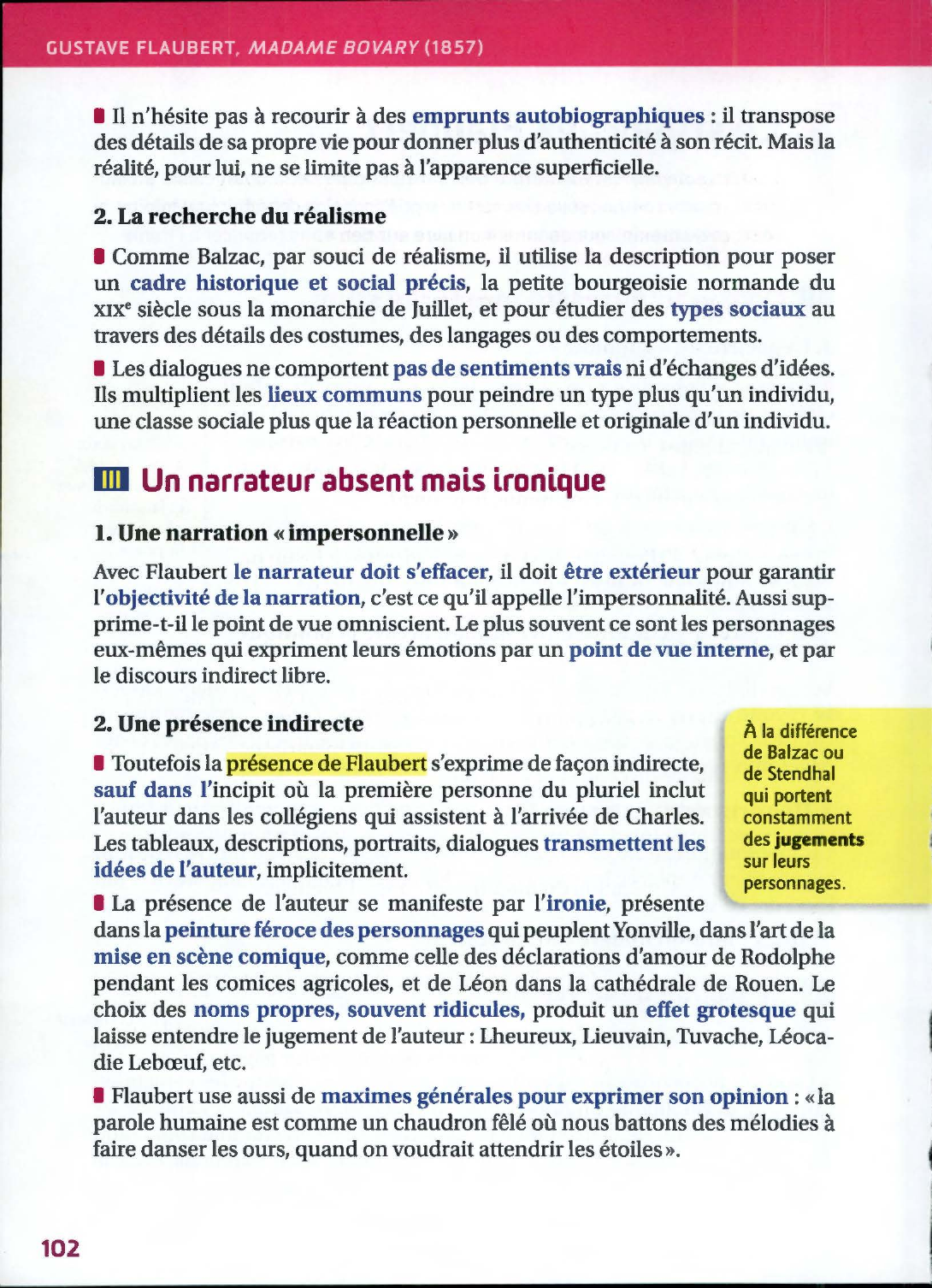Le style chez Flaubert
Publié le 02/01/2020

Extrait du document

■ Il n'hésite pas à recourir à des emprunts autobiographiques : il transpose des détails de sa propre vie pour donner plus d'authenticité à son récit. Mais la réalité, pour lui, ne se limite pas à l'apparence superficielle.
2. La recherche du réalisme
I Comme Balzac, par souci de réalisme, il utilise la description pour poser un cadre historique et social précis, la petite bourgeoisie normande du xixe siècle sous la monarchie de Juillet, et pour étudier des types sociaux au travers des détails des costumes, des langages ou des comportements.
■ Les dialogues ne comportent pas de sentiments vrais ni d’échanges d’idées. Ils multiplient les lieux communs pour peindre un type plus qu’un individu, une classe sociale plus que la réaction personnelle et originale d’un individu.
EB Un narrateur absent mais ironique
1. Une narration « impersonnelle »
Avec Flaubert le narrateur doit s'effacer, il doit être extérieur pour garantir l'objectivité de la narration, c’est ce qu’il appelle l’impersonnalité. Aussi supprime-t-il le point de vue omniscient. Le plus souvent ce sont les personnages eux-mêmes qui expriment leurs émotions par un point de vue interne, et par le discours indirect libre.

«
GUSTAVE FLAUBERT , MADAME BD VARY (1857)
102
1 Il n'hésite pas à recourir à des emprunts autobiographiques : il transpose
des détails de sa propre vie
pour donner plus d'authenticité à son récit.
Mais la
réalité,
pour lui, ne se limite pas à l'apparence superficielle.
2.
La recherche du réalisme
1 Comme Balzac, par souci de réalisme, il utilise la description pour poser
un cadre historique et social précis, la petite bourgeoisie normande du
xix• siècle sous la monarchie de Juillet, et pour étudier des types sociaux au
travers des détails des costumes, des langages ou des comportements.
1 Les dialo gues ne comportent pas de sentiments vrais ni d'échanges d'idées.
Ils mul tipli en t les lieux
communs pour peindre un type plus qu'un individu,
une classe sociale plus que la réaction personnelle et originale d'un individu .
1111 Un narrateur absent mais ironique
1.
Une narration « impersonnelle »
Avec F lau bert le narrateur doit s'effacer , il doit être extérieur pour garantir
l' objectivité de
la narration , c'est ce qu'il appelle l'impersonnalité.
Aussi sup
prime-t-il le point de vue omniscient.
Le plus souvent ce sont les personnages
eux-mêmes qui expriment leurs émotions
par un point de vue interne , et par
le discours indirect libre.
2 .
Une présence indirecte
1 Toutefois la présence de Flaubert s'exprime de façon indirecte,
sauf dans l'incipit où la prem ière personne du pluriel inclut
l'auteur dans les collégiens qui assistent à l'arrivée de Charles.
Les tableaux, descriptions, portraits, dialogues
transmettent les
idées
de l'auteur , implicitement.
1 La présence de l'auteur se manifeste par l'ironie , présente
À la différence de Balzac ou de Stendhal qui portent
constamment
des jugements
sur
leurs personnages.
dans la peinture féroce des personnages qui peuplent Yonville, dans l'art de la
mise en scène comique , comme celle des déclarations d'amour de Rodolphe
p
endant les comices agricoles, et de Léon dans la cathédrale de Rouen.
Le
choix des noms propres, souvent ridicules, produit un effet grotesque qui
laisse entendre le jugement de l'auteur : Lheureux, Lieuvain, Tuvache, Léoca
die Lebœuf, etc.
1 Flaubert use aussi de maximes générales pour exprimer son opinion: «la
parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à
faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles »..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- le style de flaubert
- Le style de Flaubert selon Proust
- Le style dans Madame Bovary de Gustave Flaubert
- « J'estime par-dessus tout d'abord le style, et ensuite le vrai. » Flaubert, à Louis Bonenfant, 1856. Commentez cette citation.
- J'estime par-dessus tout d'abord le style, et ensuite le vrai. Flaubert, à Louis Bonenfant, 1856. Commentez cette citation.