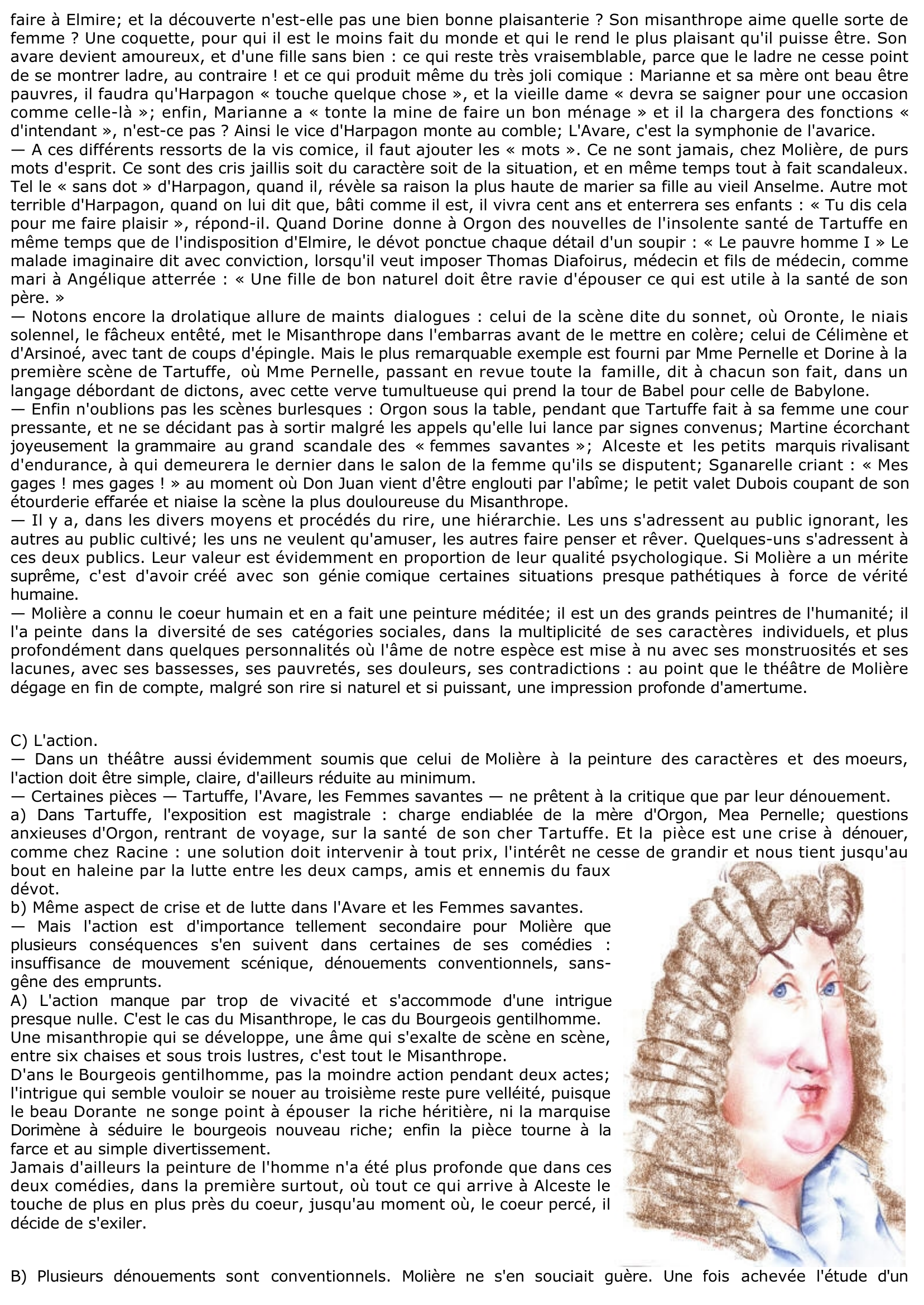LE SYSTÈME DRAMATIQUE DE MOLIÈRE
Publié le 14/05/2011

Extrait du document
A) Théorie.
— La doctrine dramatique de Molière est exposée dans la Critique de l'Ecole de femmes. Cette petite pièce en mi acte, qui tient de la comédie, du pamphlet et de la dissertation, il l'a écrite pour défendre l'Ecole des femmes et se défendre lui-même contre des critiques acharnés. C'est une conversation et une discussion dans le salon d'Uranie. La prude Climène en visite, le marquis survenant, puis le savant Lysidas, critiquent l'Ecole des femmes, défendue par Uranie elle-même, par son amie Elise, et par le gentilhomme Dorante; c'est Dorante qui, exprimant la pensée de Molière, invoque le bon sens contre le marquis et répond à Lysidas sur les règles. Voici donc la pensée de Molière. Le premier devoir d'un auteur est de plaire, non pas de suivre les règles. Que sont-elles, ces fameuses règles, armes des pédants ? Rien que le fruit du bon sens, lorsqu'on a réfléchi sur ce qui peut nuire à une oeuvre, sur les erreurs qu'un bon auteur a intérêt à éviter : il n'y a donc qu'à s'inspirer de son propre bon sens et à s'adresser au bon sens du public.
«
faire à Elmire; et la découverte n'est-elle pas une bien bonne plaisanterie ? Son misanthrope aime quelle sorte defemme ? Une coquette, pour qui il est le moins fait du monde et qui le rend le plus plaisant qu'il puisse être.
Sonavare devient amoureux, et d'une fille sans bien : ce qui reste très vraisemblable, parce que le ladre ne cesse pointde se montrer ladre, au contraire ! et ce qui produit même du très joli comique : Marianne et sa mère ont beau êtrepauvres, il faudra qu'Harpagon « touche quelque chose », et la vieille dame « devra se saigner pour une occasioncomme celle-là »; enfin, Marianne a « tonte la mine de faire un bon ménage » et il la chargera des fonctions «d'intendant », n'est-ce pas ? Ainsi le vice d'Harpagon monte au comble; L'Avare, c'est la symphonie de l'avarice.— A ces différents ressorts de la vis comice, il faut ajouter les « mots ».
Ce ne sont jamais, chez Molière, de pursmots d'esprit.
Ce sont des cris jaillis soit du caractère soit de la situation, et en même temps tout à fait scandaleux.Tel le « sans dot » d'Harpagon, quand il, révèle sa raison la plus haute de marier sa fille au vieil Anselme.
Autre motterrible d'Harpagon, quand on lui dit que, bâti comme il est, il vivra cent ans et enterrera ses enfants : « Tu dis celapour me faire plaisir », répond-il.
Quand Dorine donne à Orgon des nouvelles de l'insolente santé de Tartuffe enmême temps que de l'indisposition d'Elmire, le dévot ponctue chaque détail d'un soupir : « Le pauvre homme I » Lemalade imaginaire dit avec conviction, lorsqu'il veut imposer Thomas Diafoirus, médecin et fils de médecin, commemari à Angélique atterrée : « Une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de sonpère.
»— Notons encore la drolatique allure de maints dialogues : celui de la scène dite du sonnet, où Oronte, le niaissolennel, le fâcheux entêté, met le Misanthrope dans l'embarras avant de le mettre en colère; celui de Célimène etd'Arsinoé, avec tant de coups d'épingle.
Mais le plus remarquable exemple est fourni par Mme Pernelle et Dorine à lapremière scène de Tartuffe, où Mme Pernelle, passant en revue toute la famille, dit à chacun son fait, dans unlangage débordant de dictons, avec cette verve tumultueuse qui prend la tour de Babel pour celle de Babylone.— Enfin n'oublions pas les scènes burlesques : Orgon sous la table, pendant que Tartuffe fait à sa femme une courpressante, et ne se décidant pas à sortir malgré les appels qu'elle lui lance par signes convenus; Martine écorchantjoyeusement la grammaire au grand scandale des « femmes savantes »; Alceste et les petits marquis rivalisantd'endurance, à qui demeurera le dernier dans le salon de la femme qu'ils se disputent; Sganarelle criant : « Mesgages ! mes gages ! » au moment où Don Juan vient d'être englouti par l'abîme; le petit valet Dubois coupant de sonétourderie effarée et niaise la scène la plus douloureuse du Misanthrope.— Il y a, dans les divers moyens et procédés du rire, une hiérarchie.
Les uns s'adressent au public ignorant, lesautres au public cultivé; les uns ne veulent qu'amuser, les autres faire penser et rêver.
Quelques-uns s'adressent àces deux publics.
Leur valeur est évidemment en proportion de leur qualité psychologique.
Si Molière a un méritesuprême, c'est d'avoir créé avec son génie comique certaines situations presque pathétiques à force de véritéhumaine.— Molière a connu le coeur humain et en a fait une peinture méditée; il est un des grands peintres de l'humanité; ill'a peinte dans la diversité de ses catégories sociales, dans la multiplicité de ses caractères individuels, et plusprofondément dans quelques personnalités où l'âme de notre espèce est mise à nu avec ses monstruosités et seslacunes, avec ses bassesses, ses pauvretés, ses douleurs, ses contradictions : au point que le théâtre de Molièredégage en fin de compte, malgré son rire si naturel et si puissant, une impression profonde d'amertume.
C) L'action.— Dans un théâtre aussi évidemment soumis que celui de Molière à la peinture des caractères et des moeurs,l'action doit être simple, claire, d'ailleurs réduite au minimum.— Certaines pièces — Tartuffe, l'Avare, les Femmes savantes — ne prêtent à la critique que par leur dénouement.a) Dans Tartuffe, l'exposition est magistrale : charge endiablée de la mère d'Orgon, Mea Pernelle; questionsanxieuses d'Orgon, rentrant de voyage, sur la santé de son cher Tartuffe.
Et la pièce est une crise à dénouer,comme chez Racine : une solution doit intervenir à tout prix, l'intérêt ne cesse de grandir et nous tient jusqu'au bout en haleine par la lutte entre les deux camps, amis et ennemis du fauxdévot.b) Même aspect de crise et de lutte dans l'Avare et les Femmes savantes.— Mais l'action est d'importance tellement secondaire pour Molière queplusieurs conséquences s'en suivent dans certaines de ses comédies :insuffisance de mouvement scénique, dénouements conventionnels, sans-gêne des emprunts.A) L'action manque par trop de vivacité et s'accommode d'une intriguepresque nulle.
C'est le cas du Misanthrope, le cas du Bourgeois gentilhomme.Une misanthropie qui se développe, une âme qui s'exalte de scène en scène,entre six chaises et sous trois lustres, c'est tout le Misanthrope.D'ans le Bourgeois gentilhomme, pas la moindre action pendant deux actes;l'intrigue qui semble vouloir se nouer au troisième reste pure velléité, puisquele beau Dorante ne songe point à épouser la riche héritière, ni la marquiseDorimène à séduire le bourgeois nouveau riche; enfin la pièce tourne à lafarce et au simple divertissement.Jamais d'ailleurs la peinture de l'homme n'a été plus profonde que dans cesdeux comédies, dans la première surtout, où tout ce qui arrive à Alceste letouche de plus en plus près du coeur, jusqu'au moment où, le coeur percé, ildécide de s'exiler.
B) Plusieurs dénouements sont conventionnels.
Molière ne s'en souciait guère.
Une fois achevée l'étude d'un.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Système dramatique de Molière
- Molière par Thierry Maulnier Des grands écrivains représentatifs de l'art dramatique classique, le plus proprement français est sans doute Racine ; Molière est le plus certainement universel.
- L’École des femmes est une comédie de Molière en cinq actes (comportant respectivement quatre, cinq, cinq, neuf et neuf scènes) et en vers (1779 dont 1737 alexandrins), créée au théâtre du Palais-Royal le 26 décembre 1662. La pièce, novatrice en ce qu'elle mêlait de manière alors inédite les ressources de la farce et de la grande comédie en vers, fut un immense succès, et suscita une série de débats connus sous le nom de « Querelle de L'École des femmes. » Cette querelle, habilement e
- La pensée dramatique de Molière ?
- M. Pierre-Aimé Touchard écrivait dans une étude récente sur Molière : « L’auteur dramatique n’est auteur que parce qu’il est lui-même le théâtre d’un incessant conflit qu’il ne peut ni résoudre ni dépasser, et dont il essaye de se délivrer en l’objectivant, en le dépliant sous nos yeux. » Vous examinerez quelques exemples pour expliquer et au besoin discuter cette assertion.