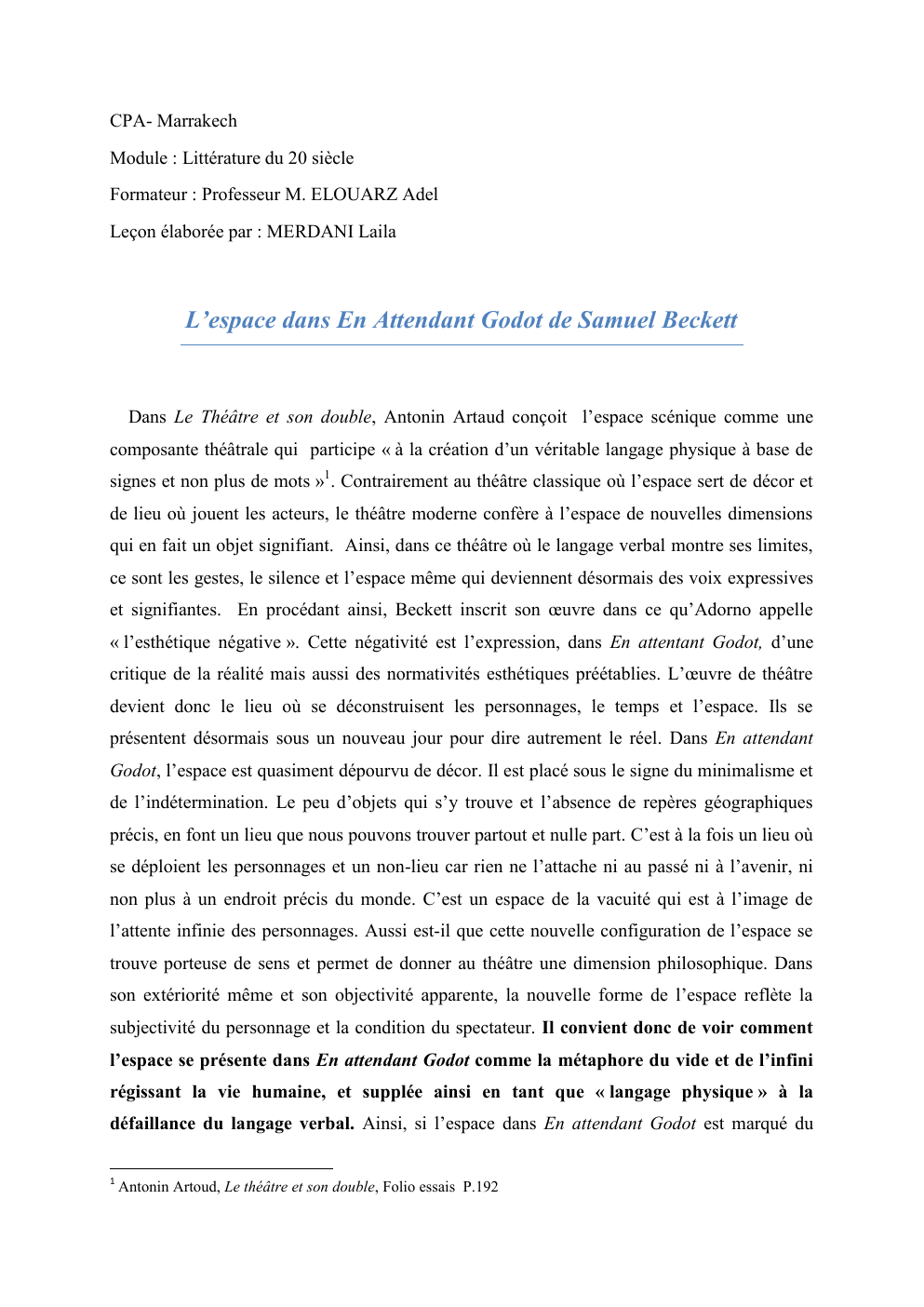Leçon littéraire sur l'espace dans en attendant Godot
Publié le 19/06/2023
Extrait du document
«
L’espace dans En Attendant Godot de Samuel Beckett
Dans Le Théâtre et son double, Antonin Artaud conçoit l’espace scénique comme une
composante théâtrale qui participe « à la création d’un véritable langage physique à base de
signes et non plus de mots »1.
Contrairement au théâtre classique où l’espace sert de décor et
de lieu où jouent les acteurs, le théâtre moderne confère à l’espace de nouvelles dimensions
qui en fait un objet signifiant.
Ainsi, dans ce théâtre où le langage verbal montre ses limites,
ce sont les gestes, le silence et l’espace même qui deviennent désormais des voix expressives
et signifiantes.
En procédant ainsi, Beckett inscrit son œuvre dans ce qu’Adorno appelle
« l’esthétique négative ».
Cette négativité est l’expression, dans En attentant Godot, d’une
critique de la réalité mais aussi des normativités esthétiques préétablies.
L’œuvre de théâtre
devient donc le lieu où se déconstruisent les personnages, le temps et l’espace.
Ils se
présentent désormais sous un nouveau jour pour dire autrement le réel.
Dans En attendant
Godot, l’espace est quasiment dépourvu de décor.
Il est placé sous le signe du minimalisme et
de l’indétermination.
Le peu d’objets qui s’y trouve et l’absence de repères géographiques
précis, en font un lieu que nous pouvons trouver partout et nulle part.
C’est à la fois un lieu où
se déploient les personnages et un non-lieu car rien ne l’attache ni au passé ni à l’avenir, ni
non plus à un endroit précis du monde.
C’est un espace de la vacuité qui est à l’image de
l’attente infinie des personnages.
Aussi est-il que cette nouvelle configuration de l’espace se
trouve porteuse de sens et permet de donner au théâtre une dimension philosophique.
Dans
son extériorité même et son objectivité apparente, la nouvelle forme de l’espace reflète la
subjectivité du personnage et la condition du spectateur.
Il convient donc de voir comment
l’espace se présente dans En attendant Godot comme la métaphore du vide et de l’infini
régissant la vie humaine, et supplée ainsi en tant que « langage physique » à la
défaillance du langage verbal.
Ainsi, si l’espace dans En attendant Godot est marqué du
1
Antonin Artoud, Le théâtre et son double, Folio essais P.192
sceau de la vacuité, il n’en demeure pas moins qu’il se trouve meublé par les personnages eux
même, conçus comme des corps automates, et par leur interaction qui se déploie en des
phrases répétitives et vides de sens.
Cette configuration de l’espace peut se lire également
comme la métaphorisation de la condition humaine en rappelant par la vacuité du lieu et son
cloisonnement, la réalité de l’homme emprisonnée dans ses idéaux
et ses espérances
incertaines.
L’espace scénique marqué du sceau de la vacuité
I-
1- L’espace entre vacuité, cloisonnement et infini
2- L’espace entre l’ici et l’ailleurs : de la scène à l’hors-scène
3- L’espace et la dialectique de la cyclicité et du changement
II-
Du non-lieu scénique à l’espace meublé autrement
1- Les personnages automates ou le corps comme élément du décor
2- Le dialogue creux ou la mise en espace des mots
3- L’arbre et la route au-delà de la fonction référentielle
III-
La configuration spatiale ou la métaphore de la condition humaine
1- La correspondance entre l’espace réel et l’espace dramatique
2- L’espace : lieu de l’attente éternelle
3- L’espace clos : de l’impossibilité de la mise en scène à l’impossibilité de
l’avenir
Dans En attendant Godot, l’espace scénique est placé sous le signe de la vacuité.
La
quasi-absence de décor en fait un espace vide et infini.
Pourtant, il est aussi un espace clos
d’où les personnages ne peuvent s’échapper.
L’absence de repères est supplée par l’horsscène présentant un ailleurs qui existe mais qui reste inaccessible aux personnages principaux.
Par ailleurs, la vacuité de cet espace est cernable dans la dialectique de la cyclicité et du
changement qui structure la pièce.
Le spectateur et le lecteur habitués à voir ou à lire des pièces classiques, trouveront dans
l’espace peu familier d’ En ettenant Godot, le signe et la volonté de mettre en scène le vide
même.
Les indications spatiales que nous livre le dramaturge au début des deux actes
permettent de voir sa propension au minimalisme.
Le premier acte commence ainsi :
« Route à la compagne, avec arbre.
Soir.
Estragon, assis sur une pierre, essaie d’enlever sa chaussure… »2
Le deuxième acte reprend les mêmes éléments et y ajoute d’autres :
« Lendemain.
Même heure.
Même endroit.
Chaussures d’Estragon près de la rampe, talons joints, bouts écartés.
Chapeau de Lucky à la
même place.
L’arbre porte quelques feuilles.
3
A partir de ces indications, le lecteur se figure la scène comme un espace vague puisque rien
ne le délimite.
C’est aussi un espace qui se dessine comme sombre et sinistre.
En effet,
l’indication « soir » et la scène d’Estragon assis sur une pierre essayant d’enlever sa
chaussure, nous met d’emblée face à un espace où règnent le vide et le silence.
Le décor se
limite à des accessoires dont la petitesse ne fait qu’accentuer la vacuité.
Ces accessoires
permettent ainsi que l’arbre de circonscrire la scène qui sera le lieu où se meuvent les
personnages.
En effet, leurs mouvements au cours de la pièce laissent voir l’espace comme un
endroit clos, bien qu’ils se trouvent sur une ‘‘route’’ menant à la ‘’compagne’’.
Ainsi,
l’espace scénique est à la fois signe de la fermeture et de l’infini.
Il est également signe de
l’indétermination et de la coupure puisqu’il est dépourvu de repères géographiques et
temporels.
Ces éléments en font un espace-monde sans limites constituant le lieu d’une action
qui se déroule en dehors des frontières du temps et de l’espace et qui s’inscrit de la sorte dans
une dramaturgie de l’inachèvement.
Cet inachèvement est suggéré également dans la pièce
par le hors-scène et le rapport qu’il permet d’établir entre l’ici et l’ailleurs.
Dans En attendant Godot, l’espace est double.
Il y a la scène où jouent les personnages
et le hors-scène d’où viennent et auquel partent d’autres personnages.
Ainsi, l’espace vide et
dépourvu de vie se laisse identifier par l’ailleurs.
Bien plus, c’est l’ailleurs qui donne à l’ici
son sens et sa raison d’être.
L’espace où se trouvent Vladimir et Estragon est un espace de
l’attente qui se définit comme tel par rapport à l’hors-scène où Godot est censé se trouver.
Les
personnages velléitaires veulent à maintes reprises quitter ce lieu avant de se rappeler le motif
de leur attente.
Par ailleurs, l’existence de cet ailleurs ne fait qu’accentuer l’aspect de la
fermeture de l’espace où se trouvent les personnages.
En effet, l’arrivée de Pozzo, de Lucky et
2
3
Samuel Beckett, En attendant Godot, Les Editions De Minuit, p.9
Op.cit., p.74
de l’enfant messager, rappelle aux acteurs prisonniers dans leur espace, qu’il existe un autre
lieu qui leur est inaccessible.
Ainsi, ce n’est que la présence des autres qui les soustraits,
relativement, à leur l’insignifiance et permet, par moment, à leur espace d’échapper à la
vacuité.
Cependant, l’arrivée de Pozzo et lucky est vite oubliée, comme d’ailleurs les
personnages doivent à chaque fois se rappeler mutuellement l’attente de Godot.
La défaillance
de leur mémoire met ainsi à mal la présence du hors-scène qui se trouve souvent sujet à
l’oubli.
Estragon oublie même qu’ils étaient dans le même endroit avant.
C’est Vladimir qui
se charge de le lui rappeler en lui faisant indiquer l’arbre.
L’espace est ainsi loin d’être un lieu
fixe reconnu comme immuable par les personnages.
Il est plutôt mouvant puisqu’il nous est
également présenté sous le prisme des personnages.
C’est d’ailleurs pour cette raison que sa
représentation oscille entre cyclicité et changement.
L’espace scénique dans En attendant Godot est un espace qui échappe à la description.
Le
décor scénique de l’arbre est l’élément démarcatif qui le définit et permet de le distinguer
dans les deux actes.
Cependant, au lieu de remplir l’espace, l’arbre sert plutôt à percer à jour
sa vacuité.
L’arbre joue le rôle d’un décor qui suggère le passage du temps mais qui permet
également de voir dans le changement une certaine permanence.
Le changement du décore st
assuré dans la pièce par « les fleurs » que porte l’arbre.
Ce changement contraste avec
l’immobilité et la stagnation qui caractérise le mouvement des personnages.
Cyclicité et
changement ne s’excluent pas dans la pièce.
Ils représentent deux facettes du monde, du
temps et de l’espace et qui, même en s’opposant, ne peuvent pas être séparés.
Cette idée est
exprimée de manière suggestive par Estragon à la page 78 : « on ne descend pas deux fois
dans le même pus ».
Cette réplique à tournure proverbiale ne va pas sans rappeler la fameuse
phrase d’Héraclite « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ».
Le pastiche est
clair à travers la reprise de la même structure, mais il se distingue par le changement de
quelques mots.
La phrase d’Héraclite renvoie à la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Synthèse littéraire - En attendant Godot de Samuel Beckett
- Dissertation Littéraire : Le Décor C'est Les Mots, Dans En Attendant Godot
- EN attendant GODOT de Samuel Beckett (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- En attendant Godot de Samuel Beckett (analyse détaillée)
- Fiche de lecture : En attendant Godot