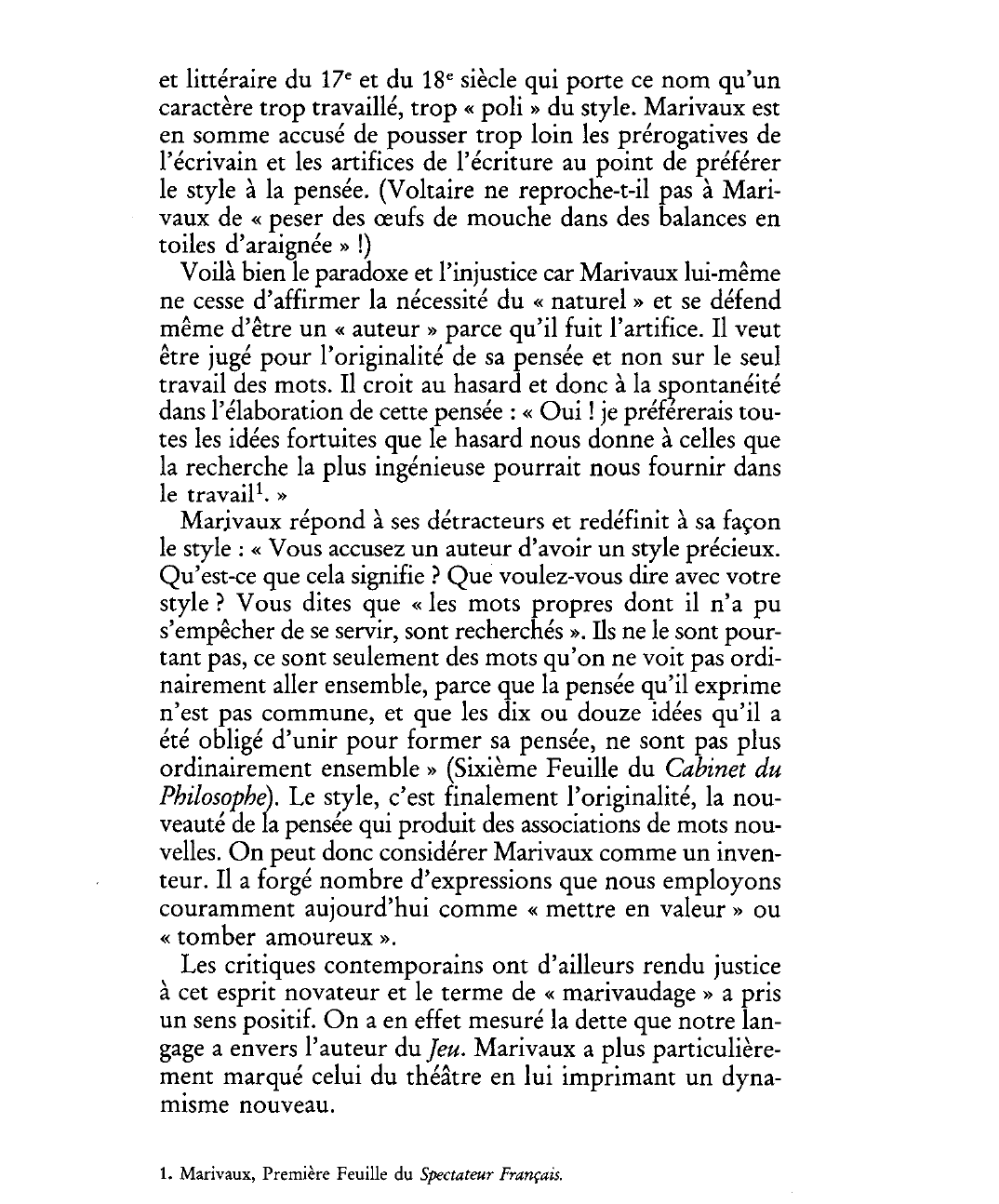L'écriture théâtrale chez Marivaux
Publié le 29/06/2015

Extrait du document

·
C'est en effet moins la subtilité que le mouvement qui définit ce théâtre. Le spectateur de Marivaux a le sentiment de voyager, du début à la fin de la pièce, dans une spirale au déroulement quasi continu. Les situations ne sont jamais durablement bloquées. Leur progrès traduit au contraire l'évolution des sentiments, des jugements, des relations humaines. Cette dynamique, perceptible de scène en scène, l'est aussi de réplique en réplique. Le dialogue, dans lequel Marivaux est passé maître, est le coeur de ce mouvement.
· La réplique
Parler, dans le théâtre de Marivaux, c'est le plus souvent répondre, réagir en prenant les mots au vol. Il faut donc donner au mot « réplique « son sens premier et plein.
Dans le Jeu de l'amour et du hasard, la réplique est marquée par sa brièveté. Elle est composée, le plus souvent, de deux ou trois phrases courtes. Les répliques plus longues sont des exceptions remarquables. Par exemple, celle dans laquelle M. Orgon donne lecture de la lettre du père de Dorante est une étape indispensable de l'exposition (I, 4). Tout aussi exceptionnelles et nécessaires, les tirades de Silvia scandent les temps forts de la pièce. Elles traduisent son désir de se justifier face à Dorante (II, 9) ou sonpère (II, 11), sa joie (III,
Un autre caractère de la réplique type de cette comédie est la place tenue par l'exclamation et l'interrogation. Ces deux modalités illustrent, par leur fréquence exceptionnelle, les surprises et les doutes qui s'emparent de personnages jamais en repos. Ainsi Silvia, dans la scène 11 de l'acte II, multiplie les questions qui traduisent à la fois son trouble, son indignation et son désir de vérité : « ... Mais que fais-je ? de quoi m'accuse-t-on ? Instruisez-moi, je vous en conjure ; cela est-il sérieux ? Me joue-t-on ? se moque-t-on de moi ? Je ne suis pas tranquille. «

«
et littéraire du 17e et du 18e siècle qui porte ce nom qu'un
caractère trop travaillé, trop « poli » du style.
Marivaux est
en somme accusé de pousser
trop loin les prérogatives de
l'écrivain et les artifices de l'écriture au
point de préférer
le style à la pensée.
(Voltaire ne reproche-t-il pas à Mari
vaux de
parce qu'il fuit l'artifice.
Il veut
être jugé
pour l'originalité de sa pensée et non sur le seul
travail
des mots.
Il croit au hasard et donc à la svontanéité
dans l'élaboration de cette pensée : >
Marivaux répond à ses détracteurs et redéfinit à sa façon
le style:.
lls ne le sont pour
tant pas,
ce sont seulement des mots qu'on ne voit pas ordi
nairement aller ensemble, parce que
la pensée qu'il exprime
n'est pas commune, et que les dix ou douze idées qu'il a
été obligé
d'unir pour former sa pensée, ne sont pas plus
ordinairement ensemble
>> (Sixième Feuille du Cabinet du
Philosophe).
Le style, c'est finalement l'originalité, la nou
veauté
de Îa pensée qui produit des associations de mots nou
velles.
On peut donc considérer Marivaux comme un inven
teur.
Il a forgé nombre d'expressions que nous employons
couramment aujourd'hui comme
> ou
>.
Les critiques contemporains ont d'ailleurs rendu justice
à cet esprit novateur et
le terme de > a pris
un sens positif.
On a en effet mesuré la dette que notre lan
gage a envers l'auteur du Jeu.
Marivaux a plus particulière
m~nt marqué celui du théStre en lui imprimant un dyna
misme nouveau.
1.
Marivaux, Première Feuille du Spectateur Français.
58.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les Fausses Confidences, Marivaux (1737) - Résumé de la pièce
- Marivaux - les fausses confidences (1737) scène 14 - acte I
- Lecture linéaire : Le piège d’Araminte. Acte II scène 13, Les fausses Confidences, Marivaux
- Mémoire, histoire et écriture dans l'invention du désert
- La princesse de Clèves: En quoi cette scène de bal est-elle théâtrale ?