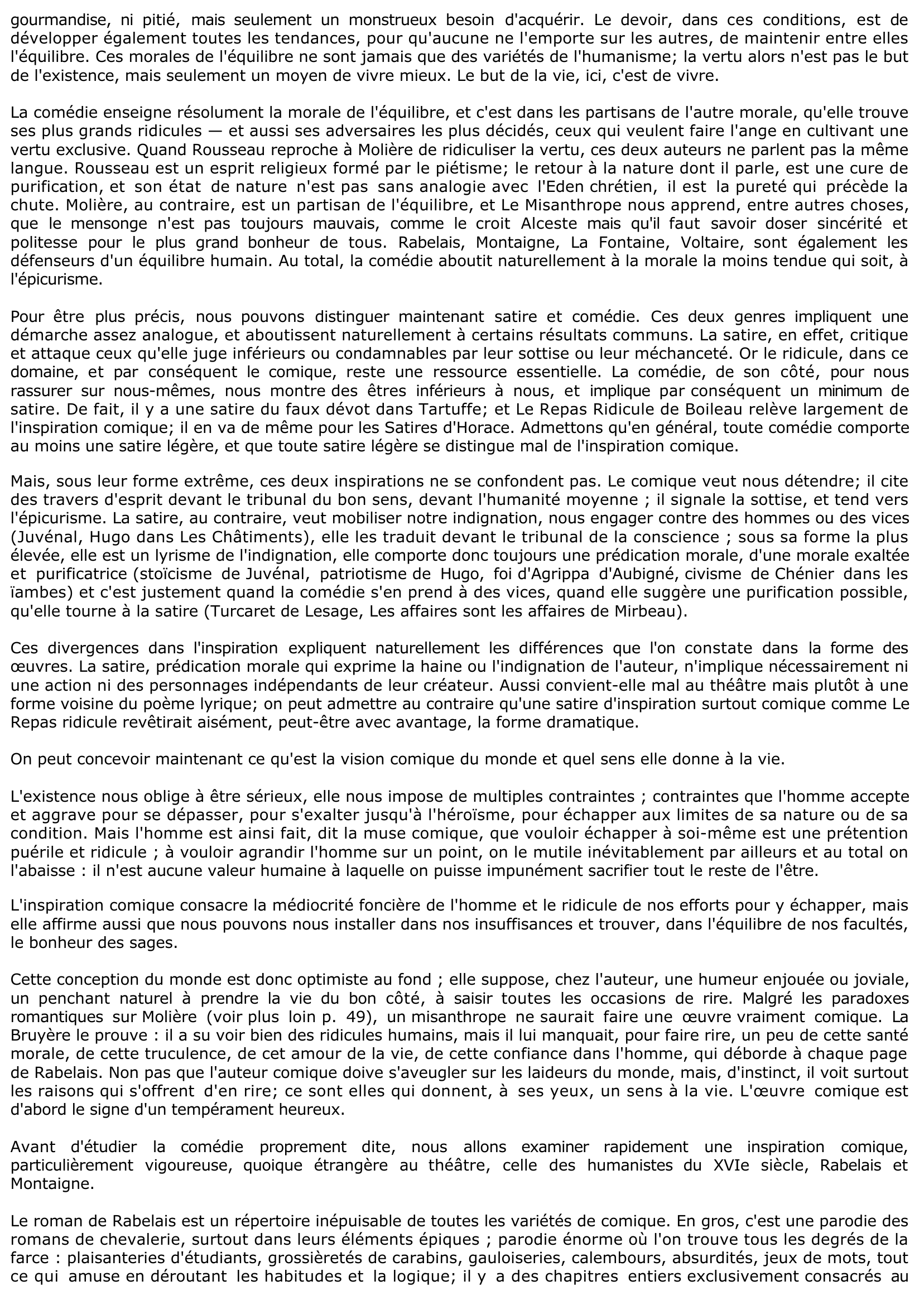L'ENSEIGNEMENT DE LA COMÉDIE
Publié le 06/04/2011

Extrait du document
L'auteur comique peut-il conférer à son œuvre cette pureté, cette harmonieuse résonance, qui distinguent la poésie de la réalité? Ce n'est pas impossible. Rabelais, Musset, La Fontaine, Aristophane, Shakespeare, nous font au moins entrevoir un monde allègre et coloré, plein de verve, où pétillent la fantaisie et l'humour, où la bouffonnerie même, sans perdre de sa truculence, échappe à la vulgarité; un monde un peu fou de carnaval, où les hommes parlent sous le déguisement des bêtes, où Gargantua mange des pèlerins en salade, où Fantasio enlève la perruque du prince de Mantoue. La poésie comique devrait créer une gaieté pure de toute amertume quelque chose comme l'ambiance des anciennes Dionysies, une symphonie, plus ou moins tumultueuse, de toutes les ressources du rire.
«
gourmandise, ni pitié, mais seulement un monstrueux besoin d'acquérir.
Le devoir, dans ces conditions, est dedévelopper également toutes les tendances, pour qu'aucune ne l'emporte sur les autres, de maintenir entre ellesl'équilibre.
Ces morales de l'équilibre ne sont jamais que des variétés de l'humanisme; la vertu alors n'est pas le butde l'existence, mais seulement un moyen de vivre mieux.
Le but de la vie, ici, c'est de vivre.
La comédie enseigne résolument la morale de l'équilibre, et c'est dans les partisans de l'autre morale, qu'elle trouveses plus grands ridicules — et aussi ses adversaires les plus décidés, ceux qui veulent faire l'ange en cultivant unevertu exclusive.
Quand Rousseau reproche à Molière de ridiculiser la vertu, ces deux auteurs ne parlent pas la mêmelangue.
Rousseau est un esprit religieux formé par le piétisme; le retour à la nature dont il parle, est une cure depurification, et son état de nature n'est pas sans analogie avec l'Eden chrétien, il est la pureté qui précède lachute.
Molière, au contraire, est un partisan de l'équilibre, et Le Misanthrope nous apprend, entre autres choses,que le mensonge n'est pas toujours mauvais, comme le croit Alceste mais qu'il faut savoir doser sincérité etpolitesse pour le plus grand bonheur de tous.
Rabelais, Montaigne, La Fontaine, Voltaire, sont également lesdéfenseurs d'un équilibre humain.
Au total, la comédie aboutit naturellement à la morale la moins tendue qui soit, àl'épicurisme.
Pour être plus précis, nous pouvons distinguer maintenant satire et comédie.
Ces deux genres impliquent unedémarche assez analogue, et aboutissent naturellement à certains résultats communs.
La satire, en effet, critiqueet attaque ceux qu'elle juge inférieurs ou condamnables par leur sottise ou leur méchanceté.
Or le ridicule, dans cedomaine, et par conséquent le comique, reste une ressource essentielle.
La comédie, de son côté, pour nousrassurer sur nous-mêmes, nous montre des êtres inférieurs à nous, et implique par conséquent un minimum desatire.
De fait, il y a une satire du faux dévot dans Tartuffe; et Le Repas Ridicule de Boileau relève largement del'inspiration comique; il en va de même pour les Satires d'Horace.
Admettons qu'en général, toute comédie comporteau moins une satire légère, et que toute satire légère se distingue mal de l'inspiration comique.
Mais, sous leur forme extrême, ces deux inspirations ne se confondent pas.
Le comique veut nous détendre; il citedes travers d'esprit devant le tribunal du bon sens, devant l'humanité moyenne ; il signale la sottise, et tend versl'épicurisme.
La satire, au contraire, veut mobiliser notre indignation, nous engager contre des hommes ou des vices(Juvénal, Hugo dans Les Châtiments), elle les traduit devant le tribunal de la conscience ; sous sa forme la plusélevée, elle est un lyrisme de l'indignation, elle comporte donc toujours une prédication morale, d'une morale exaltéeet purificatrice (stoïcisme de Juvénal, patriotisme de Hugo, foi d'Agrippa d'Aubigné, civisme de Chénier dans lesïambes) et c'est justement quand la comédie s'en prend à des vices, quand elle suggère une purification possible,qu'elle tourne à la satire (Turcaret de Lesage, Les affaires sont les affaires de Mirbeau).
Ces divergences dans l'inspiration expliquent naturellement les différences que l'on constate dans la forme desœuvres.
La satire, prédication morale qui exprime la haine ou l'indignation de l'auteur, n'implique nécessairement niune action ni des personnages indépendants de leur créateur.
Aussi convient-elle mal au théâtre mais plutôt à uneforme voisine du poème lyrique; on peut admettre au contraire qu'une satire d'inspiration surtout comique comme LeRepas ridicule revêtirait aisément, peut-être avec avantage, la forme dramatique.
On peut concevoir maintenant ce qu'est la vision comique du monde et quel sens elle donne à la vie.
L'existence nous oblige à être sérieux, elle nous impose de multiples contraintes ; contraintes que l'homme accepteet aggrave pour se dépasser, pour s'exalter jusqu'à l'héroïsme, pour échapper aux limites de sa nature ou de sacondition.
Mais l'homme est ainsi fait, dit la muse comique, que vouloir échapper à soi-même est une prétentionpuérile et ridicule ; à vouloir agrandir l'homme sur un point, on le mutile inévitablement par ailleurs et au total onl'abaisse : il n'est aucune valeur humaine à laquelle on puisse impunément sacrifier tout le reste de l'être.
L'inspiration comique consacre la médiocrité foncière de l'homme et le ridicule de nos efforts pour y échapper, maiselle affirme aussi que nous pouvons nous installer dans nos insuffisances et trouver, dans l'équilibre de nos facultés,le bonheur des sages.
Cette conception du monde est donc optimiste au fond ; elle suppose, chez l'auteur, une humeur enjouée ou joviale,un penchant naturel à prendre la vie du bon côté, à saisir toutes les occasions de rire.
Malgré les paradoxesromantiques sur Molière (voir plus loin p.
49), un misanthrope ne saurait faire une œuvre vraiment comique.
LaBruyère le prouve : il a su voir bien des ridicules humains, mais il lui manquait, pour faire rire, un peu de cette santémorale, de cette truculence, de cet amour de la vie, de cette confiance dans l'homme, qui déborde à chaque pagede Rabelais.
Non pas que l'auteur comique doive s'aveugler sur les laideurs du monde, mais, d'instinct, il voit surtoutles raisons qui s'offrent d'en rire; ce sont elles qui donnent, à ses yeux, un sens à la vie.
L'œuvre comique estd'abord le signe d'un tempérament heureux.
Avant d'étudier la comédie proprement dite, nous allons examiner rapidement une inspiration comique,particulièrement vigoureuse, quoique étrangère au théâtre, celle des humanistes du XVIe siècle, Rabelais etMontaigne.
Le roman de Rabelais est un répertoire inépuisable de toutes les variétés de comique.
En gros, c'est une parodie desromans de chevalerie, surtout dans leurs éléments épiques ; parodie énorme où l'on trouve tous les degrés de lafarce : plaisanteries d'étudiants, grossièretés de carabins, gauloiseries, calembours, absurdités, jeux de mots, toutce qui amuse en déroutant les habitudes et la logique; il y a des chapitres entiers exclusivement consacrés au.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- APPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT DE LA LANGE
- Activité enseignement scientifique sur les méthodes de stockage de l'énergie
- Enseignement scientifique : la méthanisation
- La pudeur, écho du Jardin d'Eden (TFE, enseignement)
- Albert Cohen – Belle du Seigneur: En quoi peut- on dire que cette scène s’apparente à une scène de comédie ?