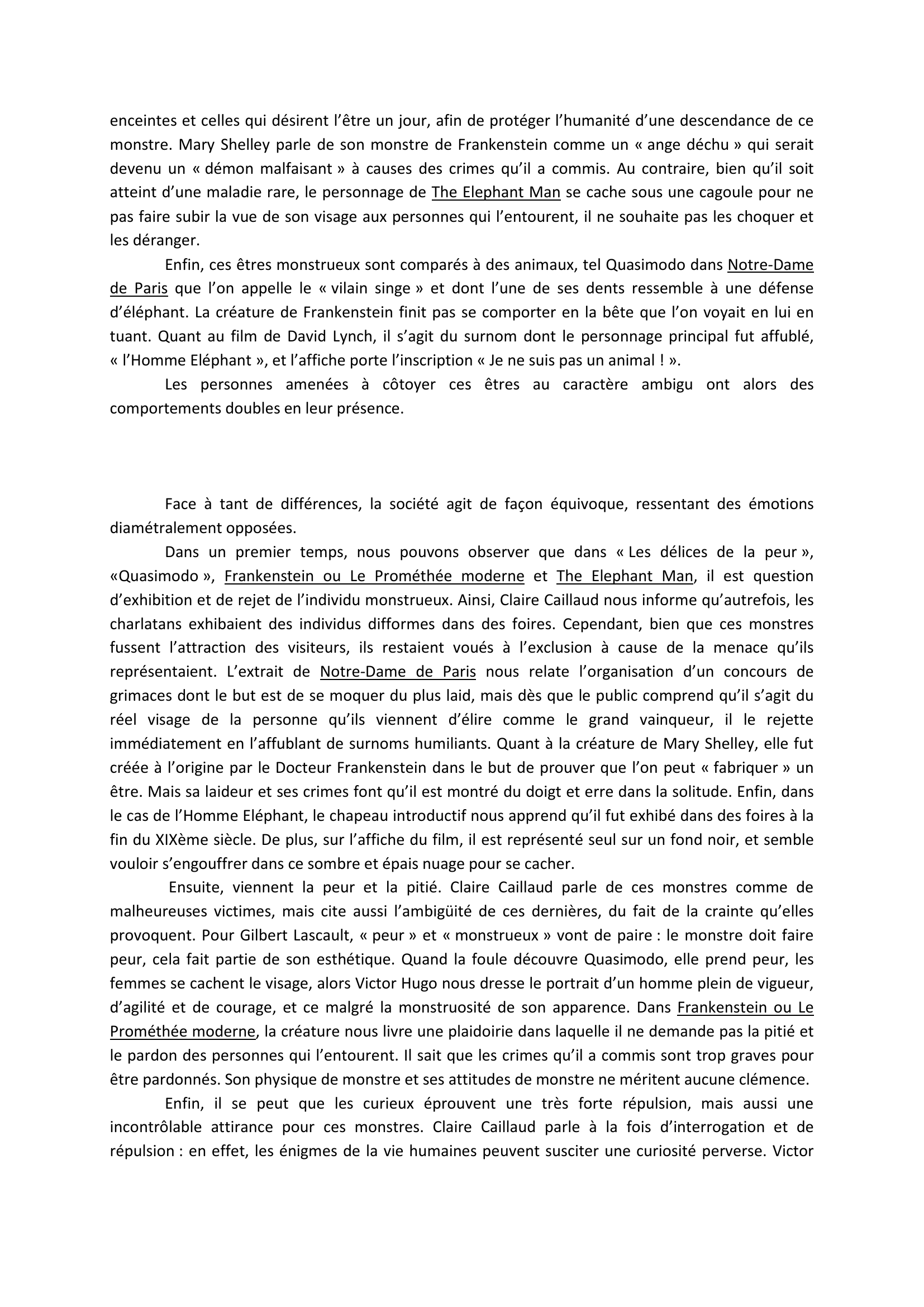LES MONSTRES
Publié le 21/02/2012

Extrait du document
Légendes, fictions, ou récits tirés d’histoires vraies, les représentations des monstres ont toujours fasciné. Le premier document, un article de Claire Caillaud intitulé « Les délices de la peur « et tiré de Textes et documents pour la classe, nous dresse une analyse de l’ambivalence des monstres. Le second document est un article de Gilbert Lascault de l’Encyclopaedia Universalis, « Monstres (Esthétique) «, et nous donne une définition de ce que sont les monstres et de leur représentation au sein du monde artistique. Ensuite, la documentation nous livre deux extraits de récits célèbres : le premier est « Quasimodo « de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et rédigé en 1831, quant au second, il s’agit d’un passage de Frankenstein ou Le Prométhée moderne de Mary Shelley, datant de 1817. Enfin, le dernier document est une affiche du film The Elephant Man, réalisé en 1980 par David Lynch.
«
enceintes et celles qui désirent l’être un jour, afin de protéger l’humanité d’une descendance de ce
monstre.
Mary Shelley parle de son monstre de Frankenstein comme un « ange déchu » qui serait
devenu un « démon malfaisant » à causes des crimes qu ’il a commis.
Au contraire, bien qu’il soit
atteint d’une maladie rare, le personnage de The Elephant Man se cache sous une cagoule pour ne
pas faire subir la vue de son visage aux personnes qui l’entourent, il ne souhaite pas les choquer et
les déranger.
Enfin, ces êtres monstrueux sont comparés à des animaux, tel Quasimodo dans Notre -Dame
de Paris que l’on appelle le « vilain singe » et dont l’une de ses dents ressemble à une défense
d’éléphant.
La créature de Frankenstein finit pas se comporter en la bêt e que l’on voyait en lui en
tuant.
Quant au film de David Lynch, il s’agit du surnom dont le personnage principal fut affublé,
« l’Homme E léphant », et l’affiche porte l’inscription « Je ne suis pas un animal ! ».
Les personnes amenées à côtoyer ces êtres au caractère ambigu ont alors des
comportements doubles en leur présence.
Face à tant de différences, la société agit de façon équivoque, ressentant des émotions
diamétralement opposées.
Dans un premier temps, nous pouvons observer que dans « Les déli ces de la peur »,
«Quasimodo », Frankenstein ou Le Prométhée moderne et The Elephant Man , il est question
d’exhibition et de rejet de l’individu monstrueux.
Ainsi, Claire Caillaud nous informe qu’autrefois, les
charlatans exhibaient des individus difformes dans d es foires.
Cependant, bien que ces monstres
fussent l’attraction des visiteurs, ils restaient voués à l’exclusion à cause de la menace qu’ils
représentaient.
L’extrait de Notre-Dame de Paris nous relate l’organisation d’un concours de
grimaces dont le but est de se moquer du plus laid, mais dès que le public comprend qu’il s’agit du
réel visage de la personne qu’ils viennent d’élire comme le grand vainqueur, il le rejette
immédiatement en l’affublant de surnoms humiliants.
Quant à la créature de Mary Shelley, elle fut
créée à l’origine par le Docteur Frankenstein dans le but de prouver que l’on peu t « fabriquer » un
être.
Mais sa laideur et ses crimes font qu’il est montré du doigt et er re dans la solitude.
Enfin, dans
le cas de l’Homme Eléphant, le c hapeau introductif nous apprend qu’ il fut exhibé dans des foires à la
fin du XIXème siècle.
De plus, sur l’affiche du film, il est représenté seul sur un fond noir, et semble
vouloir s’engouffrer dans ce sombre et épais nuage pour se cacher.
Ensuite, viennent la peur et la pitié.
Claire Caillaud parle de ces monstres comme de
malheureuses victimes, mais cite aussi l’ambigüité de ces dernières, du fait de la crainte qu’elles
provoquent.
Pour Gilbert Lascault, « peur » et « monstrueux » vont de paire : l e monstre doit faire
peur, cela fait partie de son esthétique.
Quand la foule découvre Quasimodo, elle prend peur, les
femmes se cachent le visage, alors Victor Hugo nous dresse le portrait d’un homme plein de vigueur,
d’ agilité et de courage, et ce malgré la monstruosité de son apparence.
Dans Frankenstein ou Le
Prométhée moderne, la créature nous livre une plaidoirie dans laquelle il ne demande pas la pitié et
le pardon des personnes qui l’entourent.
Il sait que les crimes qu’ il a commis son t trop graves pour
être pardonnés.
Son physique de mons tre et ses attitudes de monstre ne méritent aucune clémence.
Enfin, il se peut que les curieux éprouvent une très forte répulsion, mais aussi une
incontrôlable attirance pour ces monstres.
Claire Caillaud parle à la fois d’interrogation et de
répulsion : en effet, les énigmes de la vie humaines peuvent susciter une curiosité perverse.
Victor.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- altérité & les monstres
- MONSTRES SACRÉS (Les). (résumé)
- L’Etat, c’est le plus froid des monstres froids Nietzsche
- Le monde des dieux, des héros et des monstres
- Que pensez-vous de ce jugement porté en 1859 par Baudelaire sur le réalisme : « Dans ces derniers temps nous avons entendu dire de mille manières différentes : « Copiez la nature; ne copiez que la nature. Il n'y a pas de plus grande jouissance ni de plus beau triomphe qu'une copie excellente de la nature. » Et cette doctrine, ennemie de l'art, prétendait être appliquée non seulement à la peinture, mais à tous les arts, même au roman, même à la poésie. A ces doctrinaires si satisfaits d