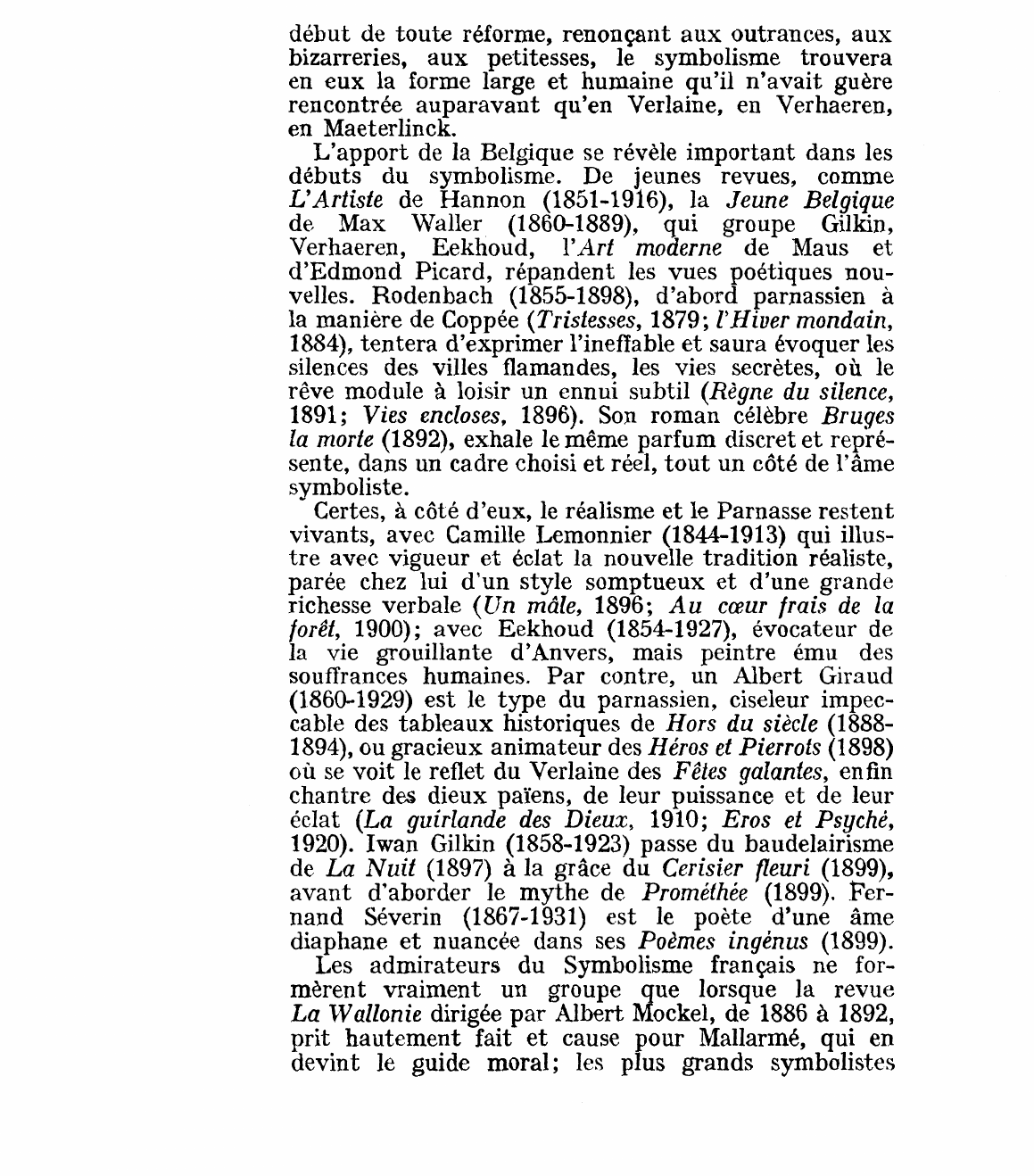Les poètes symbolistes
Publié le 27/06/2012

Extrait du document
En 1886, les aînés, Villiers de l'Isle-Adam, Verlaine, Mallarmé, sont encore là, certains au sommet de leur art; plus jeunes, Rodenbach, Verhaeren, Moréas, Samain, Gustave Kahri, Laforgue, âgés de vingt-six à trente ans, ont déjà donné quelques oeuvres. D'autres enfin ne se feront connaître qu'après cette date : Van Lerberghe, Dujardin, Saint-Pol-Roux, René Ghil, Maeterlinck, Stuart Merril, Henri de Régnier, ViéléGriffin, Ephraïm Mikhaël; ils ont alors de vingt et un à vingt-cinq ans. Héritiers directs du Symbolisme, viendront enfin, nés entre 1868 et 1872, quelques très grands poètes dont la gloire effacera le renom de la plupart de ceux que nous venons de citer, Claudel, Jammes, Valéry, Paul Fort, auxquels on peut ajouter André Gide, qui débuta comme poète. Dépouillé de ses intentions démonstratives, dégagé de la polémique nécessaire au début de toute réforme, renonçant aux outrances, aux bizarreries, aux petitesses, le symbolisme trouvera en eux la forme large et humaine qu'il n'avait guère rencontrée auparavant qu'en Verlaine, en Verhaeren, en Maeterlinck.
«
LE SYMBOLISME EN BELGIQUE 579
début de toute réforme, renonçant aux outrances, aux bizarreries, aux petitesses, le symbolisme trouvera en eux la forme large et humaine qu'il n'avait guère rencontrée auparavant qu'en Verlaine, en Verhaeren, en Maeterlinck.
L'apport de la Belgique se révèle important dans les débuts du symbolisme.
De jeunes revues, comme L'Artiste de Hannon (1851-1916), la Jeune Belgique de Max Waller (1860-1889), qui groupe Gilkin,
Verhaeren, Eekhoud, l'Art moderne de Maus et d'Edmond Picard, répandent les vues poétiques nou velles.
Rodenbach (1855-1898), d'abord parnassien à
la manière de Coppée (Tristesses, 1879; l'Hiver mondain, 1884), tentera d'exprimer l'ineffable et saura évoquer les
silences des villes flamandes, les vies secrètes, où le
rêve module à loisir un ennui subtil (Règne du silence, 1891; Vies encloses, 1896).
Son roman célèbre Bruges la morte (1892), exhale le même parfum discret et repré
sente, dans un cadre choisi et réel, tout un côté de l'âme symboliste.
Certes, à côté d'eux, le réalisme et le Parnasse restent vivants, avec Camille Lemonnier (1844-1913) qui illus tre avec vigueur et éclat la nouvelle tradition réaliste,
parée chez lui d'un style somptueux et d'une grande richesse verbale (Un mâle, 1896; Au cœur frais de la forêt, 1900); avec Eekhoud (1854-1927), évocateur de la vie grouillante d'Anvers, mais peintre ému des
souffrances humaines.
Par contre, un Albert Giraud (1860-1929) est le type du parnassien, ciseleur impec
cable des tableaux historiques de Hors du siècle (1888-
1894), ou gracieux animateur des Héros et Pierrots (1898) où se voit le reflet du Verlaine des Fêtes galantes, enfin chantre des dieux païens, de leur puissance et de leur éclat (La guirlande des Dieux, 1910; Eros et Psyché, 1920).
Iwan Gilkin (1858-1923) passe du baudelairisme
de La Nuit (1897) à la grâce du Cerisier fleuri (1899), avant d'aborder le mythe de Prométhée (1899).
Fer nand Séverin (1867-1931) est le poète d'une âme diaphane et nuancée dans ses Poèmes ingénus (1899).
Les admirateurs du Symbolisme français ne for mèrent vraiment un groupe que lorsque la revue La Wallonie dirigée par Albert Mockel, de 1886 à 1892, prit hautement fait et cause pour Mallarmé, qui en devint le guide moral; les plus grands symbolistes.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pierre de Ronsard (1524-1585) "Le prince des poètes, le poète des princes"
- Les poètes sont de grands menteurs
- DÉSHONNEUR DES POÈTES (le)
- POÈTES MAUDITS (Les) de Paul-Marie Verlaine (résumé et analyse de l’oeuvre)
- Charles de Villers, De la manière essentiellement différente dont les poètes français et les allemands traitent l'amour