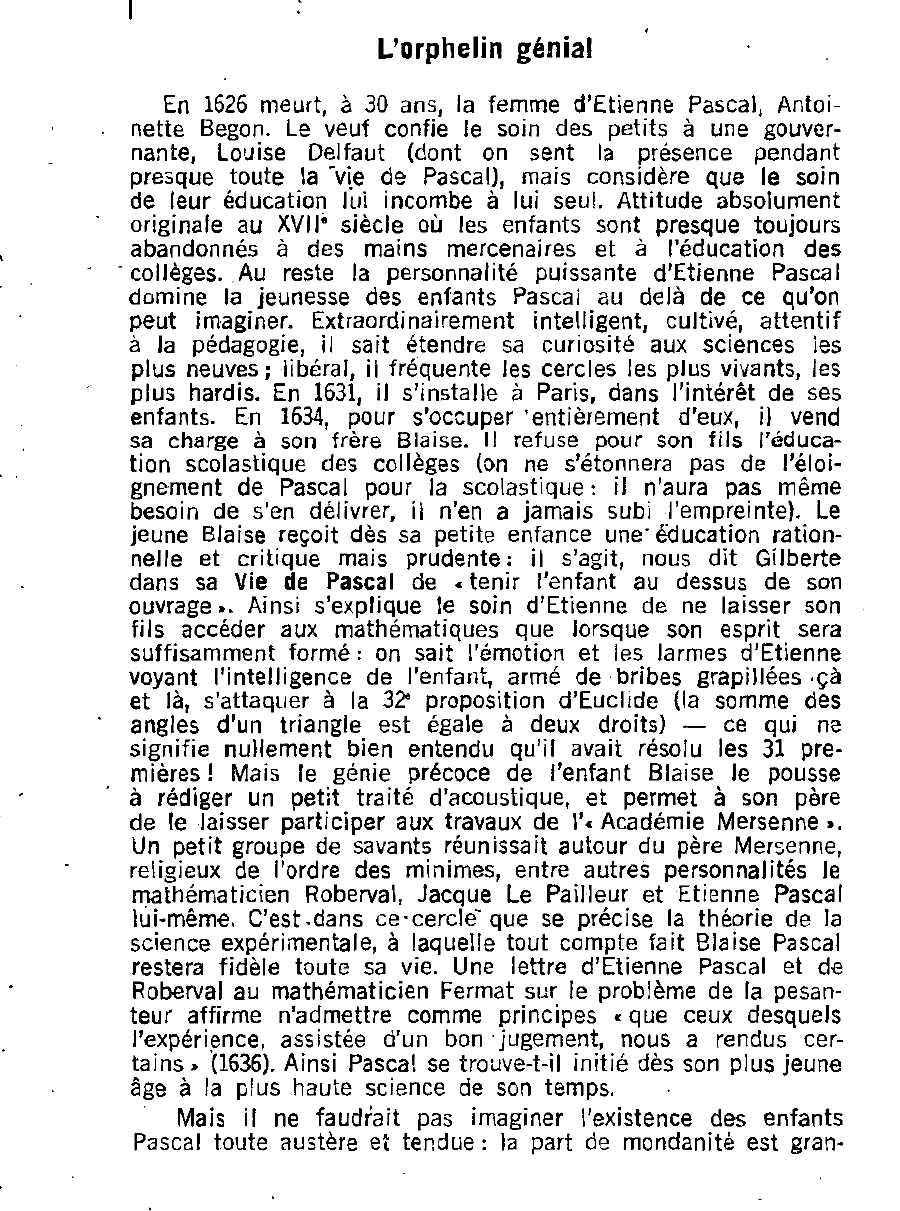L'oeuvre de PASCAL
Publié le 29/03/2012

Extrait du document

(1623-1662)
Les robins de Clermont-Ferrand
Blaise Pascal est originaire d'une famille d'officiers royaux, auxquels se mêle une pro.portion non négligeable de commerçants: bonne bourgeoisie donc, ayant pignon sur rue, suffisamment d'argent pour que les problèmes financiers ne se posent guère aux membres de la famille, et une position sociale proche de la noblesse, même avant l'anoblissement du père de Pascal, Etienne Pascal. Dans un acte officiel, Blaise est dit écuyer, titre noble. Le grand-père, Martin Pascal, est receveur des tailles en 1584, conseiller du roi et général de finances pour la généralité de Riom en 1586. Il a 7 enfants dont l'aîné, Etienne, né en 1588, se marie en 1616, et a trois enfants : Gilberte, née en 1620, Blaise, né le 19 juin 1623, Jacqueline, née en 1625. En 1624, Etienne achète 30.000 livres, chiffre normal; la charge de la président à la Cour des aides. Il possède des propriétés terriennes de bon rapport. Il fait partie de l'élite bourgeoise de Clermont. Il habite un bel et sobre hôtel particulier, l'hôtel de Vernines, dans cette ville relativement cossue, où avec une richesse confortable et discrète coexistent la misère, la maladie, les famines et les épidémies qui forment le fond très sombre de la vie quotidienne au XVIIe siècle. La famille Pascal mène une existence aisée mais charitable et sans faste, caractéristique de la classe et du groupe social auxquels elle appartient. Certains de ses membres ont été huguenots à la fin du siècle précédent, mais la plupart sont rentrés dans le giron du catholicisme, et la piété est de règle dans un milieu qui sera particulièrement perméable à l'influence du jansénisme. Les amis des Pascal à Clermont sont des intellectuels et des gens de robe: Jean Savaron, député du Tiers aux Etats généraux, et le jurisconsulte Domat.

«
184 MANUEL D'HISTOIRE LITT.ERAIRE DE LA FRANCE
L'orphelin génial
En 1626 meurt, à 30 ans, la femme d'Etienne Pascal, Antoi nette Begon.
Le veuf confie le soin des petits à une gouver nante, Louise Delfaut (dont on sent la présence pendant
presque toute la ·vi_e de Pascal), mais considère que le soin de leur éducation lui incombe à lui seul.
Attitude absolument
originale au XVII' siècle où les enfants sont presque toujours
abandonnés à des mains mercenaires et à l'éducation des ·collèges ..
Au reste la personnalité puissante d'Etienne Pascal domine la jeunesse des enfants Pascai au delà de ce qu'on
peut imaginer.
Extraordinairement intelligent, cultivé, attentif à la pédagogie, i 1 sait étendre sa curiosité aux sciences les plus neuves; libéral, il fréquente les cercles les plus vivants, les plus hardis.
En 1631, il s'installe à Paris, dans l'intérêt de ses enfants.
En 1634, pour s'occuper 'entièrement d'eux, il vend sa charge à son frère Blaise.
Il refuse pour son fils l'éduca tion scolastique des collèges (on ne s'étonnera pas de l'éloi gnement de Pascal pour la scolastique: il n'aura pas même besoin de s'en délivrer, il n'en a jamais subi l'empreinte).
Le jeune Blaise reçoit dès sa petite enfance une· éducation ration
nelle et critique mais prudente: il s'agit, nous dit Gilberte
dans sa Vie de Pascal de • tenir l'enfant au dessus de son ouvrage •.
Ainsi s'explique le soin d'Etienne de ne laisser son fils accéder aux mathématiques que lorsque son esprit sera suffisamment formé: on sait l'émotion et les larmes d'Etienne
voyant l'intelligence de l'enfant, armé de bribes grapillées -çà et là, s'attaquer à la 32' proposition d'Euclide (la somme des
angles d'un triangle est égale à deux droits) - ce qui ne signifie nullement bien entendu qu'il avait résolu les 31 pre mières! Mais le génie précoce de l'enfant Blaise le pousse à rédiger un petit traité d'acoustique, et permet à son père de le laisser participer aux travaux de l'• Académie Mersenne •.
Un petit groupe de savants réunissait autour du père Mersenne,
religieux de J'ordre des minimes, entre autres personnalités Je mathématicien Roberval, Jacque Le Pailleur et Etienne Pascal lui-même.
C'est.dans ce·cercle· que se précise la théorie de la science expérimentale, à laquelle tout compte fait Blaise Pascal restera fidèle toute sa vie.
Une lettre d'Etienne Pascal et de Roberval au mathématicien Fermat sur le problème de la pesan· leur affirme n'admettre comme principes • que ceux desquels
l'expérience, assistée d'un bon ·jugement, nous a rendus cer tains.
(1636).
Ainsi Pascal se trouve-t-il initié dès son plus jeune âge à la plus haute science de son temps.
Mais
il ne faudrait pas imaginer l'existence des enfants Pascal toute austère et tendue: la part de mondanité est gran-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PENSÉES de Blaise Pascal (résumé et analyse de l'oeuvre)
- PROVINCIALES (les). Lettres polémiques de Blaise Pascal (résumé et analyse de l'oeuvre)
- L’OEUVRE SCIENTIFIQUE DE PASCAL
- PENSÉES, 1670. Blaise Pascal - résumé de l'oeuvre
- Pensées 1670 Blaise Pascal (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)