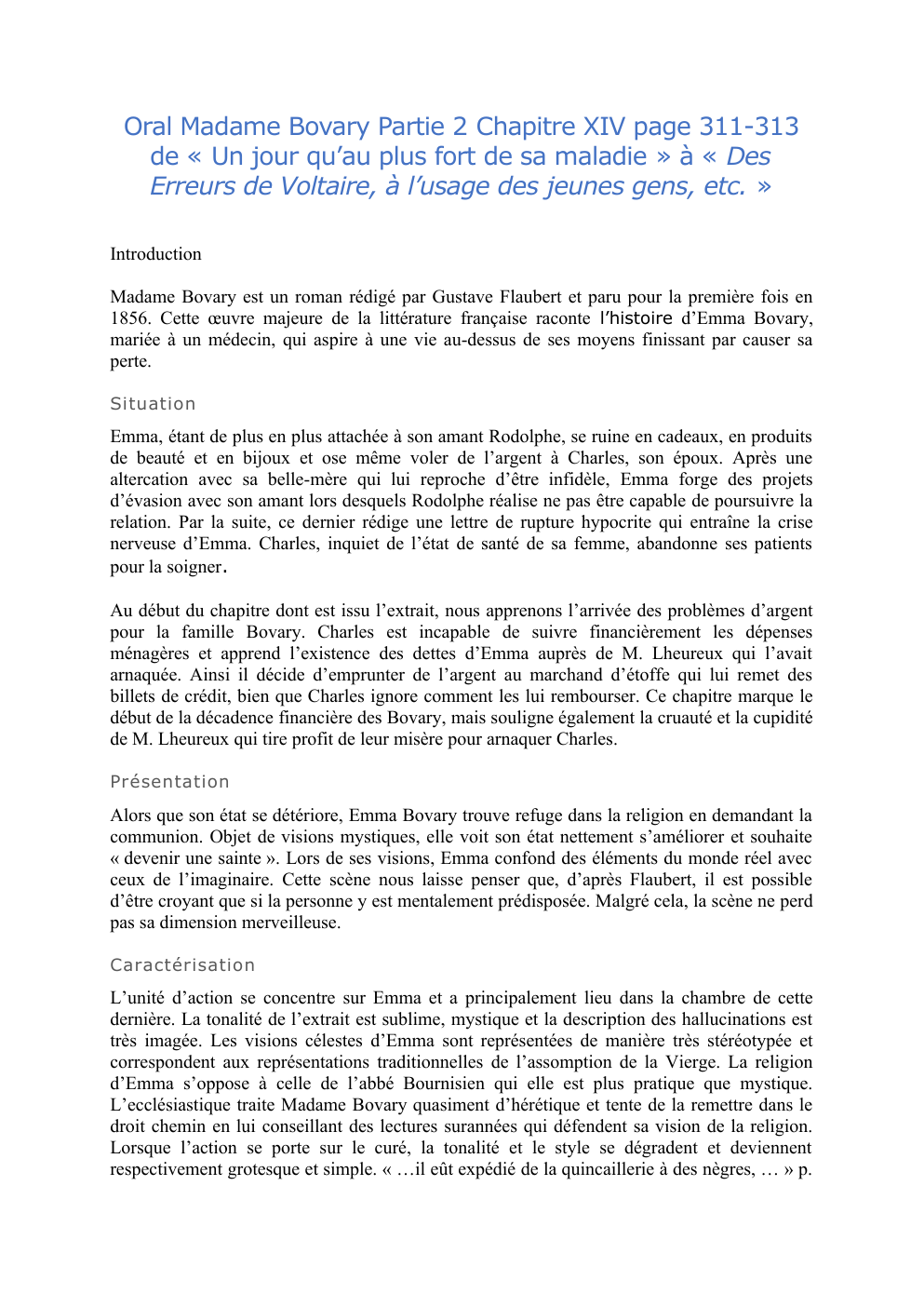Madame Bovary analyse linéaire pages 311-313
Publié le 14/04/2023
Extrait du document
«
Oral Madame Bovary Partie 2 Chapitre XIV page 311-313
de « Un jour qu’au plus fort de sa maladie » à « Des
Erreurs de Voltaire, à l’usage des jeunes gens, etc.
»
Introduction
Madame Bovary est un roman rédigé par Gustave Flaubert et paru pour la première fois en
1856.
Cette œuvre majeure de la littérature française raconte l’histoire d’Emma Bovary,
mariée à un médecin, qui aspire à une vie au-dessus de ses moyens finissant par causer sa
perte.
Situation
Emma, étant de plus en plus attachée à son amant Rodolphe, se ruine en cadeaux, en produits
de beauté et en bijoux et ose même voler de l’argent à Charles, son époux.
Après une
altercation avec sa belle-mère qui lui reproche d’être infidèle, Emma forge des projets
d’évasion avec son amant lors desquels Rodolphe réalise ne pas être capable de poursuivre la
relation.
Par la suite, ce dernier rédige une lettre de rupture hypocrite qui entraîne la crise
nerveuse d’Emma.
Charles, inquiet de l’état de santé de sa femme, abandonne ses patients
pour la soigner.
Au début du chapitre dont est issu l’extrait, nous apprenons l’arrivée des problèmes d’argent
pour la famille Bovary.
Charles est incapable de suivre financièrement les dépenses
ménagères et apprend l’existence des dettes d’Emma auprès de M.
Lheureux qui l’avait
arnaquée.
Ainsi il décide d’emprunter de l’argent au marchand d’étoffe qui lui remet des
billets de crédit, bien que Charles ignore comment les lui rembourser.
Ce chapitre marque le
début de la décadence financière des Bovary, mais souligne également la cruauté et la cupidité
de M.
Lheureux qui tire profit de leur misère pour arnaquer Charles.
Présentation
Alors que son état se détériore, Emma Bovary trouve refuge dans la religion en demandant la
communion.
Objet de visions mystiques, elle voit son état nettement s’améliorer et souhaite
« devenir une sainte ».
Lors de ses visions, Emma confond des éléments du monde réel avec
ceux de l’imaginaire.
Cette scène nous laisse penser que, d’après Flaubert, il est possible
d’être croyant que si la personne y est mentalement prédisposée.
Malgré cela, la scène ne perd
pas sa dimension merveilleuse.
Caractérisation
L’unité d’action se concentre sur Emma et a principalement lieu dans la chambre de cette
dernière.
La tonalité de l’extrait est sublime, mystique et la description des hallucinations est
très imagée.
Les visions célestes d’Emma sont représentées de manière très stéréotypée et
correspondent aux représentations traditionnelles de l’assomption de la Vierge.
La religion
d’Emma s’oppose à celle de l’abbé Bournisien qui elle est plus pratique que mystique.
L’ecclésiastique traite Madame Bovary quasiment d’hérétique et tente de la remettre dans le
droit chemin en lui conseillant des lectures surannées qui défendent sa vision de la religion.
Lorsque l’action se porte sur le curé, la tonalité et le style se dégradent et deviennent
respectivement grotesque et simple.
« …il eût expédié de la quincaillerie à des nègres, … » p.
312, ligne 28 ou encore « …des espèces de romans à cartonnage rose et à style douceâtre… »
p.
313 ligne 1
Mouvements
Nous distinguons trois mouvements dans ce texte.
D’abord a lieu la description des
hallucinations mystiques dont Emma fait l’objet.
Au cours du deuxième mouvement, le
narrateur explique l’ampleur que la religion a sur Emma.
Le dernier mouvement montre la
misogynie de l’Homme religieux et comment il décrédibilise la religion d’Emma.
Problématique
Nous pouvons donc nous demander de quelle manière le narrateur parvient à rendre Emma
risible dans son lien avec la religion, bien qu’elle y trouve son salut.
Une religion romantisée
L’extrait démarre avec une ellipse afin de faire comprendre au lecteur que cela fait désormais
un moment qu’Emma est souffrante.
La première phrase nous montre qu’elle est « au plus fort
de sa maladie » et qu’elle a l’impression d’agoniser, au point qu’elle demande la communion.
Nous semblons alors presque assister aux derniers sacrements d’Emma.
Étant donné que le
monde concret ne parvient pas à la sauver, elle se tourne vers la spiritualité.
Cela s’explique
lors de la seconde partie de la phrase où « la commode encombrée de sirops » est transformée
en autel.
De plus, les sirops encombrants montrent bien que les médicaments ne sont d’aucune
utilité et s’opposent aux fleurs de dahlia semées par terre par Félicité.
La polysémie du mot
semer est très intéressante car elle est évocatrice de la future situation d’Emma.
Telle une
graine que l’on plante/sème, une autre Emma va en germer.
Bien évidemment, il est d’autant
plus significatif que Félicité s’occupe de les éparpiller, cela renforce le sentiment de béatitude
et de bonheur calme et durable recherché par sa maîtresse de maison.
Ainsi les dahlias font le
lien entre le réel et la béatitude religieuse.
Cependant le lecteur érudit se rendra compte ici du
caractère burlesque du symbole de la fleur de dahlia puisque malgré la symbolique
méliorative de la fleur qui peut signifier l’amour éternel, la fidélité ou le bonheur, celle-ci était
également symbole d’infidélité à l’époque du récit, renvoyant ainsi à la relation
extraconjugale d’Emma avec Rodolphe.
Le début de la seconde phrase s’oppose au début de
la première.
Alors que Madame Bovary est initialement fort malade, elle « sent quelque chose
de fort passant sur elle ».
Nous pouvons ici souligner la réutilisation de l’adjectif fort, mais
dans un contexte plus positif cette fois-ci.
Cette « chose » fait tabula rasa de l’être d’Emma à
l’aide d’une gradation qui passe de la notion la plus sensible à la plus spirituelle.
La phrase
suivante annonce le début d’une nouvelle vie pour Emma.
« Sa chair allégée » pourrait être
interprété comme la notion de la Masse de l’âme, notion moderne de la perte de poids qui suit
la mort.
Le fait que son corps ne pesait plus démontre que la religion est pour elle bien un
monde spirituel où il n’y a pas de place pour le physique.
Dans « une autre vie commençait »
l’usage de l’adjectif « autre » au lieu de « nouveau », par exemple, représente bien le désir
d’Emma de vivre une vie différente et non pas une nouvelle qui pourrait très bien « se
terminer » de la même manière.
La seconde proposition de la phrase est une première allusion
à l’Assomption de Marie, « montant vers Dieu ».
En outre, la polysémie du verbe
« s’anéantir » peut signifier à la fois la dévotion d’Emma pour la chrétienté, mais également la
destruction de son être dans cet amour.
Le reste de la proposition semble plutôt pencher vers
la deuxième option à l’aide de la comparaison faite avec de la vapeur d’un encens, symbole de
divinité.
Néanmoins cela semble être une vision très exagérée et incohérente avec la religion.
La prochaine phrase nous apprend que les draps du lit sont aspergés d’eau bénite.
Nous nous
demandons pourquoi ce n’est pas Emma qui est bénite.
Peut-être que les draps sont souillés et
ont besoin d’être purifiés ? Par ailleurs, la symbolique du lit correspond parfaitement à la
situation d’Emma, car ce dernier représente la maladie et la mort, mais s’y oppose également
avec le symbole de l’amour conjugal.
La proposition subordonnée qui suit, décrit le moment
de la communion à l’aide d’une hyperbole.
L’hostie blanche, symbole de pureté, provoque en
Emma une « joie céleste » qui faillit lui faire perdre connaissance.
L’usage du nom
« Sauveur » au lieu de celui de « Christ » montre bien qu’Emma avait besoin d’être sauvée.
Après avoir accepté le corps du Sauveur, elle voit son environnement se déformer et elle
commence à halluciner.
Encore une fois, le monde sensible laisse place à un monde plus
spirituel, à un monde céleste.
Les rideaux de son alcôve se transforment en nuages, la lumière
des deux cierges posés sur la commode qui nous le rappelons fait office d’autel, deviennent
des gloires éblouissantes, c’est-à-dire des rayonnements divins.
Justement la symbolique du
cierge désigne la lumière du Christ et l’amour de Dieu.
De plus, il est intéressant de souligner
qu’elle peut également signifier la fragilité des croyants qui veulent se repentir, ce qui est le
cas d’Emma.
À la suite de cela, Emma laisse retomber sa tête, ce qui nous indique qu’elle se
laisse submerger par son imaginaire.
Elle peint un véritable tableau à partir de sa vision
romantisée de la religion.
Elle entend des anges jouer de la harpe et voit des saints tenir des
palmes vertes, ainsi que le trône d’or de Dieu et Dieu lui-même.
Ici la symbolique de la palme
se détache, car elle est le symbole chrétien du martyre.
Les anges aux ailes de flamme
envoyés par Dieu pour ramener Emma vers la terre rappellent les cierges.
Emma imagine un
monde religieux extrêmement romantisé, fantaisiste et sans cohérence.
Dans son imaginaire,
elle est ressuscitée grâce à sa vision de la religion dont elle s’est elle-même convaincue.
Ce premier mouvement est riche en double sens et en symbolisme.
Très religieux, Emma nous
partage la vision de son monde mystique qui se trouve être très pictural.
Justement, Flaubert
s’est inspiré d’un tableau qui se....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication linéaire n°9 Madame Bovary: Dans quelle mesure cette rencontre amoureuse, bien que classique, est-elle magnifiée par le regard du héros ?
- ÉTUDE LINÉAIRE 5 : G. Flaubert, Madame Bovary, Chapitre VIII, 2ème partie
- Madame Bovary (résumé & analyse) de Flaubert
- Analyse de Madame Bovary de Gustave Flaubert
- Madame Bovary de Gustave Flaubert (Analyse)