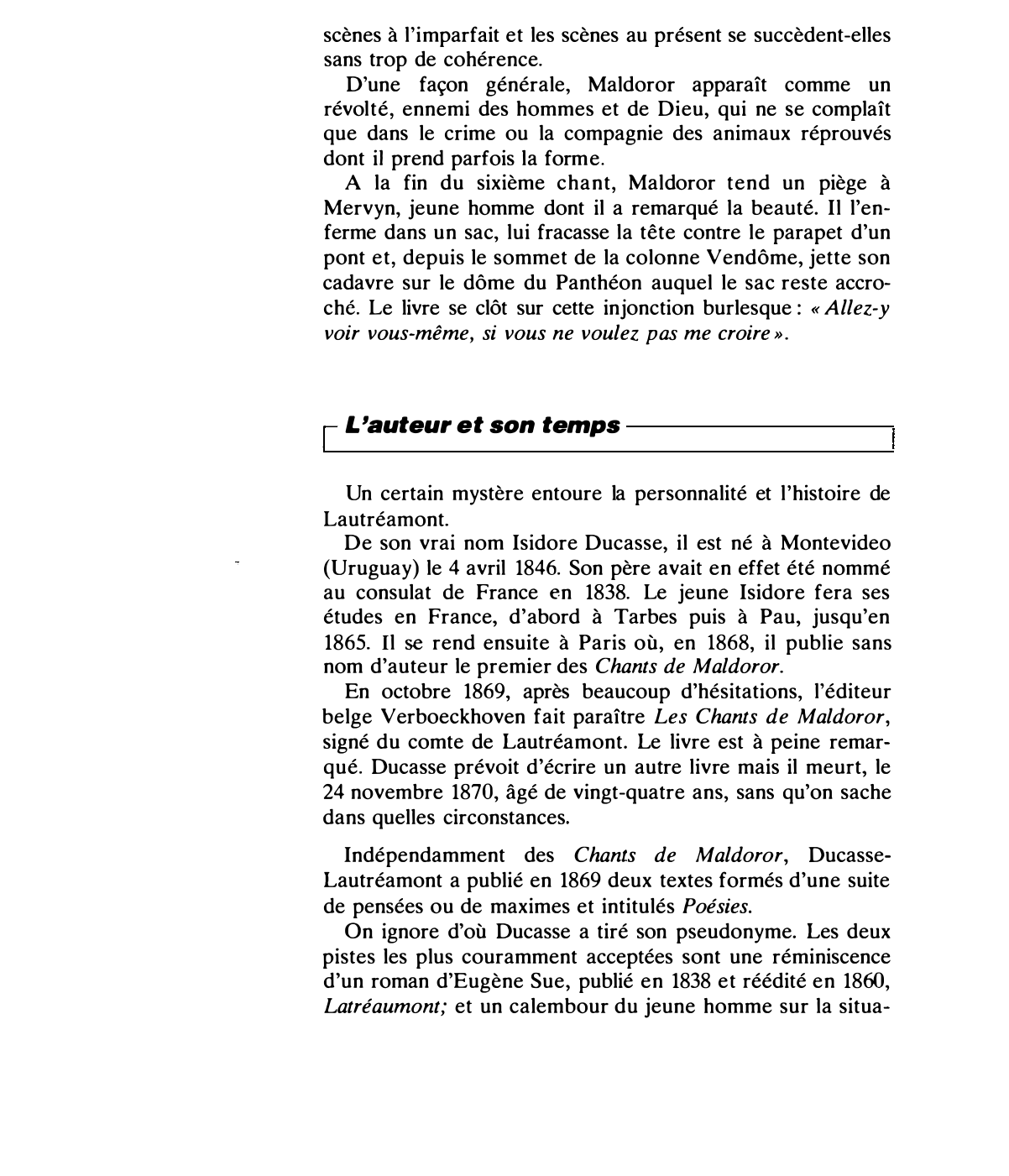MALDOROR (analyse du personnage)
Publié le 07/10/2018

Extrait du document
Pourtant, il faut se garder de prendre Ducasse au premier degré. Derrière la rhétorique enflée et prétentieuse de Maldoror, on trouve en fait l'humour d’un collégien parodiant le langage pompeux, la « langue officielle >> de son époque.
A y bien regarder, les phrases de Lautréamont sont à peu près toutes parodiques ou stupides. Donnons-en quelques exemples :
« Ni moi, ni les quatre pattes-nageoires de l’ours marin de l’océan Boréal, n’avons pu trouver le problème de la vie »,
«Chacun se dit qu’une fois dans l’eau, il ne pourra plus respirer »,
« Quelques membres palpitants flottent par-ci, par-là, sans rien dire »,
« Le crabe tourteau, monté sur un cheval fougueux, courait à toute bride », etc.
A la fin du sixième chant, qui clôt le livre et fourmille, de situations grotesques, l'un des personnages n'est autre qu’une queue de poisson. Or, on connaît l’expression «finir en queue de poisson»... Difficile de mieux afficher une intention moqueuse.
Cette stupidité, cette bouffonnerie sont celles que le jeune Ducasse dénonce chez les officiels, les «grandes têtes molles », les professeurs boursouflés des collèges ou des écoles par lesquels il était passé. Et si les surréalistes, un peu naïvement, ont pu considérer Les Chants de Maldoror comme « l’expression d’une révélation totale qui semble excéder les possibilités humaines» (André Breton), il faudrait plutôt rapprocher sa démarche de celle par laquelle Alfred Jarry serait, près de trente ans plus tard, amené à créer Ubu.
«
Maldoror •
267
scènes à l'i mparfait et les scènes au présent se succèdent-elles
sans trop de cohérence.
D'une façon générale, Maldoror apparaît comme un
révol té, ennemi des hommes et de Dieu, qui ne se complaît
que dans le crime ou la compagnie des animaux réprouvés
dont il prend parfois la for me.
A la fin du sixième chant, Maldoror tend un piège à
Mervyn, jeune homme dont il a remarqué la beauté.
Il l'en
ferme dans un sac, lui fracasse la tête contre le parapet d'un
pont et, depuis le sommet de la colonne Vendôme, jette son
cadavre sur le dôme du Panthéon auquel le sac reste accro
ché.
Le livre se clôt sur cette injonction burlesque: «A llez-y
voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire ».
[ L'auteur et son temps
Un certain mystère entoure la personnalité et l'histoire de
Lautréamont.
De son vrai nom Isidore Ducasse, il est né à Montevideo
(Uruguay) le 4 avril 1846.
Son père avait en effet été nommé
au consulat de France en 1838.
Le jeune Isidore fera ses
études en France, d'abord à Tarbes puis à Pau, jusqu'en
1865.
Il se rend ensuite à Paris où, en 1868, il publie sans
nom d'auteur le premier des Chants de Maldoror.
En octobre 1869, après beaucoup d'hésitations, l'éditeur
belge Verboeckhoven fait paraître Les Chants de Maldoro r,
signé du comte de Lautré amont.
Le livre est à peine remar
qué.
Ducasse prévoit d'écrire un autre livre mais il meurt, le
24 novembre 1870, âgé de vingt-quatre ans, sans qu'on sache
dans quelles circonstances.
Indépendamment des Chants de Maldor or, Ducasse
Lautréamont a publié en 1869 deux textes formés d'une suite
de pensées ou de maximes et intitulés Poésies.
On ignore d'où Ducasse a tiré son pseudonyme.
Les deux
pistes les plus couramment acceptées sont une rémin iscence
d'un roman d'Eugène Sue, publié en 1838 et réédité en 1860,
Latréa umont; et un calembour du jeune homme sur la situa-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LADY CHATTERLEY (analyse du personnage)
- HARPAGON (analyse du personnage)
- CYRANO DE BERGERAC (analyse du personnage)
- Les Chants de Maldoror de Lautréamont (analyse détaillée)
- RASKOLNIKOV (analyse du personnage)