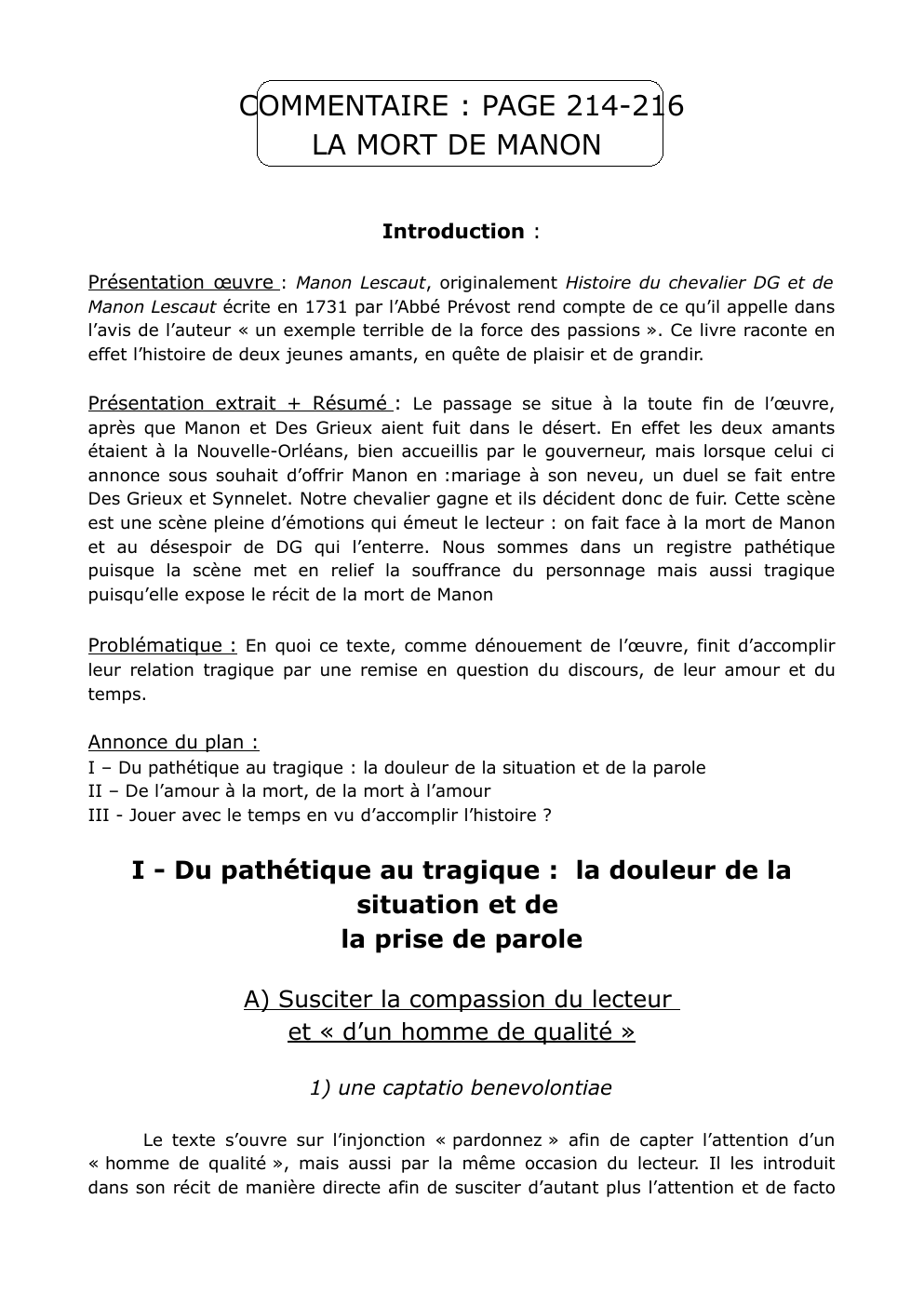manon_lescaut_commentaire_composé_la_mort_de_manon
Publié le 01/11/2023
Extrait du document
«
COMMENTAIRE : PAGE 214-216
LA MORT DE MANON
Introduction :
Présentation œuvre : Manon Lescaut, originalement Histoire du chevalier DG et de
Manon Lescaut écrite en 1731 par l’Abbé Prévost rend compte de ce qu’il appelle dans
l’avis de l’auteur « un exemple terrible de la force des passions ».
Ce livre raconte en
effet l’histoire de deux jeunes amants, en quête de plaisir et de grandir.
Présentation extrait + Résumé : Le passage se situe à la toute fin de l’œuvre,
après que Manon et Des Grieux aient fuit dans le désert.
En effet les deux amants
étaient à la Nouvelle-Orléans, bien accueillis par le gouverneur, mais lorsque celui ci
annonce sous souhait d’offrir Manon en :mariage à son neveu, un duel se fait entre
Des Grieux et Synnelet.
Notre chevalier gagne et ils décident donc de fuir.
Cette scène
est une scène pleine d’émotions qui émeut le lecteur : on fait face à la mort de Manon
et au désespoir de DG qui l’enterre.
Nous sommes dans un registre pathétique
puisque la scène met en relief la souffrance du personnage mais aussi tragique
puisqu’elle expose le récit de la mort de Manon
Problématique : En quoi ce texte, comme dénouement de l’œuvre, finit d’accomplir
leur relation tragique par une remise en question du discours, de leur amour et du
temps.
Annonce du plan :
I – Du pathétique au tragique : la douleur de la situation et de la parole
II – De l’amour à la mort, de la mort à l’amour
III - Jouer avec le temps en vu d’accomplir l’histoire ?
I - Du pathétique au tragique : la douleur de la
situation et de
la prise de parole
A) Susciter la compassion du lecteur
et « d’un homme de qualité »
1) une captatio benevolontiae
Le texte s’ouvre sur l’injonction « pardonnez » afin de capter l’attention d’un
« homme de qualité », mais aussi par la même occasion du lecteur.
Il les introduit
dans son récit de manière directe afin de susciter d’autant plus l’attention et de facto
la compassion du lecteur pour l’histoire qu’il « raconte », l’utilisation du « vous »
renvoie encore à cette idée.
Plus loin dans le texte il réutilise l’injonction « N’exigez
point de moi » couplée à la relative « que je vous décrive » : il entretient donc l’idée
de captation de tous les niveaux de lecteur.
2) peindre l’autoportrait d’un ethos souffrant
Après avoir capté l’attention, il l’utilise pour susciter la compassion en peignant
un autoportrait de son ethos souffrant.
Il crée en effet une image teintée de
« malheur », de « pleur », « d’horreur », de misère.
Le lecteur, en lisant combien sa
souffrance est grande, ne peut que éprouver de la pitié pour son malheur, lui qui en
plus ne se doutait pas de la mort de sa « maîtresse » : il montre par l’imparfait « je
croyais » qu’il était au départ, dans l’ignorance totale de sa mort, et ne prenait pas au
sérieux « ce discours ordinaire dans l’infortune ».
3) le recours aux hyperboles
Ce qui vient également renforcer le côté pathétique c’est le recours aux
hyperboles : il exagère en effet la réalité en disant que cet évènement « n’eut jamais
d’exemple » alors que justement, il y a une quantité énorme d’homme ou de femme
qui ont perdu leur amant.
Il dramatise donc la sa prise de parole pour montrer à quel
point il souffre de cette perte.
B) Une déchéance tragique :
le triste destin des amants déchus
1) un imaginaire tragique
On observe dans cet extrait de nombreuses marques tragiques, en commençant
par un mot extrêmement chargé en tragique lorsqu’il parle de ce « fatal évènement ».
Il y a aussi l’excitation de la crainte avec le verbe « sembler » fait une métaphore de
son âme qui « recule d’horreur » : en plus d’être empris à une misère infinie, DG se
retrouve à vivre dans la peur de son propre deuil, la peur de la réalisation de ce deuil.
Cet extrait convoque également un imaginaire tragique puisque mourir de désespoir
sur le corps ou la fosse de son amant renvoie au mythe littéraire médiéval de la mort
de Tristan et Iseut où Tristant meurt de désespoir en croyant que sa belle
l’abandonne, et quand elle revient et qu’elle voit son cadavre, elle se laisse mourir à
son tour sur ce dernier.
2) DG, nouveau Sisyphe ?
De plus, DG semble éprouver un mal constant puisque, à la manière d’un
fardeau, il « porte sans cesse » ce mal.
Et en plus de cela, « chaque fois » qu’il
entreprend « de l’exprimer », son âme « semble reculer d’horreur ».
La
personnification de l’âme rend ce mal-être ancré en lui, comme s’il ne pouvait y
échapper.
Le connecteur temporel « chaque fois » et le verbe « porter » donne une
idée d’un poids perpétuel, ce qu’on peut rapprocher au mythe de Sisyphe : ce dernier
en défiant les dieux est condamné à faire rouler éternellement une pierre jusqu’au
sommet d’une colline, et recommence dès qu’il y parvient.
Ici, c’est la même chose,
DG défie la religion et est condamné à porter éternellement son deuil.
3) déchéance chevaleresque
Nous pouvons également penser à une dimension tragique par la déchéance de
son titre : il naît d’une bonne famille, comme l’atteste la différence de traitement
judiciaire lors de leur première incarcération où Manon va à l’Hôpital, lieu pour les
pauvres et les prostituées et lui à St Lazare, lieu pour les gens débauchés de bonne
famille, est au début un homme vertueux, « l’exemple du collège » selon ses maîtres,
destiné à la chevalerie ou à la religion.
On suit bien l’histoire du Chevalier des Grieux
or, dans cette scène, il « rompt son épée » et se détache définitivement de son
passé : on observe sa déchéance chevaleresque.
Il perd son titre, sa vertu, ce qui
faisait de lui un héro au tout début du récit.
C) Un récit impossible à accomplir
1) Les euphémismes comme marque de déni
Nous observons en effet de nombreux euphémises, pour atténuer la violence de
la réalité.
En effet, il fait mention du « malheur », de la « dernière heure » de Manon,
de la perdre, d’un évènement « déplorable », de quand elle « expirait », mais jamais il
est fait mention de mort.
DG, dans son récit, n’utilise pas une seule fois le terme mort
pour décrire ce qui est le propre de ce qu’il raconte.
2) Ne pas dire la dure réalité, utilisation des périphrases
Ensuite, ce qui prouve la difficulté de de discours est l’utilisation de périphrases
lorsqu’il raconte :
Le discours des dernières paroles de Manon est rapporté, ce qui prouve à quel point il
est impossible pour DG de le dire frontalement.
3) Nier la mort, utiliser la négation
Dans ce texte, on observe également de nombreuses marques de négations tel
que « je ne pris » « n’exigez point que...ni que », « mon âme ne suivit pas » qui
montrent à quel point DG cherche à nier ce qu’il s’est passé, il ne veut pas le
confronter, mais pourtant le manque et le deuil contaminent ses propos, et ainsi ses
phrases sont teintées de négatif et d’absence.
Il y a également des tournures
restrictives « je ne la mis dans cet état qu’après avoir », « je n’y répondis que par »
qui elles marquent son impuissance face à la mort de sa bien aimée.
II – De l’amour à la mort, de la mort à l’amour
A) L’union des amants dans la mort :
accomplissement de leur passion
1) Le vocabulaire de la sensualité
Ce texte qui raconte la mort de Manon est décrit comme indissociable du
contact physique : même au chevet de sa bien aimée, le vocabulaire de la sensualité
est convoqué : lorsque la voix devient trop « faible » et que les mots ne suffisent pas,
les corps prennent la relève.
On retrouve en effet le « serrement de ses mains » où
Manon montre son amour, puis c’est au tour de DG qui a « la bouche attachée sur le
visage et sur les mains » de sa chère, le terme « attaché » montre qu’il ne contrôle
pas ce besoin de contact.
L’utilisation de l’hyperbole de l’embrasser « mille fois » avec
« toute l’ardeur du « plus parfait amour » montre à quel point sa mort renforce chez
DG son amour pour elle.
2) Sans pour autant perdre la raison
Pour autant, la passion qu’il ressent pour elle n’est pas une passion, qui, pour
une fois, est complètement dénuée de raison.
Tout d’abord, on voit qu’il y a un récit
méthodiquement structuré avec un ensemble de connecteurs logiques tout au long de
l’extrait comme « je ne pris d’abord », « après avoir pris soin », « enfin », « ensuite »,
… En plus, malgré le désespoir....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire composé De l'extrait de page 107 à page 109 Du roman Histoire du chevalier Des Grieux et Manon Lescaut d'Antoine-François Prévost d'Exiles
- Commentaire Manon Lescaut
- Manon Lescaut La mort de Manon Introduction
- Commentaire de Français, Manon Lescaut incipit.
- Corpus, la mort de Manon lescaut