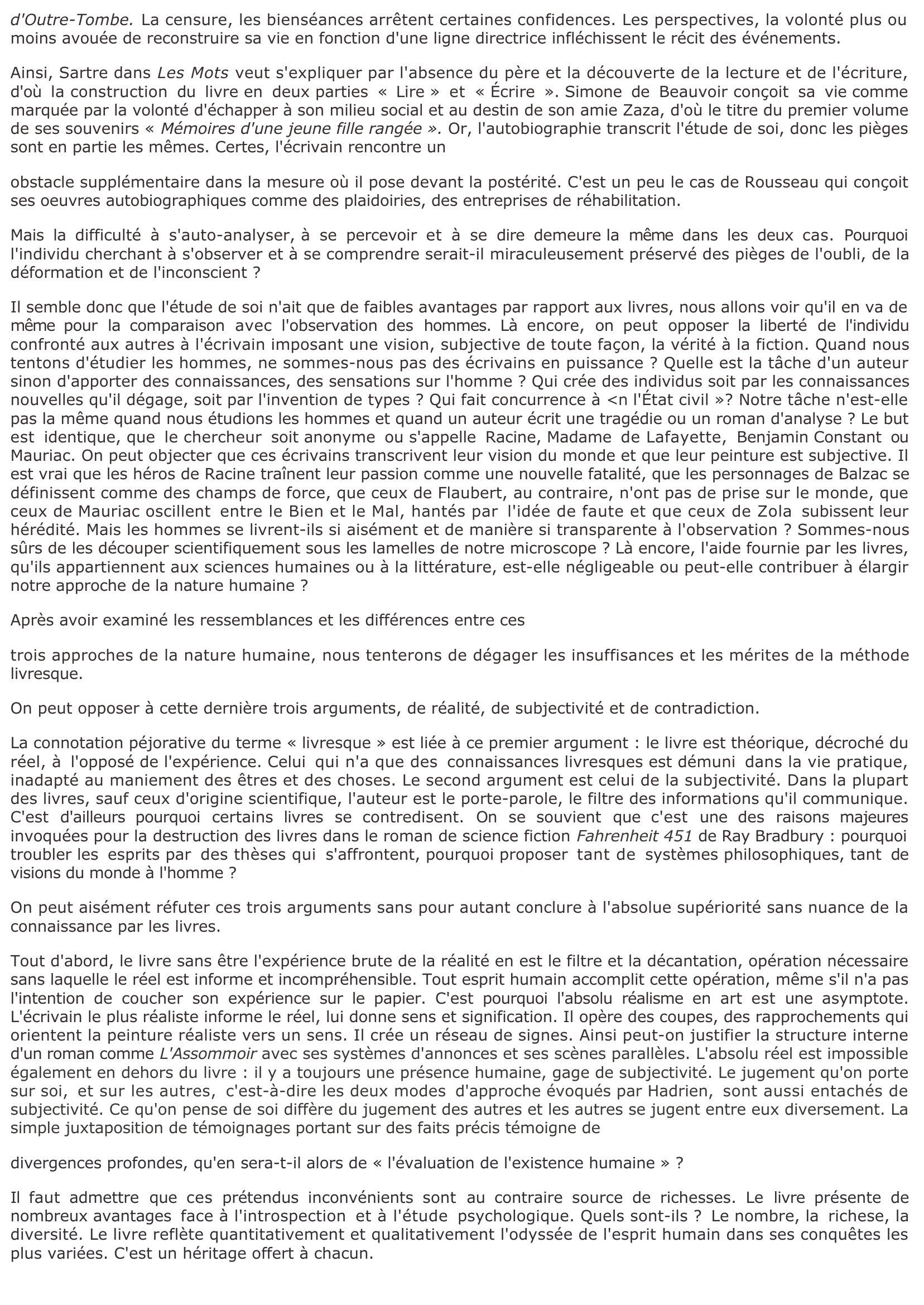Marguerite Yourcenar a imaginé les mémoires qu'aurait pu écrire l'empereur Hadrien (empereur romain du Ier siècle après Jésus-Christ). Il écrit : « Comme tout le monde, je n'ai à mon service que trois moyens d'évaluer l'existence humaine : l'étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus féconde des méthodes ; l'observation des hommes, qui s'arrangent le plus souvent pour nous cacher leurs secrets ou pour nous faire croire qu'ils en ont ; les livres, avec le
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
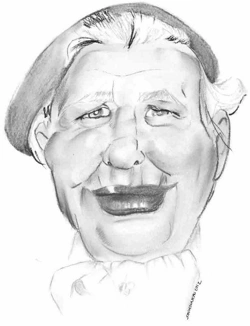
Les Mémoires d'Hadrien constituent un roman historique de Marguerite Yourcenar dans lequel « un pied dans l'érudition, ou plus exactement, et sans métaphore, dans cette magie sympathique qui consiste à se transporter en pensée dans l'intérieur de quelqu'un «, elle raconte la vie de cet empereur romain et imagine ses pensées.
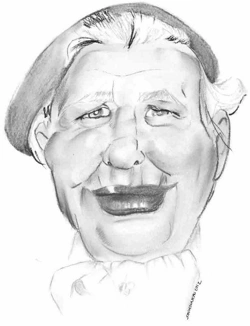
«
d'Outre-Tombe.
La censure, les bienséances arrêtent certaines confidences.
Les perspectives, la volonté plus ou moins avouée de reconstruire sa vie en fonction d'une ligne directrice infléchissent le récit des événements.
Ainsi, Sartre dans Les Mots veut s'expliquer par l'absence du père et la découverte de la lecture et de l'écriture, d'où la construction du livre en deux parties « Lire » et « Écrire ».
Simone de Beauvoir conçoit sa vie commemarquée par la volonté d'échapper à son milieu social et au destin de son amie Zaza, d'où le titre du premier volumede ses souvenirs « Mémoires d'une jeune fille rangée ».
Or, l'autobiographie transcrit l'étude de soi, donc les pièges sont en partie les mêmes.
Certes, l'écrivain rencontre un
obstacle supplémentaire dans la mesure où il pose devant la postérité.
C'est un peu le cas de Rousseau qui conçoitses oeuvres autobiographiques comme des plaidoiries, des entreprises de réhabilitation.
Mais la difficulté à s'auto-analyser, à se percevoir et à se dire demeure la même dans les deux cas.
Pourquoil'individu cherchant à s'observer et à se comprendre serait-il miraculeusement préservé des pièges de l'oubli, de ladéformation et de l'inconscient ?
Il semble donc que l'étude de soi n'ait que de faibles avantages par rapport aux livres, nous allons voir qu'il en va demême pour la comparaison avec l'observation des hommes.
Là encore, on peut opposer la liberté de l'individuconfronté aux autres à l'écrivain imposant une vision, subjective de toute façon, la vérité à la fiction.
Quand noustentons d'étudier les hommes, ne sommes-nous pas des écrivains en puissance ? Quelle est la tâche d'un auteursinon d'apporter des connaissances, des sensations sur l'homme ? Qui crée des individus soit par les connaissancesnouvelles qu'il dégage, soit par l'invention de types ? Qui fait concurrence à < n l'État civil »? Notre tâche n'est-elle pas la même quand nous étudions les hommes et quand un auteur écrit une tragédie ou un roman d'analyse ? Le butest identique, que le chercheur soit anonyme ou s'appelle Racine, Madame de Lafayette, Benjamin Constant ouMauriac.
On peut objecter que ces écrivains transcrivent leur vision du monde et que leur peinture est subjective.
Ilest vrai que les héros de Racine traînent leur passion comme une nouvelle fatalité, que les personnages de Balzac sedéfinissent comme des champs de force, que ceux de Flaubert, au contraire, n'ont pas de prise sur le monde, queceux de Mauriac oscillent entre le Bien et le Mal, hantés par l'idée de faute et que ceux de Zola subissent leurhérédité.
Mais les hommes se livrent-ils si aisément et de manière si transparente à l'observation ? Sommes-noussûrs de les découper scientifiquement sous les lamelles de notre microscope ? Là encore, l'aide fournie par les livres,qu'ils appartiennent aux sciences humaines ou à la littérature, est-elle négligeable ou peut-elle contribuer à élargirnotre approche de la nature humaine ?
Après avoir examiné les ressemblances et les différences entre ces
trois approches de la nature humaine, nous tenterons de dégager les insuffisances et les mérites de la méthodelivresque.
On peut opposer à cette dernière trois arguments, de réalité, de subjectivité et de contradiction.
La connotation péjorative du terme « livresque » est liée à ce premier argument : le livre est théorique, décroché duréel, à l'opposé de l'expérience.
Celui qui n'a que des connaissances livresques est démuni dans la vie pratique,inadapté au maniement des êtres et des choses.
Le second argument est celui de la subjectivité.
Dans la plupartdes livres, sauf ceux d'origine scientifique, l'auteur est le porte-parole, le filtre des informations qu'il communique.C'est d'ailleurs pourquoi certains livres se contredisent.
On se souvient que c'est une des raisons majeuresinvoquées pour la destruction des livres dans le roman de science fiction Fahrenheit 451 de Ray Bradbury : pourquoi troubler les esprits par des thèses qui s'affrontent, pourquoi proposer tant de systèmes philosophiques, tant devisions du monde à l'homme ?
On peut aisément réfuter ces trois arguments sans pour autant conclure à l'absolue supériorité sans nuance de laconnaissance par les livres.
Tout d'abord, le livre sans être l'expérience brute de la réalité en est le filtre et la décantation, opération nécessairesans laquelle le réel est informe et incompréhensible.
Tout esprit humain accomplit cette opération, même s'il n'a pasl'intention de coucher son expérience sur le papier.
C'est pourquoi l'absolu réalisme en art est une asymptote.L'écrivain le plus réaliste informe le réel, lui donne sens et signification.
Il opère des coupes, des rapprochements quiorientent la peinture réaliste vers un sens.
Il crée un réseau de signes.
Ainsi peut-on justifier la structure interned'un roman comme L'Assommoir avec ses systèmes d'annonces et ses scènes parallèles.
L'absolu réel est impossible également en dehors du livre : il y a toujours une présence humaine, gage de subjectivité.
Le jugement qu'on portesur soi, et sur les autres, c'est-à-dire les deux modes d'approche évoqués par Hadrien, sont aussi entachés desubjectivité.
Ce qu'on pense de soi diffère du jugement des autres et les autres se jugent entre eux diversement.
Lasimple juxtaposition de témoignages portant sur des faits précis témoigne de
divergences profondes, qu'en sera-t-il alors de « l'évaluation de l'existence humaine » ?
Il faut admettre que ces prétendus inconvénients sont au contraire source de richesses.
Le livre présente denombreux avantages face à l'introspection et à l'étude psychologique.
Quels sont-ils ? Le nombre, la richese, ladiversité.
Le livre reflète quantitativement et qualitativement l'odyssée de l'esprit humain dans ses conquêtes lesplus variées.
C'est un héritage offert à chacun..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans son roman historique Les Mémoires d'Hadrien, l'écrivain contemporain Marguerite Yourcenar fait dire à son héros, l'empereur romain Hadrien (second siècle après Jésus-Christ) : « Les poètes nous transportent dans un monde plus vaste ou plus beau, plus ardent ou plus doux que celui qui nous est donné, différent par là-même et en pratique presque inhabitable. » En prenant appui sur des œuvres que vous connaissez bien, vous direz si vous approuvez ces réflexions de l'empereur Hadri
- Dans les Mémoires d'Hadrien, Marguerite Yourcenar prête cet aveu à l'empereur romain : «Tantôt ma vie m'apparaît banale au point de ne pas valoir d'être, non seulement écrite, mais même un peu longuement contemplée, nullement plus importantes, même à mes propres yeux, que celle du premier venu. Tantôt, elle me semble unique, et par là même sans valeur, inutile, parce qu'impossible à réduire à l'expérience du commun des hommes. » A la suite d'Hadrien, vous vous interrogerez sur la
- Marguerite Yourcenar, née en 1903, imagine que, devenu vieux, Hadrien (76-138 de notre ère), écrit pour le successeur de son choix, encore adolescent — le futur Marc-Aurèle - l'expérience de sa vie d'homme et d'empereur romain.
- Paul Valéry écrit dans le Préambule pour le Catalogue
- Dans la préface de « Pierre et Jean », Maupassant s'en prend aux romanciers d'analyse qui s'attachent « à indiquer les moindres évolutions d'un esprit, les mobiles les plus secrets qui déterminent nos actions ». Il leur oppose la manière des « écrivains objectifs » qui « se bornent à faire passer sous nos yeux les personnages » et conclut que « la psychologie doit être cachée dans le livre comme elle est cachée en réalité sous les faits dans l'existence ». En prenant des exemples dans