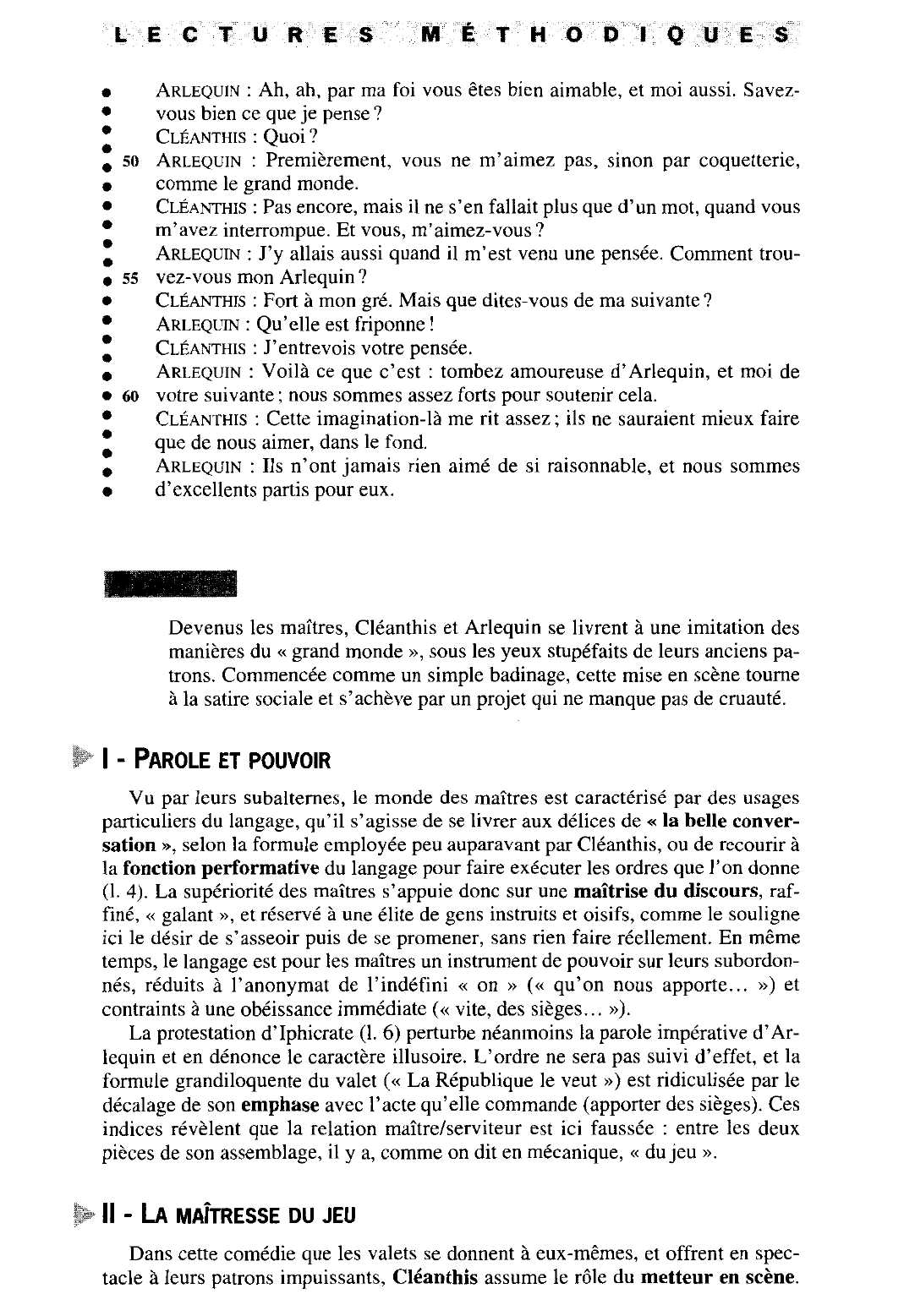Marivaux, L'Île des Esclaves (Scène 6) - LECTURES MÉTHODIQUES
Publié le 15/03/2015

Extrait du document

Vu par leurs subalternes, le monde des maîtres est caractérisé par des usages particuliers du langage, qu'il s'agisse de se livrer aux délices de « la belle conversation «, selon la formule employée peu auparavant par Cléanthis, ou de recourir à la fonction performative du langage pour faire exécuter les ordres que l'on donne (1. 4). La supériorité des maîtres s'appuie donc sur une maîtrise du discours, raffiné, « galant «, et réservé à une élite de gens instruits et oisifs, comme le souligne ici le désir de s'asseoir puis de se promener, sans rien faire réellement. En même temps, le langage est pour les maîtres un instrument de pouvoir sur leurs subordonnés, réduits à l'anonymat de l'indéfini « on « (« qu'on nous apporte... «) et contraints à une obéissance immédiate (« vite, des sièges... «).

«
L E C T U R E S M É T H 0 D Q U E S
ARLEQUIN : Ah, ah, par ma foi vous êtes bien aimable, et moi aussi.
Savez
vous bien ce que
je pense? CLÉANTHIS : Quoi ? 50 ARLEQUIN : Premièrement, vous ne m'aimez pas, sinon par coquetterie,
comme le grand monde.
CLÉANTHIS: Pas encore, mais il ne s'en fallait plus que d'un mot, quand vous
m'avez interrompue.
Et vous, m'aimez-vous?
ARLEQUIN: J'y allais aussi quand il m'est venu une pensée.
Comment trou-
55 vez-vous mon Arlequin? CLÉANTHIS : Fort à mon gré.
Mais que dites-vous de ma suivante?
ARLEQUIN: Qu'elle est friponne!
CLÉANTHIS : J'entrevois votre pensée.
ARLEQUIN : Voilà ce que c'est : tombez amoureuse d' Arlequin, et moi de
60 votre suivante; nous sommes assez forts pour soutenir cela.
CLÉANTHIS : Cette imagination-là me rit assez; ils ne sauraient mieux faire
que de nous aimer, dans
le fond.
ARLEQUIN : Ils n'ont jamais rien aimé de si raisonnable, et nous sommes
d'excellents partis pour eux.
Devenus les maîtres, Cléanthis et Arlequin se livrent à une imitation des
manières du
«grand monde », sous les yeux stupéfaits de leurs anciens pa
trons.
Commencée comme un simple badinage, cette mise en scène tourne
à la satire sociale et s'achève par un projet qui ne manque pas de cruauté.
1 -PAROLE ET POUVOIR
Vu par leurs subalternes, le monde des maîtres est caractérisé par des usages
particuliers du langage, qu'il s'agisse de se livrer aux délices de« la belle conver
sation», selon la formule employée peu auparavant par Cléanthis, ou de recourir à
la fonction performative du langage pour faire exécuter les ordres que l'on donne (!.
4).
La supériorité des maîtres s'appuie donc sur une maîtrise du discours, raf
finé,
« galant », et réservé à une élite de gens instruits et oisifs, comme le souligne
ici le désir de s'asseoir puis de se promener, sans rien faire réellement.
En même
temps, le langage est pour les maîtres un instrument de pouvoir sur leurs subordon
nés, réduits à l'anonymat de l'indéfini
« on » (« qu'on nous apporte ...
») et
contraints à une obéissance
immédiate(« vite, des sièges ...
»).
La protestation d'lphicrate (!.
6) perturbe néanmoins la parole impérative d' Ar
lequin et en dénonce le caractère illusoire.
L'ordre ne sera pas suivi d'effet, et la
formule grandiloquente du valet (
« La République le veut ») est ridiculisée par le
décalage de son
emphase avec l'acte qu'elle commande (apporter des sièges).
Ces
indices révèlent que la relation maître/serviteur est ici faussée : entre les deux
pièces de son assemblage, il y
a, comme on dit en mécanique, « du jeu ».
Il -LA MAÎTRESSE DU JEU
Dans cette comédie que les valets se donnent à eux-mêmes, et offrent en spec
tacle à leurs patrons impuissants,
Cléanthis assume le rôle du metteur en scène..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'île aux esclaves, étude de la scène VI, Marivaux.
- MARIVAUX – L’île des esclaves, scène 1
- Lecture Analytique: L'île des esclaves Scène X Tirade de Cléanthis Pierre de Marivaux est auteur principalement de pièces de théâtre.
- Marivaux L'île des esclaves acte 1 scène 1 et 2
- Marivaux - île des esclaves acte 1 fin scène 1 et début scène 2