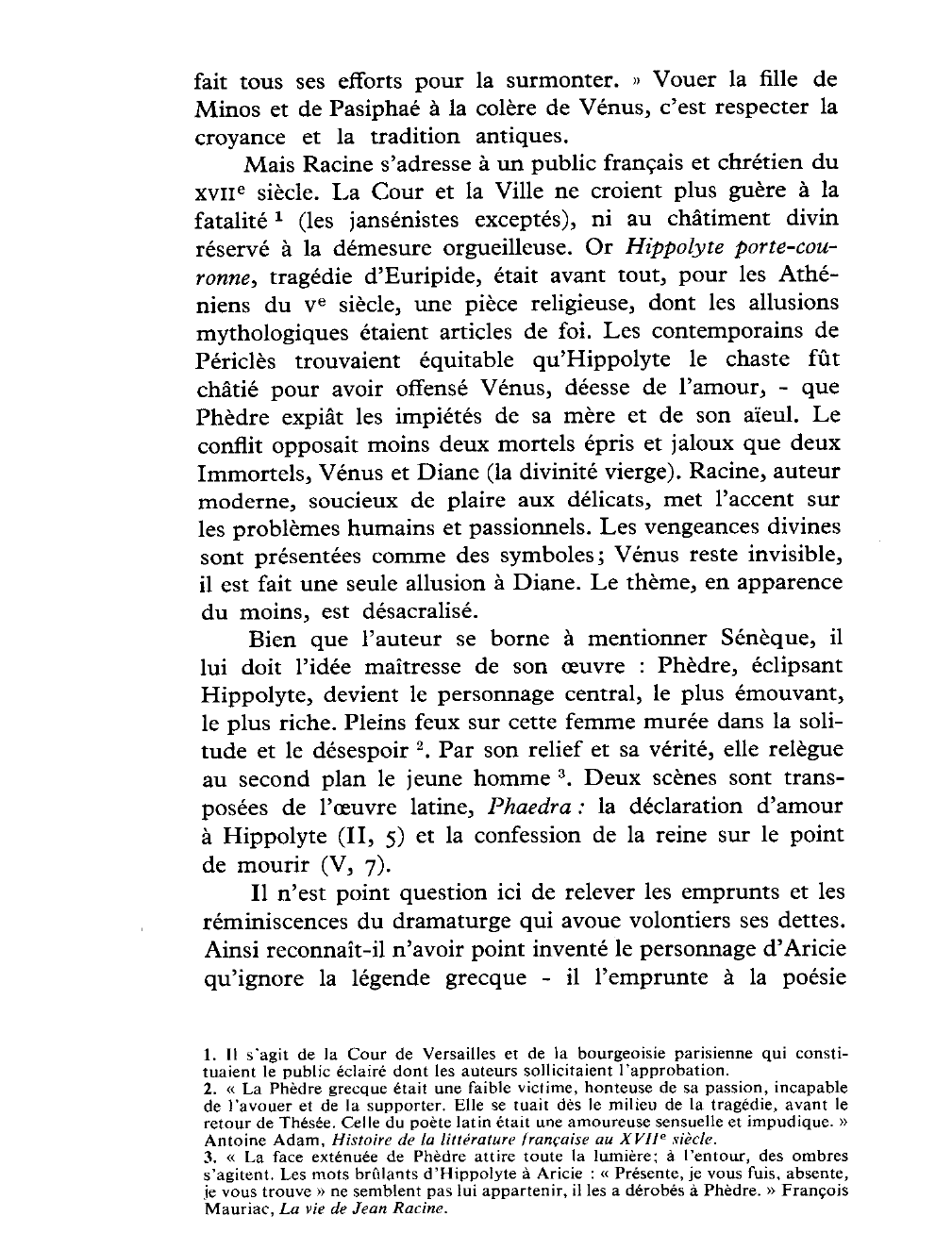Niveau 1677
Publié le 23/08/2015

Extrait du document
Bienséances « Voilà une grande fortune pour notre siècle de voir courir une femme après le fils de son mari et vouloir faire un inceste en plein théâtre « ironise Pradon, le rival malheureux 1. Le mérite de Racine est grand d'avoir su accommoder un sujet aussi inconvenant au goût maniéré de son public. Les bien¬séances avaient adouci, affadi la légende antique. Or Phèdre la reprend dans son intégrité. L'art de l'auteur fut assez subtil pour faire accepter au Grand Arnauld lui-même, l'austère janséniste, les débordements de la coupable 2. Quelques retouches atténuent la brutalité du drame : même en pleine crise, les personnages gardent leur dignité. Hippolyte reste courtois quand la reine l'accable de ses aveux et de ses menaces; il ne tire plus l'épée pour la tuer, comme dans la Phaedra de Sénèque; c'est la désespérée qui lui arrache son arme (II, 5). Devant son père, en parfait gentil¬homme, il se tait (IV, 2). Phèdre, consciente de sa responsa¬bilité, se ressaisit très vite; seule une haine jalouse retarde sa pénitence (IV, 5). Thésée, une fois instruit, lui aussi se repent, cherche à réparer le mal qu'il a commis (V, 7). Sur¬tout la cause de la catastrophe, c'est la vilenie d'une ancienne esclave, OEnone, que son âge et sa condition font dédaigner. Porter une accusation mensongère de viol serait indigne d'une héroïne. « Cette bassesse m'a paru plus convenable à une nourrice, qui pouvait avoir des inclinations plus serviles « dit Racine dans la Préface. Haro sur OEnone, maudite par sa maîtresse (IV, 6), vouée à l'exécration de tous. Pour elle, pas même un tombeau.
fait tous ses efforts pour la surmonter. « Vouer la fille de Minos et de Pasiphaé à la colère de Vénus, c'est respecter la croyance et la tradition antiques.
Mais Racine s'adresse à un public français et chrétien du xviie siècle. La Cour et la Ville ne croient plus guère à la fatalité 1 (les jansénistes exceptés), ni au châtiment divin réservé à la démesure orgueilleuse. Or Hippolyte porte-couronne, tragédie d'Euripide, était avant tout, pour les Athéniens du ve siècle, une pièce religieuse, dont les allusions mythologiques étaient articles de foi. Les contemporains de Périclès trouvaient équitable qu'Hippolyte le chaste fût châtié pour avoir offensé Vénus, déesse de l'amour, - que Phèdre expiât les impiétés de sa mère et de son aïeul. Le conflit opposait moins deux mortels épris et jaloux que deux Immortels, Vénus et Diane (la divinité vierge). Racine, auteur moderne, soucieux de plaire aux délicats, met l'accent sur les problèmes humains et passionnels. Les vengeances divines sont présentées comme des symboles ; Vénus reste invisible, il est fait une seule allusion à Diane. Le thème, en apparence du moins, est désacralisé.
Bien que l'auteur se borne à mentionner Sénèque, il lui doit l'idée maîtresse de son oeuvre : Phèdre, éclipsant Hippolyte, devient le personnage central, le plus émouvant, le plus riche. Pleins feux sur cette femme murée dans la solitude et le désespoir 2. Par son relief et sa vérité, elle relègue au second plan le jeune homme 3. Deux scènes sont transposées de l'oeuvre latine, Phaedra : la déclaration d'amour à Hippolyte (II, 5) et la confession de la reine sur le point de mourir (V, 7).
Il n'est point question ici de relever les emprunts et les réminiscences du dramaturge qui avoue volontiers ses dettes. Ainsi reconnaît-il n'avoir point inventé le personnage d'Aricie qu'ignore la légende grecque - il l'emprunte à la poésie
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HABERMAS, L’intégration républicaine, « Les droits de l’homme. À l’échelle mondiale et au niveau de l’État » (1996). Traduit de l’allemand par Rainer Rochlitz (revue) - corrigé HLP
- Devoir de remise à niveau en math sur les vecteurs
- Deus sive Natura-Dieu ou la Nature Baruch Spinoza (1632-1677)
- evolution du mariage dans le droit niveau terminal
- Phèdre 1677 Jean Racine