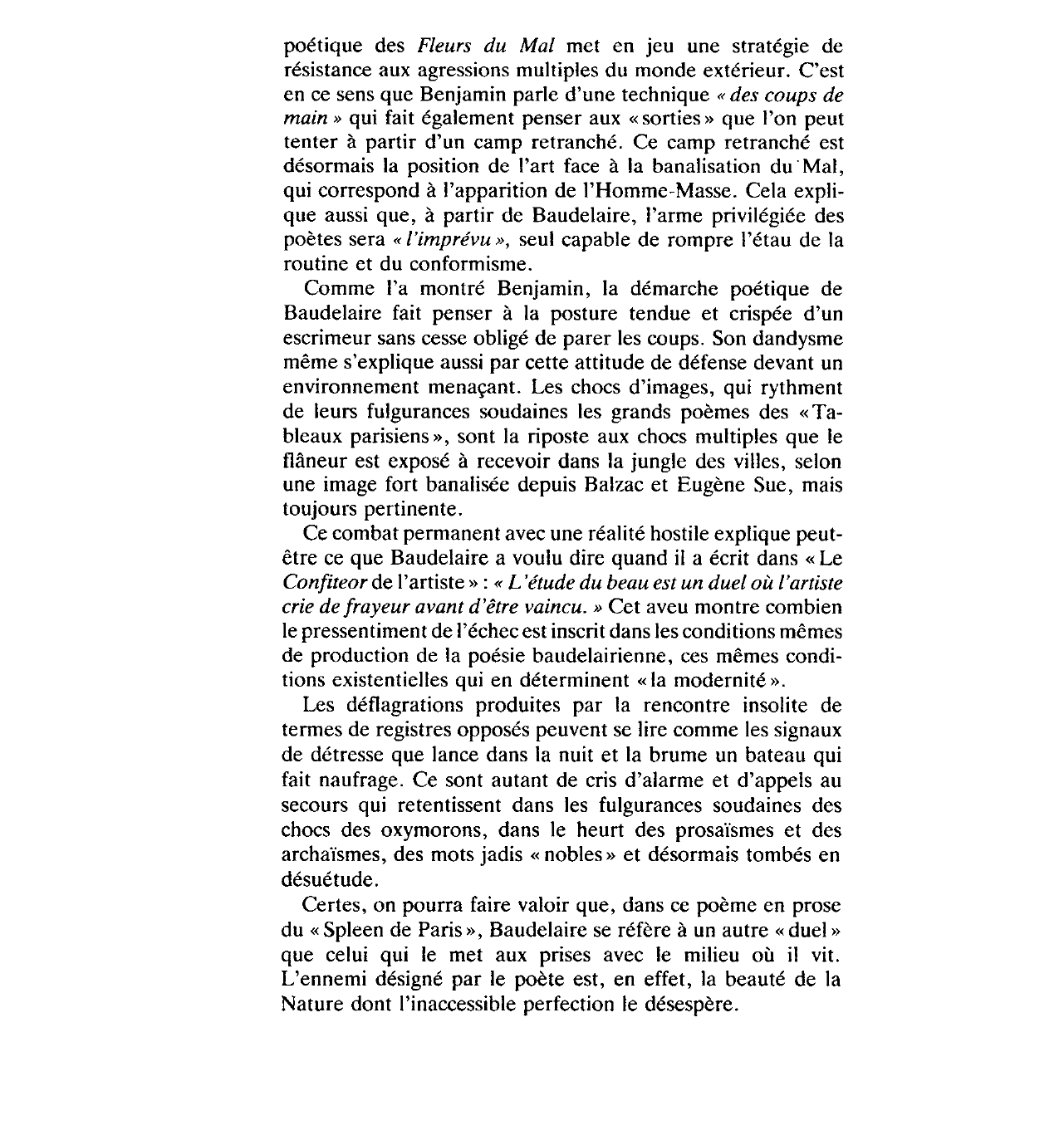Perte d'auréole (Baudelaire)
Publié le 08/09/2013

Extrait du document

Le pari, qui est à l'origine de la poésie de Baudelaire,
réside dans ce paradoxe: comment affirmer la fidélité à cette
origine d'où provient la création poétique, tout en adhérant à
une réalité qui nie cette origine? Il est évident que la réponse
à cette question suppose le changement de la notion même de
poésie, et une nouvelle définition de la beauté.
C'est en cela que Baudelaire a été l'inventeur d'une esthétique
nouvelle, ce que l'on a appelé, de façon quelque peu
sommaire, «une esthétique de la laideur«. La poésie ne
s'identifie plus à l' «auréole« du poète, puisqu'il a perdu
celle-ci, mais à la trace que cette auréole a laissée dans le
ruisseau où elle est tombée.
Les valeurs esthétiques ne procèdent plus d'un idéal
lointain, d'un modèle fixé une fois pour toutes, mais de la
volonté de le retrouver et surtout de la conscience de ne
pouvoir y atteindre.
Certes, il y a chez Baudelaire une fascination pour la
beauté impassible qu'il a chantée dans un sonnet célèbre.
Mais il faut déchiffrer dans ces vers moins un manifeste
parnassien en faveur de l'art pour l'art que les tortures infligées
au poète par la conscience de son impuissance à atteindre
cette beauté. Comme dans «Le Confiteor de l'Artiste«,
l'accent est déplacé sur les souffrances du poète terrassé par
un infini qui le nargue.
La fascination pour la ville et pour la foule ne doit pas être
confondue chez Baudelaire avec la tentation de s'immoler à
ces nouvelles idoles qui sont, peut-être, les incarnations modernes
de l'éternel Veau d'or. C'est précisément parce que
Baudelaire était conscient des dangers de cette hypnose, de la
puissance de destruction de ces narcotiques d'un nouveau
genre que, loin de se soumettre à cette pression sociale, il a
essayé d'exorciser par la poésie la rage de consommation qui
aliène l'homme à la marchandise, ce processus de « réification
« qui transforme l'individu en objet d'échange et le pétrifie
en automate.

«
poétique des Fleurs du Mal met en jeu une stratégie de
résistance aux agressions
multiples du monde extérieur.
C'est
en ce sens que Benjamin parle d'une technique «des coups de
main» qui fait également penser aux «sorties» que l'on peut
tenter à partir d'un camp retranché.
Ce camp retranché est
désormais la position de l'art face
à la banalisation du· Mal,
qui correspond à l'apparition de l'Homme-Masse.
Cela expli
que aussi que, à partir de Baudelaire, l'arme privilégiée des
poètes sera
«l'imprévu», seul capable de rompre l'étau de la
routine
et du conformisme.
Comme l'a montré Benjamin, la démarche poétique de
Baudelaire fait penser à la posture tendue
et crispée d'un
escrimeur sans cesse obligé de
parer les coups.
Son dandysme
même s'explique aussi
par cette attitude de défense devant un
environnement menaçant.
Les chocs d'images, qui rythment
de leurs fulgurances soudaines les grands poèmes des
«Ta
bleaux parisiens», sont la riposte aux chocs multiples que le
flâneur est exposé à recevoir dans la jungle des villes, selon
une image fort banalisée depuis Balzac
et Eugène Sue, mais
toujours pertinente.
Ce combat permanent avec une réalité hostile explique peut
être ce que Baudelaire a voulu dire quand il a écrit dans «Le
Confiteor de l'artiste» : «L'étude du beau est un duel où l'artiste
crie de frayeur avant d'être vaincu.
» Cet aveu montre combien
le pressentiment de l'échec est inscrit dans les conditions mêmes
de production de la poésie baudelairienne, ces mêmes condi
tions existentielles qui
en déterminent «la modernité».
Les déflagrations produites par la rencontre insolite de
termes de registres opposés peuvent se lire comme les signaux
de détresse que lance dans la nuit
et la brume un bateau qui
fait naufrage.
Ce sont autant de cris d'alarme
et d'appels au
secours qui retentissent dans les fulgurances soudaines des
chocs des oxymorons, dans le heurt des prosaïsmes
et des
archaïsmes, des mots jadis
«nobles» et désormais tombés en
désuétude.
Certes, on pourra faire valoir que, dans ce poème
en prose
du
«Spleen de Paris», Baudelaire se réfère à un autre «duel»
que celui qui le met aux prises avec le milieu où il vit.
L'ennemi désigné
par le poète est, en effet, la beauté de la
Nature dont l'inaccessible perfection le désespère..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- Analyse linéaire Bac Français A une passante de Baudelaire
- explication linéaire charogne baudelaire
- Baudelaire, A un passante, analyse linéaire
- Le poison, Charles Baudelaire