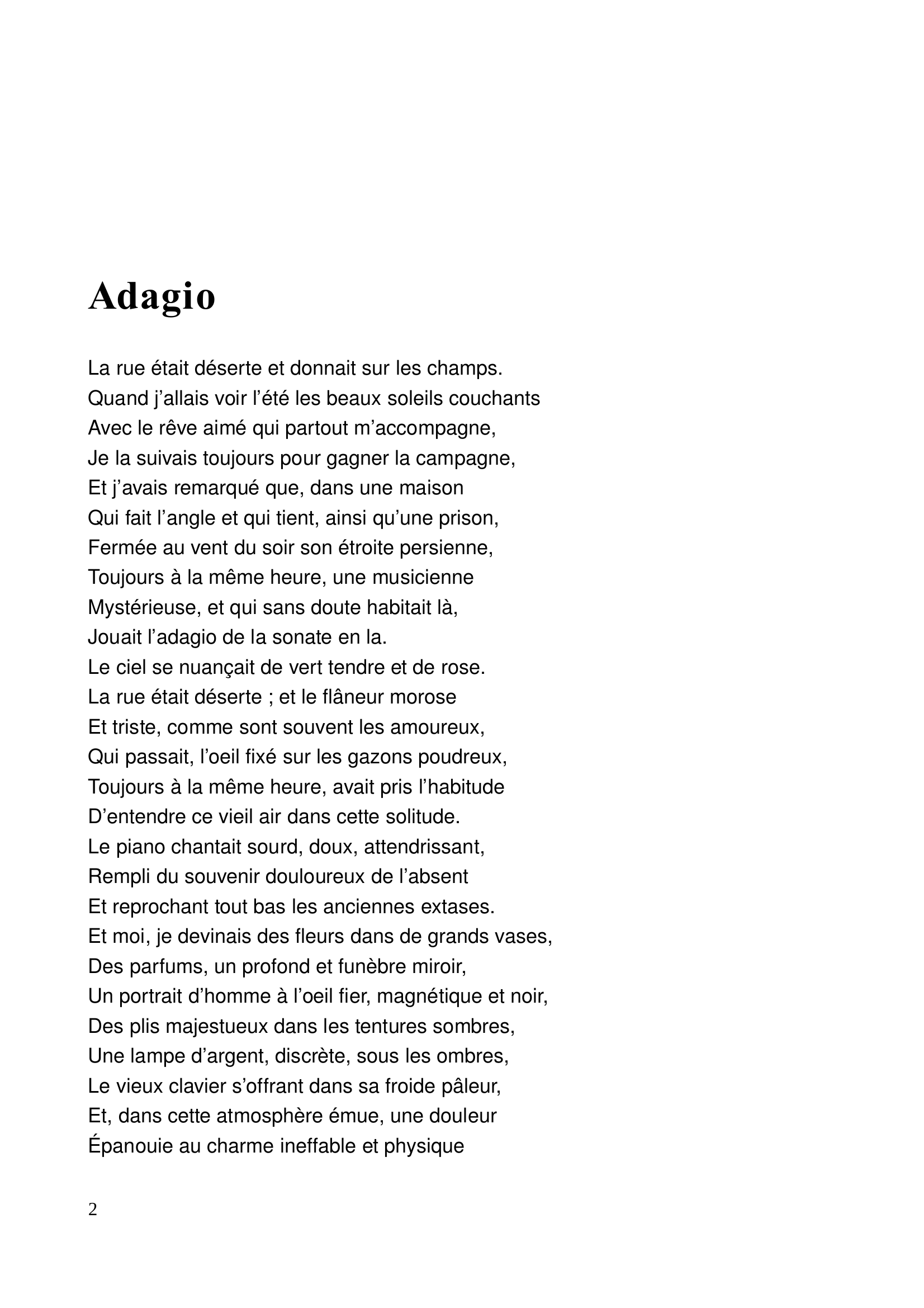poésie anthologie
Publié le 11/05/2015

Extrait du document
« Adagi o La rue était d éserte et donnait sur les champs. Quand j’allais voir l’ été les beaux soleils couchants Avec le r êve aim é qui partout m’accompagne, Je la suivais toujours pour gagner la campagne, Et j’avais remarqu é que, dans une maison Qui fait l’angle et qui tient, ainsi qu’une prison, Ferm ée au vent du soir son étroite persienne, Toujours à la m ême heure, une musicienne Myst érieuse, et qui sans doute habitait l à, Jouait l’adagio de la sonate en la. Le ciel se nuan çait de vert tendre et de rose. La rue était d éserte ; et le fl âneur morose Et triste, comme sont souvent les amoureux, Qui passait, l’oeil fix é sur les gazons poudreux, Toujours à la m ême heure, avait pris l’habitude D’entendre ce vieil air dans cette solitude. Le piano chantait sourd, doux, attendrissant, Rempli du souvenir douloureux de l’absent Et reprochant tout bas les anciennes extases. Et moi, je devinais des fleurs dans de grands vases, Des parfums, un profond et fun èbre miroir, Un portrait d’homme à l’oeil fier, magn étique et noir, Des plis majestueux dans les tentures sombres, Une lampe d’argent, discr ète, sous les ombres, Le vieux clavier s’offrant dans sa froide p âleur, Et, dans cette atmosph ère émue, une douleur É panouie au charme ineffable et physique 2. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- POÉSIE (1946-1967). Anthologie poétique de Philippe Jaccottet (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Anthologie poésie
- Anthologie poésie du 19ème siècle
- Prépace d'anthologie poétique de la poésie engagée
- Anthologie poétique: Poésie