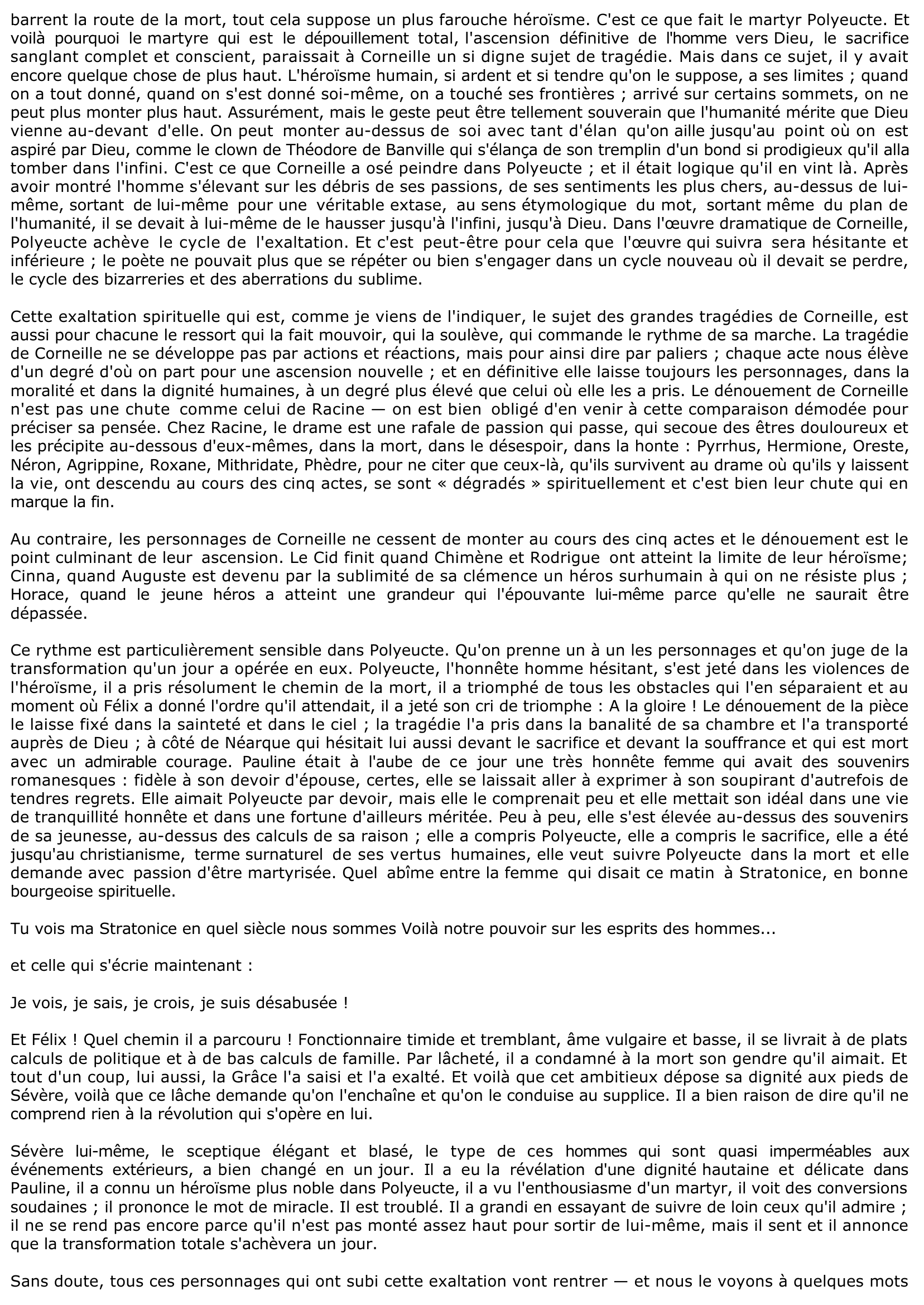Polyeucte, tragédie de l'exaltation.
Publié le 15/03/2011

Extrait du document
Les personnages que Corneille a jetés dans son drame sont des êtres humains, liés à nous tous dans la vérité de la nature ; et nous le verrons dans un autre chapitre. Mais ce qui nous frappe en eux tout d'abord, ce n'est pas ce par quoi ils sont nos frères ; au contraire, ils nous semblent lointains, différents de nous, étrangers, d'une autre race, d'une autre substance morale. Leurs pensées et leurs sentiments contredisent nos pensées, nos sentiments ; leurs actes tiennent dune féerie idéaliste qui n'a aucun rapport avec notre lâcheté coutumière. Corneille a voulu cette violence qui est peut-être ce qu'il y a de plus fondamental dans sa conception de la tragédie. Qu'est-ce que la tragédie ? La vie quotidienne de l'homme ordinaire n'est pas tragique. Elle est faite d'un tissu de pauvres pensées, de préoccupations égoïstes, de gestes vulgaires. Habituellement, dans une journée d'homme, il ne se passe rien ; ou si on discerne quelques accidents à travers cette banalité plate, en eux-mêmes et dans les réactions apeurées qu'ils provoquent, ils sont surtout comiques. C'est, en effet, le domaine propre de la comédie, ou du moins d'une certaine comédie qui s'applique à peindre les mœurs.
«
barrent la route de la mort, tout cela suppose un plus farouche héroïsme.
C'est ce que fait le martyr Polyeucte.
Etvoilà pourquoi le martyre qui est le dépouillement total, l'ascension définitive de l'homme vers Dieu, le sacrificesanglant complet et conscient, paraissait à Corneille un si digne sujet de tragédie.
Mais dans ce sujet, il y avaitencore quelque chose de plus haut.
L'héroïsme humain, si ardent et si tendre qu'on le suppose, a ses limites ; quandon a tout donné, quand on s'est donné soi-même, on a touché ses frontières ; arrivé sur certains sommets, on nepeut plus monter plus haut.
Assurément, mais le geste peut être tellement souverain que l'humanité mérite que Dieuvienne au-devant d'elle.
On peut monter au-dessus de soi avec tant d'élan qu'on aille jusqu'au point où on estaspiré par Dieu, comme le clown de Théodore de Banville qui s'élança de son tremplin d'un bond si prodigieux qu'il allatomber dans l'infini.
C'est ce que Corneille a osé peindre dans Polyeucte ; et il était logique qu'il en vint là.
Aprèsavoir montré l'homme s'élevant sur les débris de ses passions, de ses sentiments les plus chers, au-dessus de lui-même, sortant de lui-même pour une véritable extase, au sens étymologique du mot, sortant même du plan del'humanité, il se devait à lui-même de le hausser jusqu'à l'infini, jusqu'à Dieu.
Dans l'œuvre dramatique de Corneille,Polyeucte achève le cycle de l'exaltation.
Et c'est peut-être pour cela que l'œuvre qui suivra sera hésitante etinférieure ; le poète ne pouvait plus que se répéter ou bien s'engager dans un cycle nouveau où il devait se perdre,le cycle des bizarreries et des aberrations du sublime.
Cette exaltation spirituelle qui est, comme je viens de l'indiquer, le sujet des grandes tragédies de Corneille, estaussi pour chacune le ressort qui la fait mouvoir, qui la soulève, qui commande le rythme de sa marche.
La tragédiede Corneille ne se développe pas par actions et réactions, mais pour ainsi dire par paliers ; chaque acte nous élèved'un degré d'où on part pour une ascension nouvelle ; et en définitive elle laisse toujours les personnages, dans lamoralité et dans la dignité humaines, à un degré plus élevé que celui où elle les a pris.
Le dénouement de Corneillen'est pas une chute comme celui de Racine — on est bien obligé d'en venir à cette comparaison démodée pourpréciser sa pensée.
Chez Racine, le drame est une rafale de passion qui passe, qui secoue des êtres douloureux etles précipite au-dessous d'eux-mêmes, dans la mort, dans le désespoir, dans la honte : Pyrrhus, Hermione, Oreste,Néron, Agrippine, Roxane, Mithridate, Phèdre, pour ne citer que ceux-là, qu'ils survivent au drame où qu'ils y laissentla vie, ont descendu au cours des cinq actes, se sont « dégradés » spirituellement et c'est bien leur chute qui enmarque la fin.
Au contraire, les personnages de Corneille ne cessent de monter au cours des cinq actes et le dénouement est lepoint culminant de leur ascension.
Le Cid finit quand Chimène et Rodrigue ont atteint la limite de leur héroïsme;Cinna, quand Auguste est devenu par la sublimité de sa clémence un héros surhumain à qui on ne résiste plus ;Horace, quand le jeune héros a atteint une grandeur qui l'épouvante lui-même parce qu'elle ne saurait êtredépassée.
Ce rythme est particulièrement sensible dans Polyeucte.
Qu'on prenne un à un les personnages et qu'on juge de latransformation qu'un jour a opérée en eux.
Polyeucte, l'honnête homme hésitant, s'est jeté dans les violences del'héroïsme, il a pris résolument le chemin de la mort, il a triomphé de tous les obstacles qui l'en séparaient et aumoment où Félix a donné l'ordre qu'il attendait, il a jeté son cri de triomphe : A la gloire ! Le dénouement de la piècele laisse fixé dans la sainteté et dans le ciel ; la tragédie l'a pris dans la banalité de sa chambre et l'a transportéauprès de Dieu ; à côté de Néarque qui hésitait lui aussi devant le sacrifice et devant la souffrance et qui est mortavec un admirable courage.
Pauline était à l'aube de ce jour une très honnête femme qui avait des souvenirsromanesques : fidèle à son devoir d'épouse, certes, elle se laissait aller à exprimer à son soupirant d'autrefois detendres regrets.
Elle aimait Polyeucte par devoir, mais elle le comprenait peu et elle mettait son idéal dans une viede tranquillité honnête et dans une fortune d'ailleurs méritée.
Peu à peu, elle s'est élevée au-dessus des souvenirsde sa jeunesse, au-dessus des calculs de sa raison ; elle a compris Polyeucte, elle a compris le sacrifice, elle a étéjusqu'au christianisme, terme surnaturel de ses vertus humaines, elle veut suivre Polyeucte dans la mort et elledemande avec passion d'être martyrisée.
Quel abîme entre la femme qui disait ce matin à Stratonice, en bonnebourgeoise spirituelle.
Tu vois ma Stratonice en quel siècle nous sommes Voilà notre pouvoir sur les esprits des hommes...
et celle qui s'écrie maintenant :
Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée !
Et Félix ! Quel chemin il a parcouru ! Fonctionnaire timide et tremblant, âme vulgaire et basse, il se livrait à de platscalculs de politique et à de bas calculs de famille.
Par lâcheté, il a condamné à la mort son gendre qu'il aimait.
Ettout d'un coup, lui aussi, la Grâce l'a saisi et l'a exalté.
Et voilà que cet ambitieux dépose sa dignité aux pieds deSévère, voilà que ce lâche demande qu'on l'enchaîne et qu'on le conduise au supplice.
Il a bien raison de dire qu'il necomprend rien à la révolution qui s'opère en lui.
Sévère lui-même, le sceptique élégant et blasé, le type de ces hommes qui sont quasi imperméables auxévénements extérieurs, a bien changé en un jour.
Il a eu la révélation d'une dignité hautaine et délicate dansPauline, il a connu un héroïsme plus noble dans Polyeucte, il a vu l'enthousiasme d'un martyr, il voit des conversionssoudaines ; il prononce le mot de miracle.
Il est troublé.
Il a grandi en essayant de suivre de loin ceux qu'il admire ;il ne se rend pas encore parce qu'il n'est pas monté assez haut pour sortir de lui-même, mais il sent et il annonceque la transformation totale s'achèvera un jour.
Sans doute, tous ces personnages qui ont subi cette exaltation vont rentrer — et nous le voyons à quelques mots.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- POLYEUCTE. « Tragédie chrétienne » en cinq actes et en vers de Pierre Corneille (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- POLYEUCTE. Protagoniste de la tragédie homonyme ( 1642) de Pierre Corneille
- SÉVÈRE. Personnage de la tragédie de Pierre Corneille Polyeucte
- Polyeucte, tragédie en vers et en cinq actes de Corneille (1643).
- Un critique écrit à propos de « Polyeucte » : « Dans cette tragédie où l’action de la grâce est toujours présente, le comportement et l’évolution de Polyeucte et de Pauline restent pourtant, d’un bout à l’autre de la pièce, conformes à la vraisemblance psychologique. » En retraçant d’une manière précise l’évolution psychologique des deux personnages vous justifierez le jugement de ce critique.