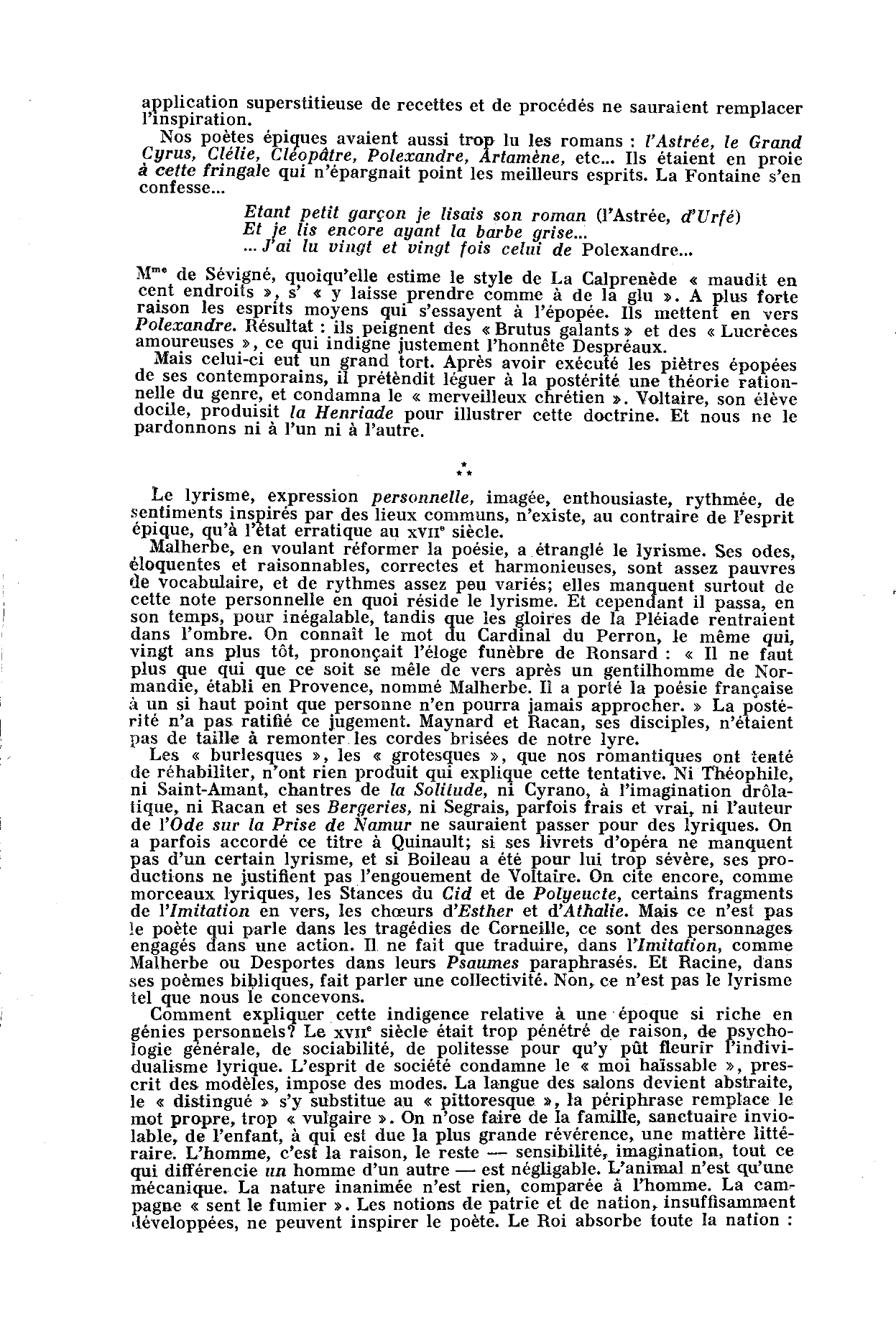Quels genres poétiques ont été le plus cultivés et avec le plus de succès au XVIIe siècle, et pourquoi ceux-là plutôt que d'autres ?
Publié le 16/02/2012

Extrait du document
On peut dire que tous les genres poétiques ont été cultivés au xvne siècle; mais non avec un égal succès. Entendons-nous d'ailleurs sur ce mot. Tels vers médiocres, accueillis avec enthousiasme par les contemporains, ne sont plus célèbres que par leur niaiserie ou leur ridicule. Les sonnets de Benserade et de Voiture, qui mirent en effervescence les beaux-esprits de jadis, risqueraient de laisser froids les lettrés d'aujourd'hui. Nous envisagerons donc la question par rapport à nous, autant que par rapport aux hommes d'autrefois. Le temps a achevé son travail de discrimination : nous savons de science certaine ce qui est chef-d'oeuvre et ce qui ne l'est point. C'est à sa lumière et sous sa conduite que nous circulerons dans ce labyrinthe où le meilleur côtoie le pire....
«
application superstitieuse de recettes et de procedes
ne sauraient remplacer
l'inspiration.
Nos pokes epiques avaient aussi trap lu les romans :l'Astree, le Grand
Cyrus, Cle lie, Cleoptitre, Polexandre, Artamene, etc...
Its etaient en proie
a cette fringale qui n'epargnait point les meilleurs esprits.
La Fontaine s'en
confesse...
Etant petit garcon je lisais son roman (rAstree, d'Urfe)
Et je lis encore avant la barbe grise...
J'ai lu vingt et vingt fois celui de Polexandre...
Alm' de Sevigne, quoiqu'elle estime le style de La Calprenede « maudit en
cent endroits », s' « y laisse prendre comme a de la glu ».
A plus forte
raison les esprits moyens qui s'essayent a repopee.
Its mettent en vers
Polexandre.
Resultat : ils peignent des « Brutus galants » et des « Lucreces
amoureuses », ce qui indigne justement rhonnete Despreaux.
Mais celui-ci eut un grand tort.
Apres avoir execute les pietres epopees
de ses contemporains, iI pretendit leguer a la posterite une theorie ration-
nelle du genre, et condamna le « merveilleux chretien ».
Voltaire, son eleve
docile, produisit la Henriade pour illustrer cette doctrine.
Et nous ne le
pardonnons ni a l'un ni a l'autre.
Le lyrisme, expression personnelle, imagee, enthousiaste, rythmee, de
sentiments inspires par des lieux communs, n'existe, au contraire de I'esprit
epique, qu'a l'etat erratique au xvii' siecle.
Malherbe, en voulant reformer la poesie, a etrangle le lyrisme.
Ses odes,
eloquentes et raisonnables, correctes et harmonieuses, sont assez pauvres
fie vocabulaire, et de rythmes assez peu varies; elles manquent surtout de
cette note personnelle en quoi reside le lyrisme.
Et cependant it passa, en
son temps, pour inegalable, tandis que les gloires de la Pleiade rentraient
dans l'ombre.
On connait le mot du Cardinal du Perron, le meme qui,
vingt ans plus tot, prononcait reloge funebre de Ronsard : « II ne faut
plus que qui que ce soit se mele de vers apres un gentilhomme de Nor-
mandie, etabli en Provence, nomme Malherbe.
II a porte la poesie francaise un si haut point que personne n'en pourra jamais approcher.
» La poste-
rite n'a pas ratifie ce jugement.
Maynard et Racan, ses disciples, n'etaient
pas de tailie a remonter les cordes brisees de notre lyre.
Les « burlesques », les « grotesques », que nos romantiques ont tente
de rehabiliter, Wont rien produit qui explique cette tentative.
Ni Theophi/e,
ni Saint-Amant, chantres de la Solitude, ni Cyrano, a l'imagination drola-
tique, ni Racan et ses Bergeries, ni Segrais, parfois frais at vrai, ni l'auteur
de l'Ode sur la Prise de Namur ne sauraient passer pour des lyriques.
On
a parfois accorde ce titre a Quinault; si ses livrets d'opera ne manquent
pas d'un certain lyrisme, et si Boileau a ete pour lui trop severe, ses pro-
ductions ne justifient pas l'engouement de Voltaire.
On cite encore, comme
morceaux lyriques, les Stances du Cid et de Polyeucte, certains fragments
de l'Imitation en vers, les chceurs d'Esther et d'Athalie.
Mais ce n'est pas
le poke qui park dans les tragedies de Corneille, ce sont des personnages engages dans une action.
Il ne fait que traduire, dans l'Imitation, comme
Malherbe ou Desportes dans leurs Psaurnes paraphrases.
Et Racine, dans
ses poemes bibliques, fait parler une collectivite.
Non, ce n'est pas le lyrisme tel que nous Ie concevons.
Comment expliquer cette indigence relative a une époque si riche en
genies personnels? Le xvir siecle kali trop penetre de raison, de psycho-
logie generale, de sociabilite, de politesse pour qu'y pat fleurir l'indivi-
dualisme lyrique.
L'esprit de societe condamne le « mop.
haissable », pres-
crit des modeles, impose des modes.
La Iangue des salons devient abstraite,
le « distingue » s'y substitue au « pittoresque », la periphrase rempIace le mat propre, trop « vulgaire ».
On n'ose faire de Ia famine, sanctuaire invio-
lable, de l'enf ant, a qui est due la plus grande reverence, une matiere litte-
raire.
L'homme, c'est la raison, le reste - sensibilite, imagination, tout ce
qui differencie un homme d'un autre - est negligable.
L'animal n'est qu'une mecanique.
La nature inanimee n'est rien, comparee a l'homme.
La cam,
pagne « sent le fumier ».
Les notions de patrie et de nation, insuffisamment
,leveloppees, ne peuvent inspirer le poke.
Le Roi absorbe toute Ia nation :
application superstitieuse de recettes et de procédés ne sauraient remplacer l'inspiration.
Nos poètes épiques avaient aussi trop lu les romans : VAstrée, le Grand Cyrus, Clehe, Cleopâtre, Polexandre, Art amène, etc..
Ils étaient en proie a cette fringale qui n'épargnait point les meilleurs esprits. La Fontaine s'en confesse...
Etant petit garçon je lisais son roman (l'Astrée, d'Urfé) Et je lis encore ayant la barbe grise...
...Tai lu vingt et vingt fois celui de Polexandre...
Mme
de Sévigné, quoiqu'elle estime le style de La Calprenède « maudit en cent endroits », s « y laisse prendre comme à de la glu ».
A plus forte raison les esprits moyens qui s'essayent à l'épopée.
Ils mettent en vers
Polexandre. Résultat : ils peignent des « Brutus galants » et des « Lucrèces amoureuses », ce qui indigne justement l'honnête Despréaux.
Mais celui-ci eut un grand tort. Après avoir exécuté les piètres épopées de ses contemporains, il prétendit léguer à la postérité une théorie ration
nelle du genre, et condamna le « merveilleux chrétien ». Voltaire, son élève docile, produisit la Henriade pour illustrer cette doctrine. Et nous ne le pardonnons ni à l'un ni à l'autre.
Le lyrisme, expression personnelle, imagée, enthousiaste, rythmée, de sentiments inspirés par des lieux communs, n'existe, au contraire de Fesprit épique, qu'à Fetat erratique au xvne siècle.
Malherbe, en voulant réformer la poésie, a étranglé le lyrisme. Ses odes, éloquentes et raisonnables, correctes et harmonieuses, sont assez pauvres
de vocabulaire, et de rythmes assez peu variés; elles manquent surtout de cette note personnelle en quoi réside le lyrisme. Et cependant il passa, en son temps, pour inégalable* tandis que les gloires de la Pléiade rentraient
dans l'ombre. On connaît le mot du Cardinal du Perron, le même qui, vingt ans plus tôt, prononçait l'éloge funèbre de Ronsard ; « Il ne faut
plus que qui que ce soit se mêle de vers après un gentilhomme de Nor
mandie, établi en Provence, nommé Malherbe. Il a porté la poésie française
à un si haut point que personne n'en pourra jamais approcher. » La posté
rité n'a pas ratifié ce jugement.
Maynard et Racan, ses disciples, n'étaient pas de taille à remonter les cordes brisées de notre lyre.
Les « burlesques », les « grotesques », que nos romantiques ont tenté de réhabiliter, n'ont rien produit qui explique cette tentative. Ni Théophile, ni Saint-Amant, chantres de la Solitude, ni Cyrano, à l'imagination drola
tique, ni Racan et ses Bergeries, ni Segrais, parfois frais et vrai, ni Fauteur
de YOde sur la Prise de Namur ne sauraient passer pour des lyriques. On a parfois accordé ce titre à Quinault; si ses livrets d'opéra ne manquent
pas d'un certain lyrisme, et si Boileau a été pour lui trop sévère, ses pro
ductions ne justifient pas l'engouement de Voltaire. On eite encore, comme morceaux lyriques, les Stances du Cid et de Polyeucte, certains fragments
de Y Imitation en vers, les chœurs d'Esther et d'Athalie.
Mais ce n'est pas le poète qui parle dans les tragédies de Corneille, ce sont des personnages engagés dans une action. Il ne fait que traduire, dans Ylmitation, comme Malherbe ou Desportes dans leurs Psaumes paraphrasés.
Et Racine, dans
ses poèmes bibliques, fait parler une collectivité.
Non, ce n'est pas le lyrisme tel que nous le concevons.
Comment expliquer cette indigence relative
à une époque si riche en
génies personnels? Le xvne siècle était trop pénétré de raison, de psycho logie générale, de sociabilité, de politesse pour qu'y pût fleurir l'indivi dualisme lyrique.
L'esprit de société condamne le « moi haïssable », pres crit des modèles, impose des modes. La langue des salons devient abstraite,
le « distingué » s'y substitue au « pittoresque », la périphrase remplace le mot propre, trop « vulgaire ».
On n'ose faire de la famille, sanctuaire invio lable, de l'enfant, à qui est due la plus grande révérence, une matière litté raire. L'homme, c'est la raison, le reste — sensibilité, imagination, tout ce qui différencie un homme d'un autre — est négligable. L'animal n'est qu'une mécanique.
La nature inanimée n'est rien, comparée à l'homme. La cam^ pagne « sent le fumier ».
Les notions de patrie et de nation, insuffisamment développées, ne peuvent inspirer le poète.
Le Roi absorbe toute la nation :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation Introduction : La comédie et la tragédie connurent un grand succès au XVIIe siècle.
- Les genres poétiques dans la seconde moitié du XVIe siècle
- LE XVIIe SIÈCLE - LOUIS XIII
- Genres et Formes de l'Argumentation XVIIe et XVIIIe siècles
- Le personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours