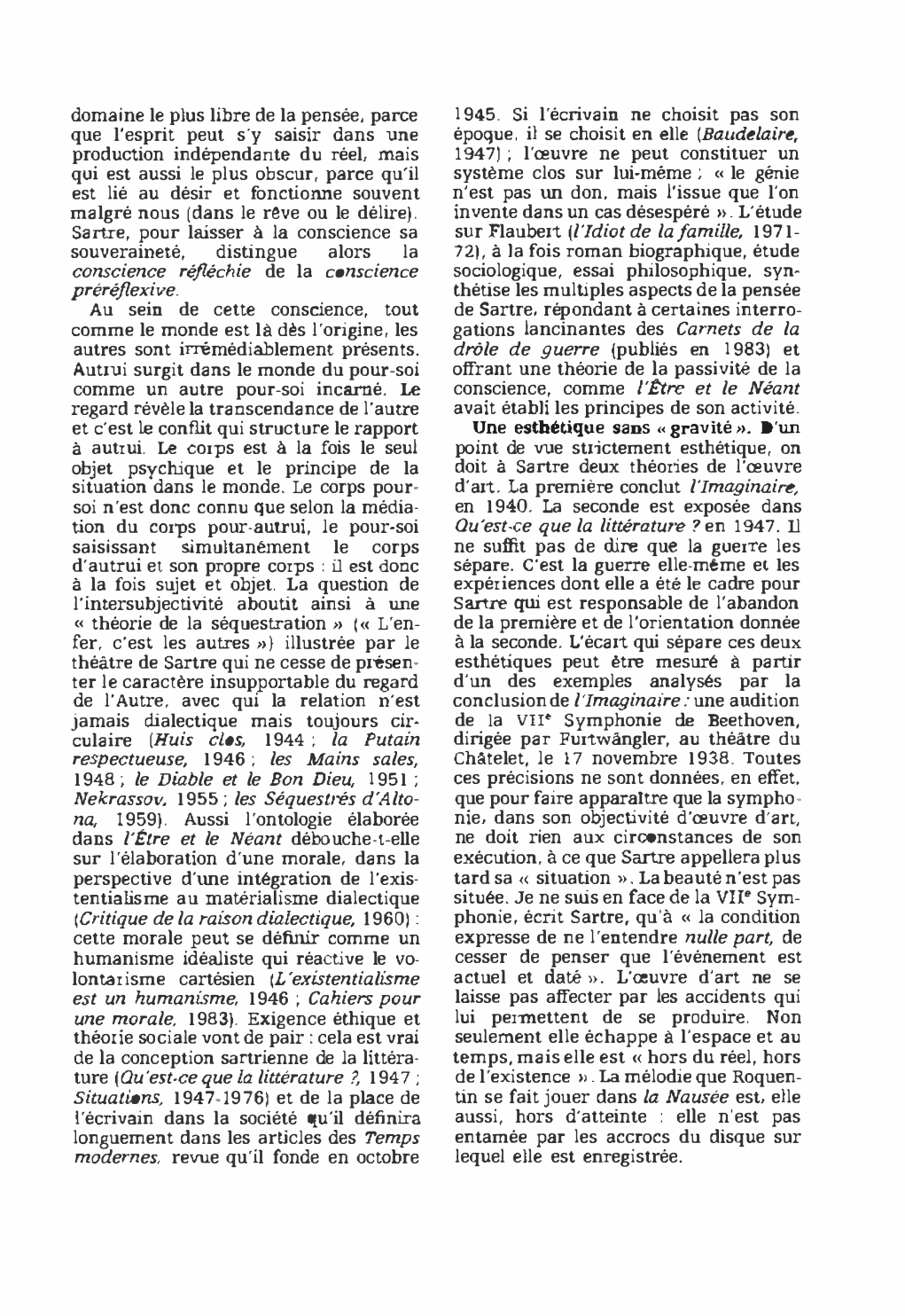SARTRE (Jean-Paul)
Publié le 11/05/2019

Extrait du document

domaine le plus libre de la pensée, parce que l'esprit peut s'y saisir dans une production indépendante du réel, mais qui est aussi le plus obscur, parce qu'il est lié au désir et fonctionne souvent malgré nous (dans le rêve ou le délire}. Sartre, pour laisser à la conscience sa souveraineté, distingue alors la conscience réfléchie de la conscience préréflexive.
Au sein de cette conscience, tout comme le monde est là dès l'origine. les autres sont irrémédiablement présents. Autrui surgit dans le monde du pour-soi comme un autre pour-soi incarné. Le regard révèle la transcendance de l'autre et c'est le conflit qui structure le rapport à autrui. Le corps est à la fois le seul objet psychique et le principe de la situation dans le monde. Le corps pour-soi n'est donc connu que selon la médiation du corps pour-autrui, le pour-soi saisissant simultanément le corps d'autrui et son propre corps : il est donc à la fois sujet et objet. La question de l'intersubjectivité aboutit ainsi à une « théorie de la séquestration » ( « L'enfer. c'est les autres ») illustrée par le théâtre de Sartre qui ne cesse de présenter le caractère insupportable du regard de l'Autre. avec qui la relation n'est jamais dialectique mais toujours circulaire (Huis clos, 1944 ; la Putain respectueuse, 1946 ; les Mains sales, 1948 ; le Diable et le Bon Dieu, 1951 ; Nekrassov, 1955; les Séquestrés d'Alto-na, 1959). Aussi l'ontologie élaborée dans l'ttre et le Néant débouche-t-elle sur l'élaboration d'une morale. dans la perspective d'une intégration de l'existentialisme au matérialisme dialectique (Critique de la raison dialectique, 1960) : cette morale peut se définir comme un humanisme idéaliste qui réactive le volontarisme cartésien (L'existentialisme est un humanisme, 1946 ; Cahiers pour une morale, 1983). Exigence éthique et théorie so ciale vont de pair : cela est vrai de la conception sartrienne de la littérature (Qu'est-ce que la littérature ?, 1947 : Situations, 1947-1976) et de la place de l'écrivain dans la société qu'il définira longuement dans les articles des Temps modernes, revue qu'il fonde en octobre
ont dégagé les grands complexes affectifs, les modèles proposés et les frustrations imposées à l'enfant qui ont donné naissance à l'écrivain. Orphelin d'un père officier de marine « mort en bas age » en 1906, élevé par une mère trop humble (Anne-Marie Schweitzer) et un grand-père trop cabotin, l'enfant se perd dans une réalité contradictoire. Pour y échapper, il se réfugie, très tôt, dans les livres. Adulte, il y reviendra toujours, malgré sa volonté d'engagement (compagnon de route difficultueux des communistes, membre du tribunal Russell, militant avec les « maoïstes >> français, directeur de la Cause du peuple ou de Libération).
Désir de rejoindre la vie dans l'action, impossibilité de coïncider totalement avec cette action, sentiment d'inauthenticité et de mensonge à soi-même, tels seront les problèmes de Sartre et de ses héros, spectateurs d'eux-mêmes, vivant leur liberté comme une maladie (la Nausée, 1938 ; le Mur, 1939 ; les Mouches, 1943). Cette « mauvaise foi » existentielle reçoit son statut dans l'Être et le Néant ( 1943), où la distinction de l'en-soi et du pour-soi, de la facticité et de la transcendance, ouvre une philosophie de la conscience et de la souveraine, que les romans tenteront, par la suite, d'illustrer (les Chemins de la liberté, 1945-1949).
Sartre, critiquant la conception classique des rapports du monde et du moi, cherche une voie distincte à la fois de la psychologie bergsomenne de la vie intérieure et de la psychanalyse freudienne (ainsi, il ramène l'inconscient à la << mauvaise foi »). Il la trouve chez Husserl et construit une phénoménologie (la Transcendance de l'Ego, 1937) fondée sur la notion d'intentionnalité de la conscience (Esquisse d'une théorie des émotions, 1939). La conscience peut viser le monde de deux manières : en tant que perception, elle le pose dans sa réalité, en tant qu'imagination dans son irréalité. La passion n'est pas pulsion, mais conscience intentionnelle. L'image n'est pas une chose, mais un acte (l'Imagination, 1936 ; l'Imaginaire. 1940). Sartre porte son attention sur le
Si l'écrivain ne choisit pas son époque. il se choisit en elle (Baudelaire, 1947); l'œuvre ne peut constituer un système clos sur lui-même : « le génie n'est pas un don, mais l'issue que l'on invente dans un cas désespéré ». L'étude sur Flaubert (l'Idiot de la famille, 197172), à la fois roman biographique, étude sociologique, essai philosophique, synthétise les multiples aspects de la pensée de Sartre. répondant à certaines interrogations lancinantes des Carnets de la drôle de guerre (publiés en 1983) et offrant une théorie de la passivité de la conscience, comme l'Être et le Néant avait établi les principes de son activité.
Une esthétique sans \"gravité». D'un point de vue strictement esthétique, on doit à Sartre deux théories de l'œuvre d'art. La première conclut l'Imaginaire, en 1940. La seconde est exposée dans Qu'est-ce que la littérature ? en 1947. al ne suffit pas de dre que la guerre les sépare. C'est la guerre elle-même et les expériences dont elle a été le cadre pour Sartre qui est responsable de l'abandon de la première et de l'orientation donnée à la seconde. L'écart qui sépare ces deux esthétiques peut être mesuré à partir d'un des exemples analysés par la conclusion de l'Imaginaire: une audition de la VIIe Symphonie de Beethoven, dirigée par Furtwângler, au théâtre du Châtelet, le 17 novembre 1938. Toutes ces précisions ne sont données. en effet. que pour faire apparaître que la symphonie, dans son objectivité d'œuvre d'art, ne doit rien aux circonstances de son exécution. à ce que Sartre appellera plus tard sa « situation >>.La beauté n'est pas située. Je ne suis en face de la VIIe Symphonie. écrit Sartre, qu'à « la condition expresse de ne l'entendre nulle part, de cesser de penser que l'événement est actuel et daté». L'œuvre d'art ne se laisse pas affecter par les accidents qui lui permettent de se produire. Non seulement elle échappe à l'espace et au temps, mais elle est « hors du réel, hors de l'existence > .La mélodie que Roquen-tin se fait jouer dans la Nausée est, elle aussi, hors d'atteinte : elle n'est pas entamée par les accrocs du disque sur lequel elle est enregistrée.

«
domaine
le plus libre de la pensée, parce
que l'esprit peut s'y saisir dans une
production indépendante du réel, mais
qui est aussi le p lus obscur, parce qu'il
est lié au désir et foncti onn e souvent
malgré nous (dans le rêve ou le délire}.
Sartre, pour laisser à la conscience sa
souveraineté, distingue alors la
conscience réfléchie de la conscience
préréj/exive.
Au sein de cette conscience, tout
comme le monde est là dès l' o rig in e.
les
autres sont irré médi ablemen t présents.
Autrui su rgit dans le monde du pour-soi
comme un autre pour-soi incarné.
Le
regard révèle la transcendance de l'autre
et c'est le conflit qui structure le rapport
à autrui.
Le corp s est à la fois le seul
objet psy ch iqu e et le principe de la
situation dans le monde.
Le corps pour
soi n'est donc connu que selon la média
tion du corps pour -au trui, le pour-soi
saisissant simultanément le corps
d'autrui et son propre corps : il est donc
à la fois sujet et objet.
La question de
l'intersubjectivité aboutit ainsi à une
« théorie de la séquestration » ( « L'en
fer.
c'est les autres ») illustrée par le
théâtre de Sartre qui ne cesse de prés en
ter le caractère insupportable du regard
de l'Autre.
avec qui la relation n'est
jamais dialect iq ue mais toujours cir
culaire (Huis clos, 1944 ; la Putain
respectueuse, 1946 ; les Mains sales,
1948 ; le Diable et le Bon Dieu, 1951 ;
Nekrassov, 1955; les Séquestrés d'Alto
na, 1959).
Aussi l'ontologie élaborée
dans l'ttre et le Néant débo uche -t -e ll e
sur l'élaboration d'une morale.
dans la
perspective d'un e intégration de l'exis
tential ism e au ma térialisme dialectique
(Critique de la raison dialectique, 1960) :
cette morale peut se définir comme un
humanisme id éal iste qui réactive le vo
lontarisme cartésien (L'existentialisme
est un humanisme, 1946 ; Cahiers pour
une morale, 1983).
Exigence éthique et
théorie socia le vont de pair : cela est vrai
de la conc eption sartrienne de la littéra
ture (Qu'est-ce que la littérature ?, 194 7 :
Situations, 1947-19 76) et de la pla ce de
l'écrivain dans la société qu'il définira
longuement dans les articles des Temps
modernes, revu e qu'il fonde en octobre 1945.
Si l'écrivain ne choisit pas son
époque.
il se choisit en elle (Baudelaire,
1947); l'œuvre ne peut constituer un
système clos sur lui-même : « le génie
n'est pas un don , mais l'issue que l'on
invente dans un cas désespéré >>.
L'étude
sur Flaubert (l'Idiot de la famille, 1971-
72), à la fois roman biographique, étude
sociologique, essai philosophique, syn
thétise les multiples aspects de la pensée
de Sartre.
rép ond ant à certaines interro
gations lancinantes des Carnets de la
drôle de guerre (p ubli és en 1983) et
o ffr ant une théorie de la passivi té de la
conscience, comme l'Sere et le Néant
a vait établi les principes de son activité.
Une esthétique sans "gravité».
D'un
p oi nt de vue strictement esthétique, on
doit à Sartre deux théories de l'œuvre
d 'art .
La première conclut l'Imaginaire,
en 1940.
La seconde est exposée dans
Qu'est-ce que la littérature ? en 194 7.
Il
ne suffit pas de dire que la guerre les
sépare.
C'est la guerre elle-même et les
expériences dont elle a été le cadre pour
Sartre qui est responsable de l'abandon
de la première et de l'orientation donnée
à la seconde.
L'écart qui sépare ces deux
esthétiques peut être mesuré à partir
d'un des exemples analysés par la
conclusion de l'Imaginaire: une audition
de la vn• Symphonie de Beethoven,
dirigée par Furtwângler, au théâtre du
Châte le t, le 17 novembre 1938.
Toutes
ces pré cis io ns ne sont données.
en effe t.
que pour faire apparaître que la sympho
nie, dan s son objectivité d'œuvre d'art,
ne doit rien aux circonstances de son
exécution.
à ce que Sartre appellera plus
tard sa>.La beauté n'est pas
située.
Je ne suis en face de la vn• Sym
phonie.
écrit Sartre, qu'à « la condition
expresse de ne l'entendre nulle part, de
cesser de penser que l'événement est
ac tu el et da té».
L'œuvre d'art ne se
laisse pas affecter par les accidents qui
lui permettent de se produire.
Non
seulement elle échappe à l'espace et au
temps, mais elle est « hors du réel, hors
de l'existence >>.La mélodie que Roquen
tin se fait jo u er dans la Nausée est, elle
aussi, hors d'atteinte : elle n'est pas
entamée par les accrocs du disque sur
lequel elle est enregis trée..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre » JEAN-PAUL SARTRE
- explication de texte :Jean Paul Sartre L'être et le néant: Lpassé que j'ai à être
- kean de jean-paul sartre
- SITUATIONS de Jean-Paul Sartre : Fiche de lecture
- HUIS CLOS de Jean-Paul Sartre (résumé & analyse)