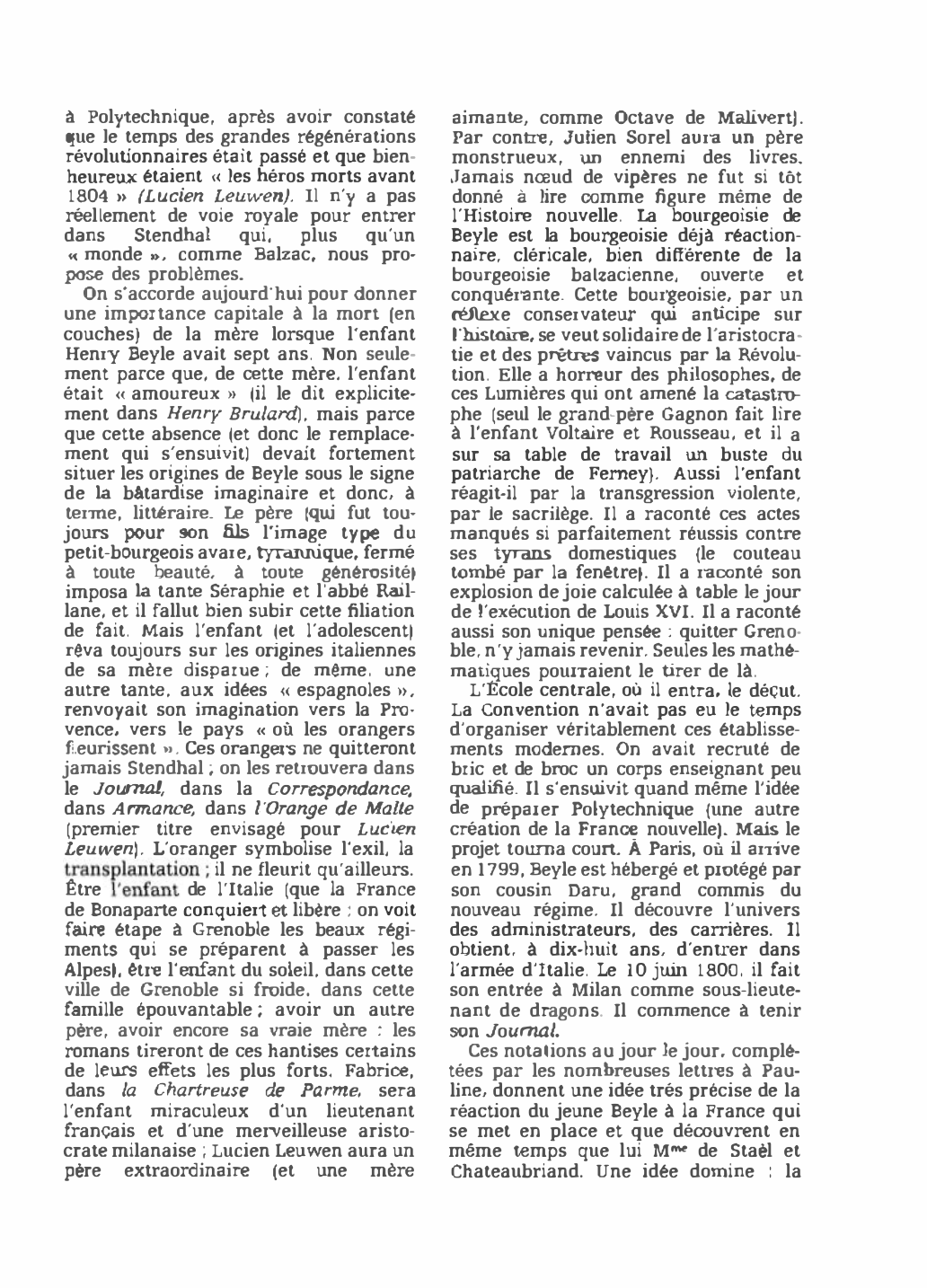STENDHAL (Henry Beyle, dit)
Publié le 16/05/2019

Extrait du document
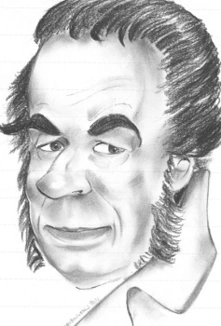
à Polytechnique, après avoir constaté que le temps des grandes régénérations révolutionnaires était passé et que bien heureux étaient « les héros morts avant 1804 » (Lucien Leuwen). Il n'y a pas réellement de voie royale pour entrer dans Stendhal qui, plus qu'un « monde », comme Balzac, nous propose des problèmes.
On s'accorde aujourd'hui pour donner une importance capitale à la mort (en couches) de la mère lorsque l'enfant Henry Beyle avait sept ans. Non seule ment parce que, de cette mère, l'enfant était « amoureux » (il le dit explicitement dans Henry Brulard), mais parce que cette absence (et donc le remplacement qui s'ensuivit) devait fortement situer les origines de Beyle sous le signe de la bâtardise imaginaire et donc, à terme, littéraire. Le père (qui fut toujours pour son fils l'image type du petit-bourgeois avare, tyrannique, fermé à toute beauté, à toute générosité) imposa la tante Séraphie et l'abbé Rail lane, et il fallut bien subir cette filiation de fait. Mais l'enfant (et l’adolescent) rêva toujours sur les origines italiennes de sa mère disparue ; de même, une autre tante, aux idées « espagnoles », renvoyait son imagination vers la Pro vence, vers le pays « où les orangers fleurissent ». Ces orangers ne quitteront jamais Stendhal, on les retrouvera dans le Journal, dans la Correspondance, dans Armance, dans l'Orange de Malte (premier titre envisagé pour Lucien Leuwen}. L'oranger symbolise l'exil, la transplantation ; il ne fleurit qu'ailleurs. Être l'enfant de l'Italie (que la France de Bonaparte conquiert et libère : on voit faire étape à Grenoble les beaux régiments qui se préparent à passer les Alpes), être l'enfant du soleil, dans cette ville de Grenoble si froide, dans cette famille épouvantable ; avoir un autre père, avoir encore sa vraie mère : les romans tireront de ces hantises certains de leurs effets les plus forts. Fabrice, dans la Chartreuse de Parme, sera l'enfant miraculeux d’un lieutenant français et d'une merveilleuse aristocrate milanaise ; Lucien Leuwen aura un père extraordinaire (et une mère
aimante, comme Octave de Malivert). Par contre, Julien Sorel aura un père monstrueux, un ennemi des livres. Jamais nœud de vipères ne fut si tôt donné à lire comme figure même de l'Histoire nouvelle. La bourgeoisie de Beyle est la bourgeoisie déjà réactionnaire, cléricale, bien différente de la bourgeoisie balzacienne, ouverte et conquérante. Cette bourgeoisie, par un réflexe conservateur qui anticipe sur l’histoire, se veut solidaire de l'aristocratie et des prêtres vaincus par la Révolu tion. Elle a horreur des philosophes, de ces Lumières qui ont amené la catastrophe (seul le grand père Gagnon fait lire à l'enfant Voltaire et Rousseau, et il a sur sa table de travail un buste du patriarche de Femey). Aussi l'enfant réagit-il par la transgression violente, par le sacrilège. Il a raconté ces actes manqués si parfaitement réussis contre ses tyrans domestiques (le couteau tombé par la fenêtre). Il a raconté son explosion de joie calculée à table le jour de l'exécution de Louis XVI. Il a raconté aussi son unique pensée : quitter Greno ble, n'y jamais revenir. Seules les mathématiques pourraient le tirer de là.
L'École centrale, où il entra, le déçut. La Convention n'avait pas eu le temps d'organiser véritablement ces établisse ments modernes. On avait recruté de bric et de broc un corps enseignant peu qualifié. Il s'ensuivit quand même l'idée de préparer Polytechnique (une autre création de la France nouvelle). Mais le projet tourna court. À Paris, où il arrive en 1799, Beyle est hébergé et protégé par son cousin Daru, grand commis du nouveau régime. Il découvre l’univers des administrateurs, des carrières. Il obtient, à dix-huit ans, d'entrer dans l'armée d'Italie. Le 10 juin 1800, il fait son entrée à Milan comme sous-lieutenant de dragons Il commence à tenir son Journal.
Ces notations au jour le jour, complétées par les nombreuses lettres à Pauline, donnent une idée très précise de la réaction du jeune Beyle à la France qui se met en place et que découvrent en même temps que lui Mme de Staël et Chateaubriand. Une idée domine : la
STENDHAL (Henry Beyle, dit), écrivain français (Grenoble 1783 - Paris 1842). On peut aborder Stendhal de deux façons : par ses grands romans, qui ont fondé, avec ceux de Balzac, un certain « réalisme » ; par ses innombrables écrits personnels {Journal, correspondance, notes, essais). À mi-chemin se trouvent des livres mal classables : récits de voyage, dissertations sur la musique et la peinture, brochures de polémique politique ou littéraire. Le « beylisme », né vers la fin du xixe s. de la découverte des écrits personnels, aurait tendance à chercher dans les romans des vérifications ou des prolongements de ce qui a été, préalablement, écrit autrement. Les amateurs des romans ont eu tendance à négliger les écrits personnels : c'était la position de Lanson, qui parlait de « paperasses ». Ceux qui s'attachent à l'histoire des idées (et, tout particulièrement, des Idéologues), à la crise du libéralisme, à la dissidence romantique, aux mutations du matérialisme du xviiie s. dans le cadre fortement affectif du siècle révolutionné trouvent en Beyle un des premiers « intellectuels ». De toute façon, il n'est pas possible de l'enfermer dans l'une des « sections » illusoires de son œuvre. Un jour, l'homme qui avait tant réfléchi, tant éprouvé, et qui avait tant à dire a décidé d'écrire dans la forme du roman. Preuve que les autres langages ne suffisaient plus. Ces romans, cependant, n'auraient pas existé sans ces milliers de pages écrites au fil des années sans direction ni destination claire. Stendhal est donc à lire en entier et, si possible, dans l'ordre rigoureux d'écriture : des premières notations du Journal et des premières lettres à la sœur Pauline aux multiples projets et réalisations de
fiction, en passant par toute une série de textes manifestes ou de confidences et en accordant la plus grande importance aux deux tentatives de recompositions du passé que sont, assez tard, les deux autobiographies {Souvenirs d'égotisme, écrits en 1832, publiés en 1892 ; Vie de Henry Brulard, écrite en 1835-36, publiée en 1890). À la différence de Chateaubriand, de Hugo, de Balzac, jamais Stendhal n'a cherché à organiser ni à présenter son œuvre ; pas de préface générale, pas d'avant-propos, ni de « Stendhal raconté ». Plutôt une espèce de chantier multiforme, portant des traces d'ardeur en certains endroits, déserté souvent, jamais cathédrale ni grand ensemble. Comme, par ailleurs, la lecture, le succès, l'influence sont venus bien tard, après la mort, il n'existe pas de figure solide de Stendhal pour ses contemporains. On ne dispose d'aucune clé, d'aucun mode d'emploi, et si des effets de contre-lecture sont possibles, ce n'est qu'à partir de lectures quasiment toutes de notre temps. Stendhal ne nous arrive guère escorté d'un discours pré-sentatif. Il est un peu, à chaque rencontre, à inventer. Peu d'écrivains dépendent sans doute à ce point de leurs lecteurs. La psychanalyse (à laquelle ses textes se prêtent si bien) et le matérialisme historique (peu d'écrivains furent aussi clairement politiques) lui ont fait faire des pas considérables par rapport aux lectures érudites et psychologistes, qui ne sont pas mortes pour autant. Son jacobinisme lui a conservé tout un public « progressiste », tandis que son aristocratisme et son individualisme pouvaient lui assurer d'importantes fidélités chez les tenants d'un élitisme dont lui-même nous apprend la signification profonde. Stendhal est un prodigieux révélateur des capacités de lecture. Le plus curieux est que, sans doute, il ne pensa jamais sérieusement, à son entrée dans le monde, à être un jour un écrivain « Être Chateaubriand ou rien » (Hugo), « être célèbre et être aimé » ou « faire concurrence à l'état civil » (Balzac) ne furent jamais de ses mots d'ordre. Tout au plus être un jour un nouveau Molière, après avoir renoncé
société française redevient conservatrice parce qu elle est « restée » (le mot est capital) « monarchiste ». Non pas devenue, ce qui ne mettrait en cause que l'usurpation napoléonienne, mais bien restée : c'est-à-dire que, dans ses profondeurs, la société française demeure dominée par les valeurs et les pratiques du « paraître », de l'amour-propre, de l'ambition, de la courtisane-rie. La Révolution, en tant qu elle a voulu changer profondément les mœurs, a totalement échoué, ou elle a rêvé. La France est bourgeoise, soumise aux intérêts. Une fois accompli le grand nettoyage nécessaire, une fois réalisé le coup de force indispensable pour assurer la relève du pouvoir, les choses se sont retrouvées en l'état. Dès les années premières du siècle, Beyle (qui rejoint le Chateaubriand de V Essai sur les révolutions} voit terriblement clair sur ce point. Il n'y a pas eu « trahison » de Napoléon, de la noblesse d’Empire, des Thermidoriens devenus les maîtres de la France. Il y a eu, tout simplement, manifestation de ce qu'était en profondeur cette société qui venait de donner au monde un exemple si magnifique et si illusoire d'héroïsme et d'énergie. Cette France-là, dès lors, est sans intérêt. Comme Chateaubriand, comme de Staël, Beyle voit bien qu elle est soumise à de nouvelles féodalités ; il voit bien que l'homme de qualité doit s'y sentir en exil ; il voit, aussi, qu'une nouvelle littérature peut se proposer la peinture et l'analyse de cette France inattendue mais réelle. Ce serait l'objet d'un théâtre à faire, d'un Molière. Chateaubriand disait dans le Génie du christianisme : « La Bruyère nous manque. » Beyle, lui, pense que c'est l'auteur de Tartuffe. Le roman réaliste remplira, à sa manière, ce programme. Mais, au début, on n'y pense guère. Le théâtre étant la forme esthétique dominante, ce sont des comédies que Beyle rêve d’écrire, des corné dies nouvelles qui décriraient la réalité, mais qui aussi exprimeraient les passions. Dépassement donc de la vieille répartition des tâches entre tragédie et comédie. Et l'opéra intervient pour précipiter la réflexion : le si cher Matrimo
nio segreto de Cimarosa ne fait-il pas aller ensemble le lyrisme et l'exactitude ? Ne concilie-t-il pas le pathétique et le quotidien ? Beyle s'inscrit, certes, à la suite des premières réflexions sur le drame, et il les relance à sa manière, grâce, notamment, à ses contacts avec l'étranger. Toute une littérature est morte. Une autre est à inventer. La littérature « à la française », avec problème initial et dénouement bien léché, ne concerne plus le vrai public, le public qui cherche et qui rêve, le public que, de leur côté, cherchent également Chateaubriand et Mmc de Staël : le public en porte-à-faux de la « France nouvelle ».
En même temps, et nouant avec la recherche sur la littérature des liens profonds, se constitue l'éros stendhalien. Il tient entre deux rôles infiniment éloignés. D’une part les amours, les affinités électives, les sympathies profondes, les longues familiarités, mais qui n'aboutissent jamais et qui n'arrivent pas à s'accorder avec le désir, avec l'accomplissement sexuel. D'autre part, les innombrables filles d'auberge, prostituées, actrices ou simplement femmes de rencontre, que l'on n'aime pas, mais avec qui on est « superbe ». Une véritable névrose s'installe : l'amour vrai exclut l'accomplissement amoureux parce qu'il réduit la femme aimée au statut d'objet — d'où le fiasco et la problématique de l'impuissance (Ar-mance). Les femmes qu'on peut avilir, lorsqu’elles deviennent des femmes « eues », sont détruites. D'où, pour ne pas détruire, ne pas avoir. Le cas exemplaire est celui d'Angela Pietra-grua, tant aimée lors du premier séjour à Milan et retrouvée dix ans plus tard : Beyle est, d'abord, totalement incapable de la désirer, au contraire de Mlle Rosa, sous un réverbère, à Marseille, ou de telle jeune personne superbement « eue » à la place de sa cousine, elle, simplement aimée. Il n'y a même pas de libertinage joyeux chez Beyle. La clé se trouve dans une lettre capitale à Pauline : seul l'opéra, et notamment le Matrimonio, peut nous donner un plaisir « non acheté », alors que tout plaisir avec une femme relève toujours plus ou
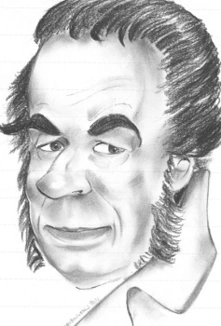
«
à Polytechnique,
après avoir constaté
que Je temps des grandes régénérations
révolutionnaires était passé et que bien
heureux étaient « les héros morts avant
1804 » (Lucien Leuwen).
U n'y a pas
réellement de voie royale pour entrer
dans Stendhal qui, plus qu'un
> (il le dit explicite
ment dans Henry Brulard), mais parce
que cette absence (et donc le remplace
ment qui s'ensuivit) devait fortement
situer les origines de Beyle sous le signe
de la bâtardise imaginaire et donc, à
terme, littéraire.
Le père (qui fut tou
jours pour sen fils l'image type du
petit-bourgeois avare, tyranni que, fermé
à toute beauté, à toute générosité!
imposa la tante Séraphie et l'abbé Ra.il
lane, et il fallut bien subir cette filiation
de fait.
Mais l'enfant (et l'adolescent)
rêva toujours sur les origines italiennes
de sa mère disparue; de même.
une
autre tante, aux idées.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VANINA VANINI. de Stendhal - Henry Beyle (résumé & analyse de l’oeuvre)
- Introduction Stendhal, de son vrai nom Henry Beyle, est un auteur français du 19 eme siècle qui a révolutionné le roman en utilisant le courant romantique et réaliste.
- Vie DE Henry BRULARD, de Stendhal
- Stendhal (Henri Beyle.
- « J'appelle caractère d'un homme sa manière habituelle d'aller à la chasse du bonheur », écrira Stendhal dans son roman autobiographique, Vie de Henry Brulart.