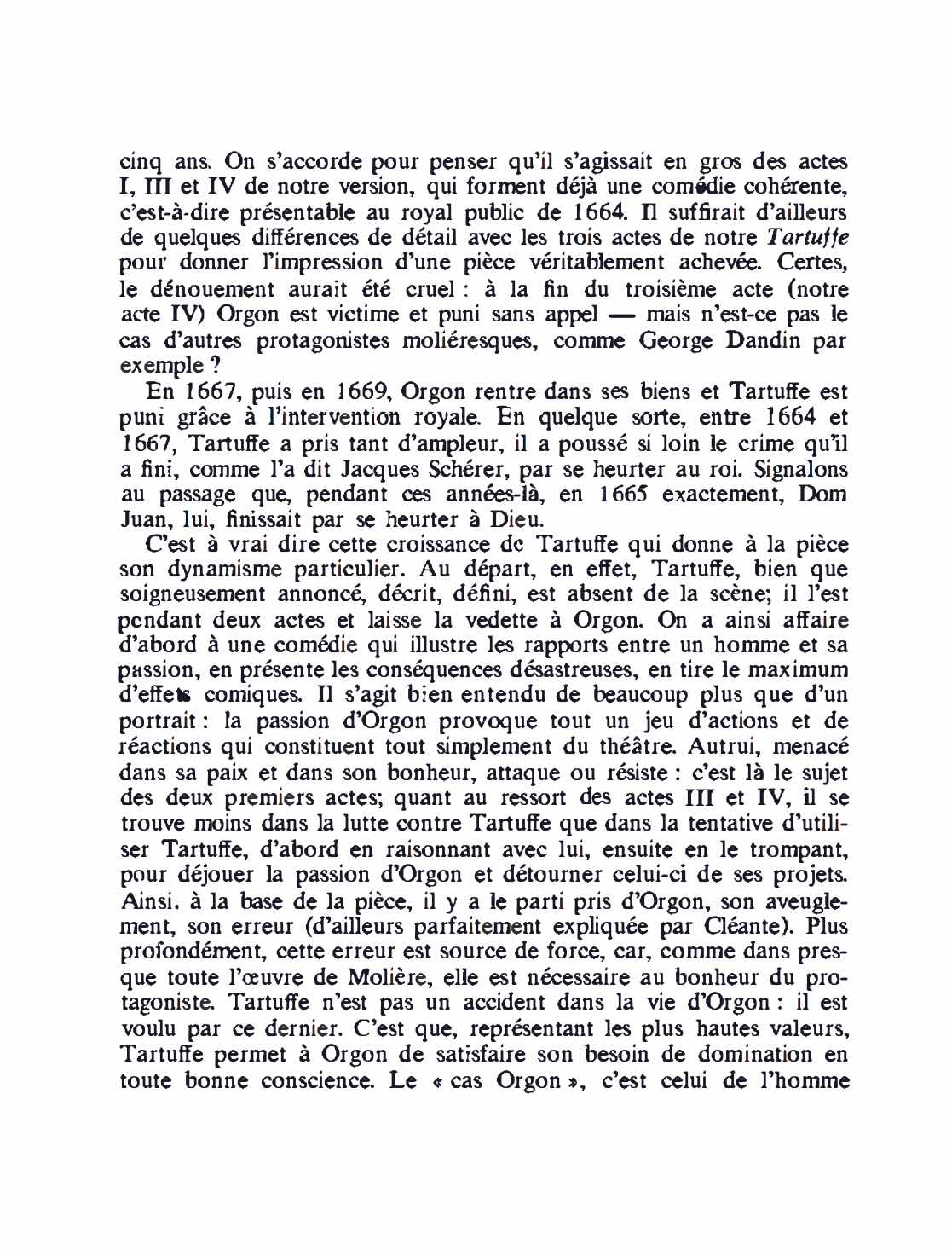STRUCTURE DE « TARTUFFE »
Publié le 26/10/2017

Extrait du document
mais dans une maison bien bourgeoise, au sein d’une petite collectivité familiale qui, dès le lever du rideau, affirme vigoureusement sa propre conception du bonheur. Orgon, en tant que père, est sans conteste le chef de cette collectivité. Alors, au drame de l’aveuglement et de la tromperie est indissolublement lié celui de la corruption du pouvoir. On entend souvent au cours de la pièce un vocabulaire à résonances politiques. C’est que le cadre familial ressemble fort à celui de l’Etat; les actions de chacun ont leurs parallèles dans celles des rois, des ministres, des sujets. On n’attaque pas de front un roi dément accom-
pagné de son mauvais conseiUer sans se mettre en état de rébellion et risquer d’être banni (tel est le cas de Damis). On songe plutôt à ruser comme Dorine, à raisonner comme Cléante ou bien, telle Elmire au troisième acte, à marchander en sous-main. Mais tout cela est vain. La cellule familiale a toutefois la chance, elle, d’avoir un chef au second degré : le roi de France, antithèse exacte du petit roi, Orgon. Or, à force de s’écarter par excès d’appétit du rôle que lui assignait Orgon, Tartuffe, devenu trop avide, trop ambitieux, trop sûr de lui, a commis l’erreur de sortir de la famille où sa niche était assurée; non content de trahir son bienfaiteur, il est allé trop loin, ou trop haut, en se mettant sous le regard, lucide celui-là, du prince. C’est là le troisième mouvement de la pièce, longtemps suspendu, achevé par un apparent coup de théâtre qui est en fait la conclusion nécessaire de cette double course à la tyrannie, à la possession.
STRUCTURE DE « TARTUFFE »
Les dessous de « l’affaire Tartuffe » ne sont pas sans intérêt. Si les détails en demeurent obscurs, tout porte à croire néanmoins qu’une puissante cabale, animée à la fois par des jalousies professionnelles et les inquiétudes dévotes s’est acharnée sur Molière, et cela dès qu’on sut qu’il avait entrepris d’écrire une comédie sur l’hypocrisie religieuse. Les interdictions de Tartuffe seraient en partie un épisode de la lutte confuse qui marque l’histoire religieuse du temps et qui, par le biais des problèmes de conscience, touche à la fois à la haute et à la petite politique. C’est après la mort de puissants dévots comme la reine mère et le prince de Conti, c’est au moment même de la détente amenée par le pape Clément IX, que Tartuffe fut autorisé.
Mais ce n’est pas seulement cette << Cabale des Dévots » et sa déconfiture finale qui piquent la curiosité des chercheurs et des érudits. Nostalgiquement, et sans grand espoir de parvenir à une certitude absolue, ils se posent des questions sur les états perdus de l’œuvre, en particulier sur le premier, dont on ne sait rien. Ou du moins dont on sait fort peu de choses. Des documents nous apprennent qu’en mai 166.1 ce furent « les trois premiers actes» de Tartuffe qui furent joués à Versailles. Malgré l’apparence, la formule n’est pas sans ambiguïté, car ces trois actes écrits en premier par Molière ne sont pas nécessairement les actes I, II et III de la pièce de 1669, postérieure de
«
cinq
ans.
On s'accorde pour penser qu'il s'agissait en gros des actes
I, Ill et IV de notre version, qui forment déjà une comédie cohérente,
c'est-à-dire présentable au royal public de 1664.
II suffira it d'a ill eurs
de quelques différences de détail avec les trois actes de notre Tartuffe
pour donner l'impression d'une pièce véritablement achevée.
Certes,
le dénouement aurait été cruel : à la fin du troisième acte (notre
acte IV) Orgon est victime et puni sans appel -mais n'est-ce pas le
cas d'autres protagonistes moliér esques, comme George Dandin par
e x empl e?
En 1667, puis en 1669, Orgon rentre dans ses biens et Tartuffe est
puni grâce à l' int erve ntion royale.
En quelque sorte, entre 1664 et
1667, Tartuffe a pris tant d'ampleur, il a poussé si loin le crime qu'il
a fini, comme l'a dit Jacques Schérer, par se heurter au roi.
Signa lons
au passage que, pendant ces années-là, en 1 665 exactement, Dom
Juan, lu i, finissa it par se heurter à D ie u.
C'est à vra i dire cette croissance de Tartuffe qui donne à la pièce
son dynam ism e part icul ie r.
Au départ, en effet, Tartuffe, bien que
soigneusement annoncé, décrit, défin i, est absent de la scène; il l'est
pendant deux actes et laiss e la vedette à Orgon.
On a ainsi affair e
d'abord à une coméd ie qui illustre les rapports entre un homme et sa
passion, en présente les conséquences désastreuses, en tire le maximum
d'effets comiques.
JI s'agit bien entendu de beaucoup plus que d'un
portra it : la passion d'Orgon provoque tout un jeu d'act ions et de
réact ions qui const itu ent tout simplement du théâtre.
Autrui, menacé
dans sa paix et dans son bonheur, attaque ou résiste : c'est là le sujet
des deux prem ie rs actes; quant au ressort des actes III et IV, il se
trouve moins dans la lutte contre Tartuffe que dans la tentative d'utili
ser Tartuffe, d'abord en raisonnant avec lui, ensuite en le trompant,
pour déjouer la passion d'Orgon et détourner celui-ci de ses projets.
Ainsi ..
à la base de la pièce, il y a le part i pris d'Orgon, son aveugle
ment, son erreur (d'ailleurs parfait e m ent expliquée par Cléante).
Plus
profondément, cette erreur est source de force, car, comme dans pres
que toute l'œuvre de Mol ièr e, elle est nécessaire au bonheur du pro
tagon ist e.
Tartuffe n'est pas un accident dans la vie d'Orgon : il est
voulu par ce dern ie r.
C'est que, représentant les plus hautes valeurs,
Tartuffe permet à Orgon de satisfaire son besoin de dom inat ion en
toute bonne conscience.
Le «cas Orgon�.
c'est celui de l'homme.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TARTUFFE DE MOLIERE: Résumé et structure dramatique
- La structure dramatique du Tartuffe de Molière
- 1ère Spé SVT Thème 2 : La dynamique interne de la Terre. Chapitre 1 : La structure interne du globe terrestre
- Dm de spé théâtre: Tartuffe de Molière
- Commentaire Tartuffe (résumé et analyse)