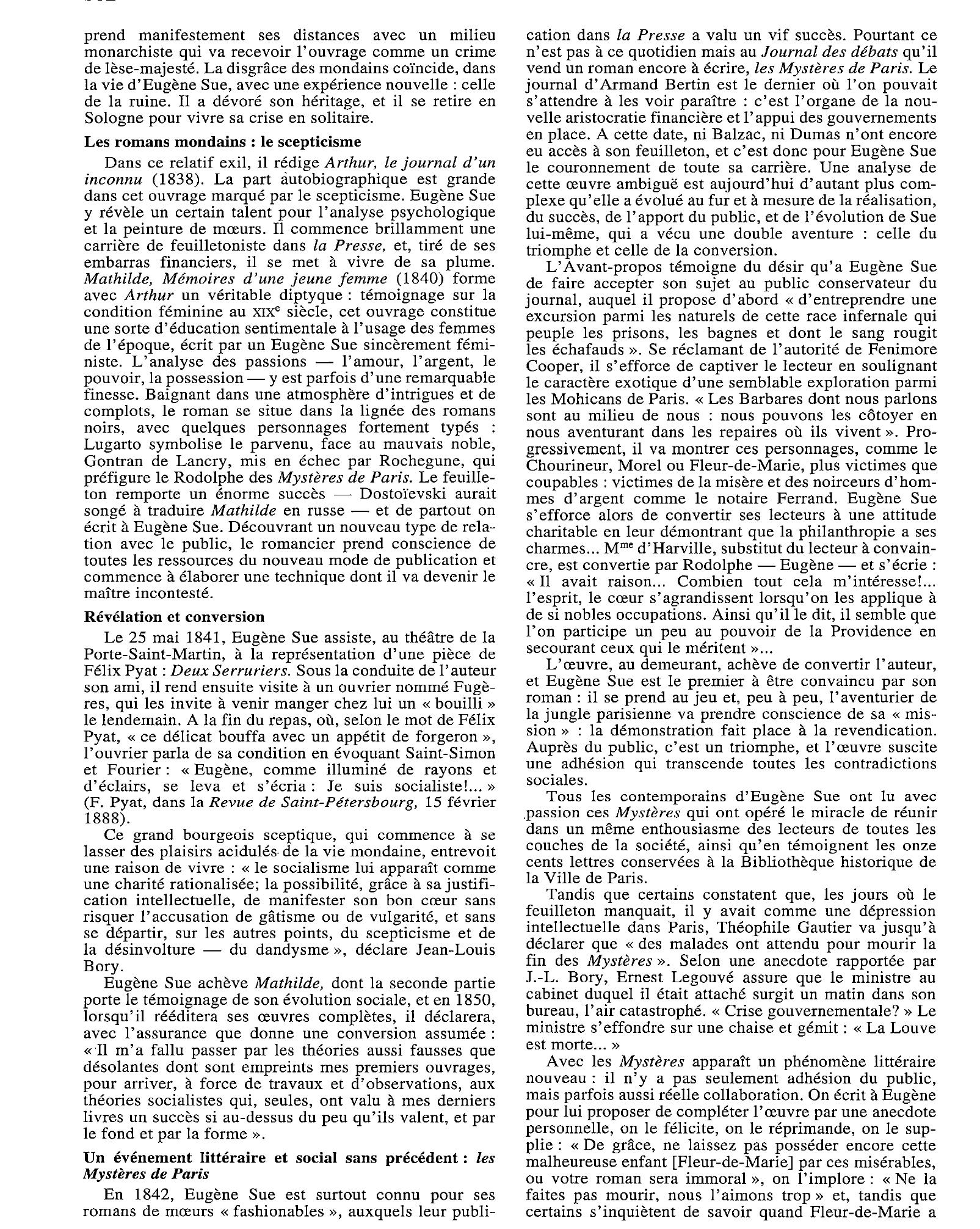SUE Marie-Joseph, dit Eugène
Publié le 14/10/2018

Extrait du document
SUE Marie-Joseph, dit Eugène (1804-1857). L’histoire d’Eugène Sue, c’est celle d’un grand bourgeois qui découvre la misère et dont la vie, cristallisée autour de cette prise de conscience, va peu à peu être investie par une véritable vocation. Cet événement personnel, intervenant chez un jeune écrivain au moment même où, en raison d’un prodigieux développement de la presse, la plume devient une arme aussi redoutable qu’efficace, va faire jouer à Eugène Sue, en ce début du XIXe siècle, un rôle de tout premier plan : dans la prise de conscience politique et sociale de ses contemporains aussi bien que dans l’avènement à maturité d’un genre en pleine mutation, le roman. Roi du roman-feuilleton, Eugène Sue fut le plus célèbre et le plus aimé des écrivains de son temps, au point que Balzac lui-même en fut jaloux toute sa vie. Comme Alexandre Dumas, Jules Verne... ou Lautréamont, il sera pourtant presque ignoré par la plupart de nos manuels de littérature du XIXe siècle.
Des romans mondains aux Mystères de Paris
Les romans maritimes : l’aventurier
Issu d’une très grande famille bourgeoise — Eugène a pour marraine Joséphine de Beauharnais —, il semble être prédestiné par l’héritage familial à une carrière de médecin ou de chirurgien. Il commencera bien par là, mais... dans la marine, et les premiers voyages seront pour le «Parisien en mer» l’occasion d’une constatation : il n’a aucun goût pour la carrière médicale. Il commence alors une carrière littéraire, à laquelle il ne se consacrera entièrement qu’après la mort de son père en 1830. Esthète, dandy sceptique et désabusé, le bel Eugène devient vite la coqueluche de tous les salons parisiens, même les plus fermés. Disraeli, en visite à Paris, notera dans son journal qu’Eugène Sue est le seul écrivain à ctre reçu dans le monde... Il vit dans un luxe inouï, prend pour maîtresse l’illustre Olympe Pélissier, dont le boudoir fut fréquenté des hommes les plus en vue
de son siècle, et on se plaît à lui reconnaître le flegme de Brummel et le charme de Byron... Ce « gant jaune » à la mode est disciple de Bonald, de De Maistre et de Lamennais. Heureux et « bien-pensant », il se lie avec Balzac et remporte de vifs succès littéraires. On le compare à Walter Scott, on fait de lui le Fenimore Cooper français : tout semble lui sourire. Publiée un an après Atar-Gull, roman très réussi que le Monde a donné en 1980 en feuilleton estival, la Salamandre rencontre un tel succès que Liszt songe à mettre en musique le chapitre final, qui relate l’agonie de naufragés, tandis que tout Paris s’émeut devant le cynisme de Szaffie, le héros qui, tuant les âmes, non les corps, se veut « meurtrier spiritualiste »... Dans la préface de la Vigie de Koat-Ven, Eugène Sue fustige l’action néfaste des «propagateurs de lumière », qui, « du milieu d’une oisiveté voluptueuse, spéculent sur les misères du pauvre et l’excitent à la haine et à la vengeance ». Leur jetant l'anathème, il s’écrie « Malheur à ceux-là, bien fous ou bien méchants qui, avec quelques mots vides ou retentissants, le “progrès”, les “Lumières” et la “régénération”, ont jeté, en France, en Europe, les germes d’une épouvantable anarchie! »
Tandis qu’il achève une Histoire de la marine en cinq volumes et s’étourdit dans les plaisirs mondains, Eugène Sue publie, en 1837, un roman historique, Latréaumont, dont la préface est couronnée d’une profession de foi sceptique : « Il n’existe dans ce monde rien d’absolu, rien de fixe, en mal ou en bien » et « la vertu, pas plus que le vice ne jouissent continuellement d’une ineffable félicité » (les Chants de Maldoror d’Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, constitueront une véritable réponse de la part de celui qui s’écrie [Poésies I] : « En son nom personnel, malgré elle, il le faut, je viens renier, avec une volonté indomptable et une ténacité de fer, le passé hideux de l’humanité pleurarde »).
Dans cet ouvrage, qui met en scène les « mystères » de Versailles pendant le Grand Siècle, Eugène Sue, en faisant un portrait sans complaisance de Louis XIV,
«
prend manifestement ses distances avec un milieu monarchiste qui va recevoir l'ouvrage comme un crime de lèse-majesté.
La disgrâce des mondains coïncide, dans la vie d'Eugène Sue, avec une expérience nouvelle : celle de la ruine.
Il a dévoré son héritage, et il se retire en Sologne pour vivre sa crise en solitaire.
Les romans mondains : le scepticisme
Dans ce relatif exil, il rédige Arthur, le journal d'un inconnu (1838).
La part àutobiographique est grande dans cet ouvrage marqué par le scepticisme.
Eugène Sue y révèle un certain talent pour l'analyse psychologique et la peinture de mœurs.
Il commence brillamment une carrière de feuilletoniste dans la Presse, et, tiré de ses embarras financiers, il se met à vivre de sa plume.
Mathilde, Mémoires d'une jeune femme (1840) forme avec Arthur un véritable diptyque : témoignage sur la condition féminine au XIX 0 siècle, cet ouvrage constitue
une sorte d'éducation sentimentale à l'usage des femmes de l'époque, écrit par un Eugène Sue sincèrement fémi niste.
L'analyse des passions - l'amour, l'argent, le pouvoir, la possession- y est parfois d'une remarquable finesse.
Baignant dans une atmosphère d'intrigues et de complots, le roman se situe dans la lignée des romans noirs, avec quelques personnages fortement typés : Lugarto symbolise le parvenu, face au mauvais noble, Gontran de Lancry, mis en échec par Rochegune, qui préfigure le Rodolphe des Mystères de Paris.
Le feuille ton remporte un énorme succès - Dostoïevski aurait songé à traduire Mathilde en russe - et de partout on écrit à Eugène Sue.
Découvrant un nouveau type de rela tion avec le public, le romancier prend conscience de toutes les ressources du nouveau mode de publication et commence à élaborer une technique dont il va devenir le maître incontesté.
Révélation et conversion
Le 25 mai 1841, Eugène Sue assiste, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, à la représentation d'une pièce de Félix Pyat :Deux Serruriers.
Sous la conduite de l'auteur son ami, il rend ensuite visite à un ouvrier nommé Fugè res, qui les invite à venir manger chez lui un « bouilli » le lendemain.
A la fin du repas, où, selon le mot de Félix Pyat, « ce délicat bouffa avec un appétit de forgeron », l'ouvrier parla de sa condition en évoquant Saint-Simon et Fourier : « Eugène, comme illuminé de rayons et d'éclairs, se leva et s'écria: Je suis socialiste!.
..
» (F.
Pyat, dans la Revue de Saint-Pétersbourg, 15 février 1888).
Ce grand bourgeois sceptique, qui commence à se lasser des plaisirs acidulés- de la vie mondaine, entrevoit une raison de vivre : « le socialisme lui apparaît comme une charité rationalisée; la possibilité, grâce à sa justifi cation intellectuelle, de manifester son bon cœur sans risquer l'accusation de gâtisme ou de vulgarité, et sans se départir, sur les autres points, du scepticisme et de la désinvolture - du dandysme», déclare Jean-Louis Bory.
Eugène Sue achève Mathilde, dont la seconde partie porte le témoignage de son évolution sociale, et en 1850, lorsqu'il rééditera ses œuvres complètes, il déclarera,
avec l'assurance que donne une conversion assumée :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Mystères de Paris (les). Roman de Marie-Joseph, dit Eugène Sue (résume et analyse complète)
- SUE (Marie Joseph, dit Eugène)
- Marie-Joseph dit Eugène SUE
- ARTAUD Antoine Marie-Joseph, dit Antonin : sa vie et son oeuvre - Le Théâtre et son double
- JUIF ERRANT (Le) d'Eugène Sue (résumé & analyse)