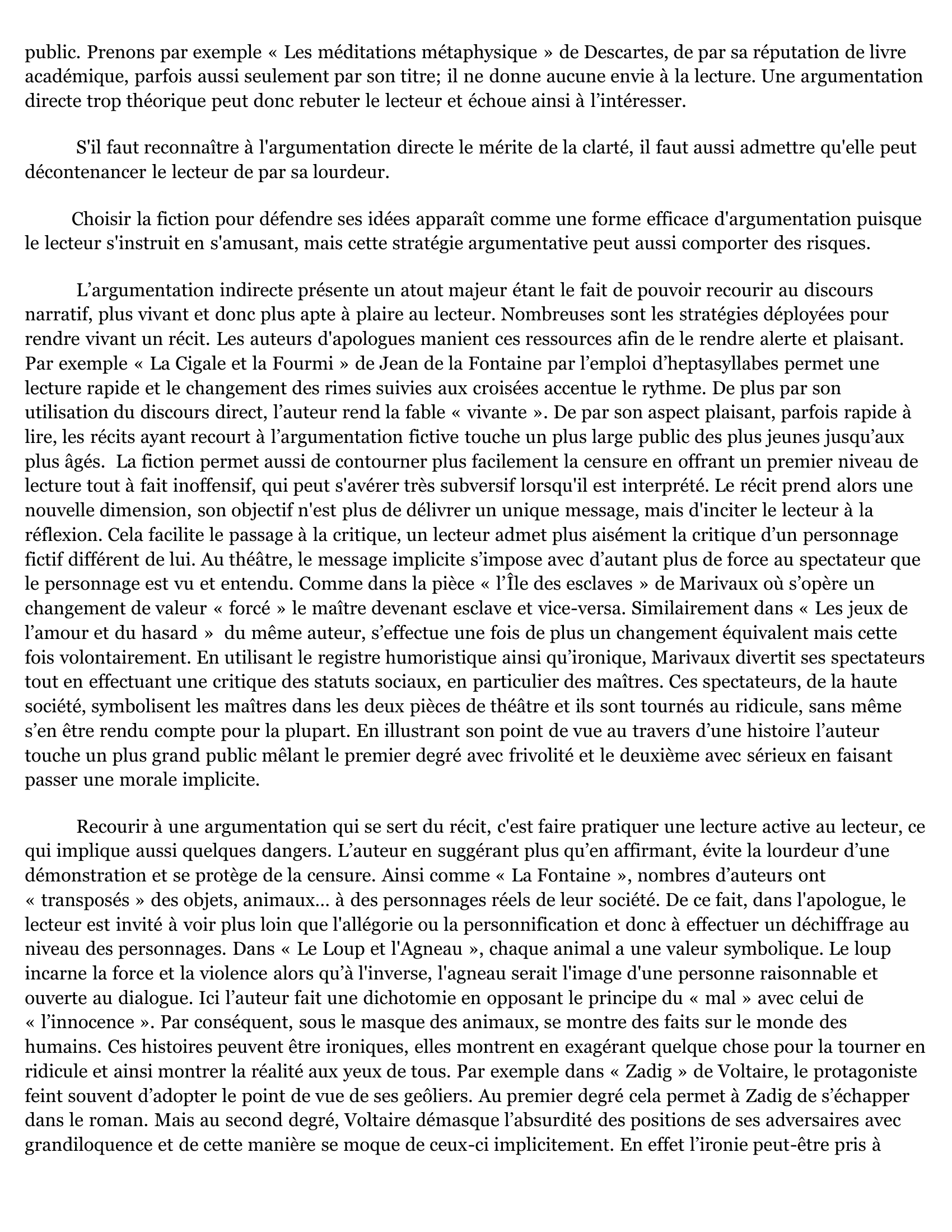SUJET 1 – ARGUMENTATION FICTIVE OU DIRECT
Publié le 13/09/2018

Extrait du document
Recourir à une argumentation qui se sert du récit, c'est faire pratiquer une lecture active du récit au lecteur, ce qui implique aussi quelques dangers. L’auteur en suggérant plus qu’affirmant, évite la lourdeur d’une démonstration et se protège de la censure. Ainsi comme La Fontaine, nombres d’auteurs ont « transposé » des objets, animaux… à des personnages réels de leur société. De ce fait, dans l'apologue, le lecteur est invité à voir plus loin que l'allégorie ou la personnification et donc à effectuer un déchiffrage au niveau des personnages. Dans « Le Loup et l'Agneau », chaque animal a une valeur symbolique. Le loup incarne la force et la violence alors qu’à l'inverse, l'agneau serait l'image d'une personne raisonnable et ouverte au dialogue. Ici l’auteur fait une dichotomie en opposant le principe du « mal » avec celui de « l’innocence ». Par conséquent, sous le masque des animaux, se montre des faits sur le monde des humains. Ces histoires peuvent être ironiques, elle montre en exagérant quelque chose pour la tourner en ridicule et ainsi montrer la réalité aux yeux de tous. Par exemple dans « Zadig » de Voltaire, le protagoniste feint souvent d’adopter le point de vue de ses geôliers. Au premier degré cela permet à Zadig de s’échapper dans le roman. Mais au second degré, Voltaire démasque l’absurdité des positions de ses adversaires avec grandiloquence et de cette manière se moque de ceux-ci implicitement. En effet l’ironie peut-être pris à contre sens. Il peut donc être compris au sens propre et le lecteur peut passer à côté de l’enseignement souhaité. Le lecteur peut du coup changer son raisonnement et l’auteur n’aura donc pas eu l’effet escompté.
En usant du voile du récit, l’argumentation fictive réussit tout à la fois à plaire et à instruire mais mise sur l’intelligence du lecteur à décrypter le message implicite.
Pour conclure, on peut dire qu'il n’existe finalement pas de procédé plus efficace que l'autre, puisque tout dépend du message que l'on veut véhiculer ainsi que du contexte. Les deux formes d'argumentation sont toutes aussi efficace. On peut voir que l’argumentation directe permet de gagner du temps et peut paraître plus claire mais il ne trouve pas forcément son public. A l'inverse, l'argumentation indirecte permet une réflexion plus globale et séduit davantage par son caractère plaisant, cependant, il peut faire passer le lecteur à côté de son sens réel. Néanmoins, il est possible de concilier les deux au sein d'une seule et même œuvre, pour plus d'impact et cibler un plus grand nombre de lecteur.
«
public.
Prenons par exemple « Les méditations métaphysique » de Descartes, de par sa réputation de livre
académique, parfois aussi seulement par son titre; il ne donne aucune envie à la lecture.
Une argumentation
directe trop théorique peut donc rebuter le lecteur et échoue ainsi à l’intéresser.
S'il faut reconnaître à l'argumentation directe le mérite de la clarté, il faut aussi admettre qu'elle peut
décontenancer le lecteur de par sa lourdeur.
Choisir la fiction pour défendre ses idées apparaît comme une forme efficace d'argumentation puisque
le lecteur s'instruit en s'amusant, mais cette stratégie argumentative peut aussi comporter des risques.
L’argumentation indirecte présente un atout majeur étant le fait de pouvoir recourir au discours
narratif, plus vivant et donc plus apte à plaire au lecteur.
Nombreuses sont les stratégies déployées pour
rendre vivant un récit.
Les auteurs d'apologues manient ces ressources afin de le rendre alerte et plaisant.
Par exemple « La Cigale et la Fourmi » de Jean de la Fontaine par l’emploi d’heptasyllabes permet une
lecture rapide et le changement des rimes suivies aux croisées accentue le rythme.
De plus par son
utilisation du discours direct, l’auteur rend la fable « vivante ».
De par son aspect plaisant, parfois rapide à
lire, les récits ayant recourt à l’argumentation fictive touche un plus large public des plus jeunes jusqu’aux
plus âgés.
La fiction permet aussi de contourner plus facilement la censure en offrant un premier niveau de
lecture tout à fait inoffensif, qui peut s'avérer très subversif lorsqu'il est interprété.
Le récit prend alors une
nouvelle dimension, son objectif n'est plus de délivrer un unique message, mais d'inciter le lecteur à la
réflexion.
Cela facilite le passage à la critique, un lecteur admet plus aisément la critique d’un personnage
fictif différent de lui.
Au théâtre, le message implicite s’impose avec d’autant plus de force au spectateur que
le personnage est vu et entendu.
Comme dans la pièce « l’Île des esclaves » de Marivaux où s’opère un
changement de valeur « forcé » le maître devenant esclave et vice-versa.
Similairement dans « Les jeux de
l’amour et du hasard » du même auteur, s’effectue une fois de plus un changement équivalent mais cette
fois volontairement.
En utilisant le registre humoristique ainsi qu’ironique, Marivaux divertit ses spectateurs
tout en effectuant une critique des statuts sociaux, en particulier des maîtres.
Ces spectateurs, de la haute
société, symbolisent les maîtres dans les deux pièces de théâtre et ils sont tournés au ridicule, sans même
s’en être rendu compte pour la plupart.
En illustrant son point de vue au travers d’une histoire l’auteur
touche un plus grand public mêlant le premier degré avec frivolité et le deuxième avec sérieux en faisant
passer une morale implicite.
Recourir à une argumentation qui se sert du récit, c'est faire pratiquer une lecture active au lecteur, ce
qui implique aussi quelques dangers.
L’auteur en suggérant plus qu’en affirmant, évite la lourdeur d’une
démonstration et se protège de la censure.
Ainsi comme « La Fontaine », nombres d’auteurs ont
« transposés » des objets, animaux… à des personnages réels de leur société.
De ce fait, dans l'apologue, le
lecteur est invité à voir plus loin que l'allégorie ou la personnification et donc à effectuer un déchiffrage au
niveau des personnages.
Dans « Le Loup et l'Agneau », chaque animal a une valeur symbolique.
Le loup
incarne la force et la violence alors qu’à l'inverse, l'agneau serait l'image d'une personne raisonnable et
ouverte au dialogue.
Ici l’auteur fait une dichotomie en opposant le principe du « mal » avec celui de
« l’innocence ».
Par conséquent, sous le masque des animaux, se montre des faits sur le monde des
humains.
Ces histoires peuvent être ironiques, elles montrent en exagérant quelque chose pour la tourner en
ridicule et ainsi montrer la réalité aux yeux de tous.
Par exemple dans « Zadig » de Voltaire, le protagoniste
feint souvent d’adopter le point de vue de ses geôliers.
Au premier degré cela permet à Zadig de s’échapper
dans le roman.
Mais au second degré, Voltaire démasque l’absurdité des positions de ses adversaires avec
grandiloquence et de cette manière se moque de ceux-ci implicitement.
En effet l’ironie peut-être pris à.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Argumentation direct , indirect
- Pensez-vous que la fiction littéraire (mettant en scène des personnages imaginés, une histoire imaginaire) est plus efficace pour faire passer un message, une dénonciation, qu'une argumentation direct comme l'essai, le discours ou la lettre ouverte ?
- L'argumentation indirecte est elle plus efficace l'argumentation direct ?
- Lors d’un voyage à l’étranger, vous avez été séduit par une des coutumes de ce pays, très éloignée de vos propres habitudes. Vous écrivez une lettre ouverte aux responsables politiques pour les convaincre d’adopter cet usage. Comme Voltaire, précisez dans un titre le sujet que vous abordez. Votre argumentation comportera des passages narratifs, et insérera des paroles rapportées (au style direct, indirect ou indirect libre). Vous ne signerez pas votre texte.
- Pensez-vous que la fiction littéraire (mettant en scène des personnages imaginés, une histoire imaginaire) est plus efficace pour faire passer un message, une dénonciation, qu'une argumentation direct comme l'essai, le discours ou la lettre ouverte ? Dans quelle mesure ?