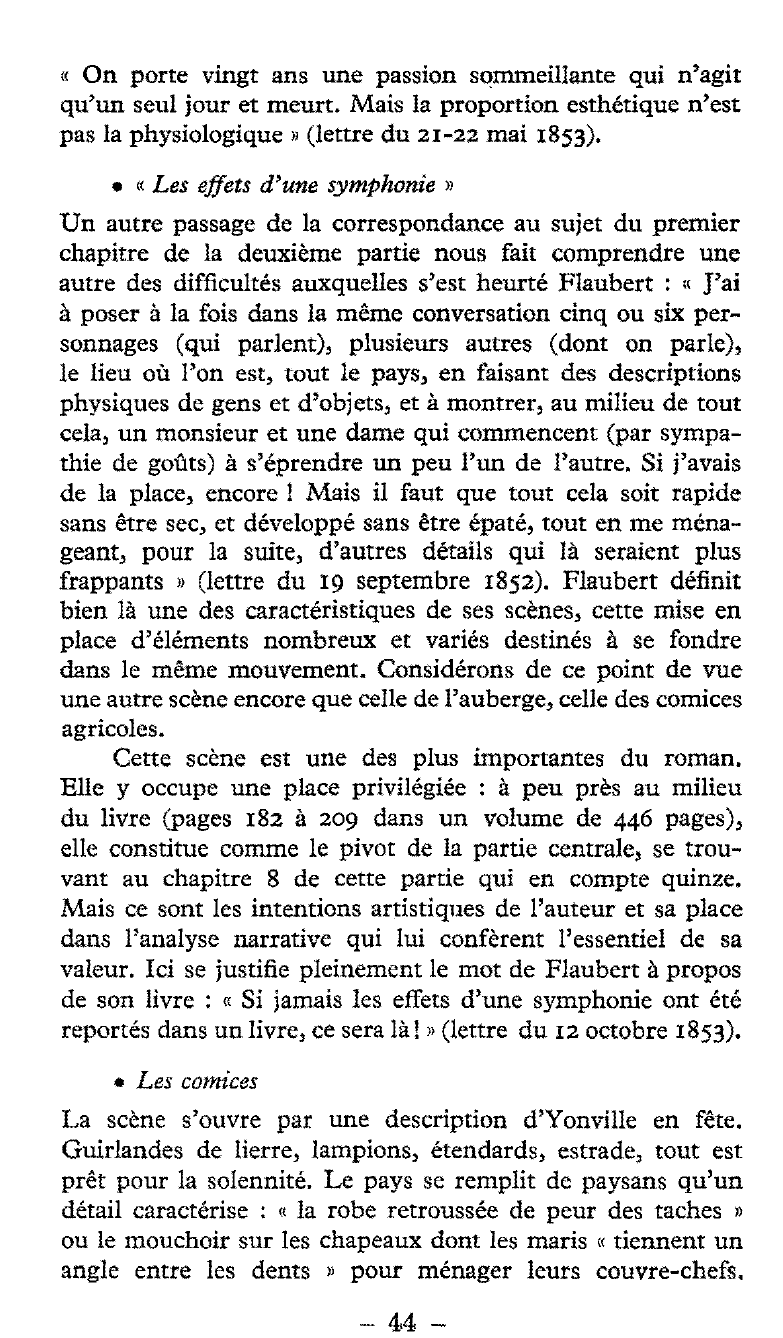Techniques romanesques dans Madame Bovary de Gustave Flaubert
Publié le 22/01/2020

Extrait du document
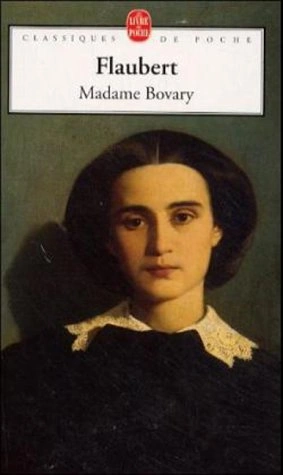
droits de la passion supérieure aux devoirs de la morale convenue (p. 197), où elle se tait. Elle ne sera plus désormais que mollesse et attente passive. Mais Flaubert suggère par d’autres moyens, plus subtils que les mots d’un dialogue, les sentiments de son héroïne et le trouble qui l’agite. Pendant plus de deux pages (198-200), le discours de Lieuvain s’interrompt. Mais nous sentons bien que si nous n’entendons plus les paroles du Conseiller de préfecture ce n’est pas parce que « sa voix se perdait dans l’air », c’est surtout parce qu’Emma a cessé de les écouter, parce que les phrases de Rodolphe continuent de retentir en elle, toute à son trouble. Ses regards errent sur la foule des hommes et des animaux, exposés au-dessous d’elle, et dont les postures grotesques démentent « l’intelligence profonde et modérée » si généreusement attribuée aux populations par M. le Conseiller. Les images et les bruits divers occupent son esprit que son trouble croissant rend incapable de suivre le fil du discours. Rodolphe s’étant rapproché et relançant la conversation sur un ton plus passionné, un vertige la gagne. Sa conscience est désormais dominée par ses sens. Les images du passé ressuscitent et se mêlent au présent grâce au parfum du séducteur, par un mouvement déjà proustien (p. 200); le visage de Léon lui apparaît à la vue de l’Hirondelle au loin. Alors tout se confond dans la sensation, le passé lointain et le passé plus récent, le vicomte et Léon, le souvenir du vertige de la danse et sa mollesse présente. Elle accuse tous les signes physiques d’un malaise imminent. Le mauvais moment passé, elle entend « la voix du Conseiller qui psalmodiait ses phrases » et de nouveau, avec le retour d’Emma à une conscience plus claire, nous revenons au discours.
Discours à double entente, du reste : « Continuez ! Persévérez ! n’écoutez ni les suggestions de la routine, ni les conseils trop hâtifs d’un empirisme téméraire » (p. 201). A qui s’adresse-t-il ? Aux paysans, bien sûr, et tous les détails qui suivent nous ramènent à la réalité la plus terre à terre, mais quelles résonances prennent-ils, ces impératifs, dans l’esprit de Rodolphe et d’Emma, qui ne pensent pas, eux, à l’amélioration « des races chevalines, bovines, ovines et porcines », mais bien à la transgression de la morale et à la « fatalité » de l’amour?
Chaque fragment du discours forme un contrepoint
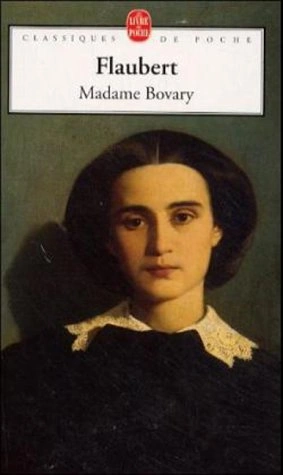
«
" On porte vingt ans une passion sommeillante qui n'agit
qu'un seul jour et meurt.
Mais la proportion esthétique n'est
pas la physiologique >> (lettre du 21-22 mai 1853).
• ((Les effets d'une symphonie>>
Un autre passage de la correspondance au sujet du premier
chapitre de la deuxième partie nous fait comprendre une
autre des difficultés auxquelles s'est heurté Flaubert : " J'ai
à poser à la fois dans la même conversation cinq ou six per
sonnages (qui parlent), plusieurs autres (dont on parle),
le lieu où l'on est, tout le pays, en faisant des descriptions
physiques de gens et d'objets, et à montrer, au milieu de tout
cela, un monsieur et une dame qui commencent (par sympa
thie de goflts) à s'éprendre un peu l'un de l'autre.
Si j'avais
de la place, encore l Mais il faut que tout cela soit rapide
sans être sec, et développé sans être épaté, tout en me ména
geant, pour la suite, d'autres détails qui là seraient plus
frappants '' (lettre du 19 septembre 1852).
Flaubert définit
bien là une des caractéristiques de ses scènes, cette mise en
place d'éléments nombreux et variés destinés à se fondre
dans le même mouvement.
Considérons de ce point de vue
une autre scène encore que celle de l'auberge, celle des comices
agricoles.
Cette scène est une des plus importantes du roman.
Elle y occupe une place privilégiée : à peu près au milieu
du livre (pages 182 à 209 dans un volume de 446 pages),
elle constitue comme le pivot de la partie centrale, se trou
vant au chapitre 8 de cette partie qui en compte quinze.
Mais ce sont les intentions artistiques de l'auteur et sa place
dans l'analyse narrative qui lui confèrent l'essentiel de sa
valeur.
Ici se justifie pleinement le mot de Flaubert à propos
de son livre : « Si jamais les effets d'une symphonie ont été
reportés dans un livre, ce sera là!» (lettre du 12 octobre i853).
• Les comices
La scène s'ouvre par une description d'Yonville en fête.
Guirlandes de lierre, lampions, étendards, estrade, tout est
prêt pour la solennité.
Le pays se remplit de paysans qu'un
détail caractérise : (( la robe retroussée de peur des taches »
ou le mouchoir sur les chapeaux dont les maris (( tiennent un
angle entre les dents " pour ménager leurs couvre-chefs.
44 -.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse de Madame Bovary de Gustave Flaubert
- Ce corpus est composé de trois extraits, Le Rouge et le Noir écrit en 1830 par Stendhal, Le père Goriot écrit en 1835 par Honoré de Balzac, Madame Bovary écrit en 1857 par Gustave Flaubert.
- Gustave flaubert Madame de Bovary Chapitre 9 partie 2
- MADAME Bovary, de Gustave Flaubert
- Madame Bovary de Gustave Flaubert (Analyse)