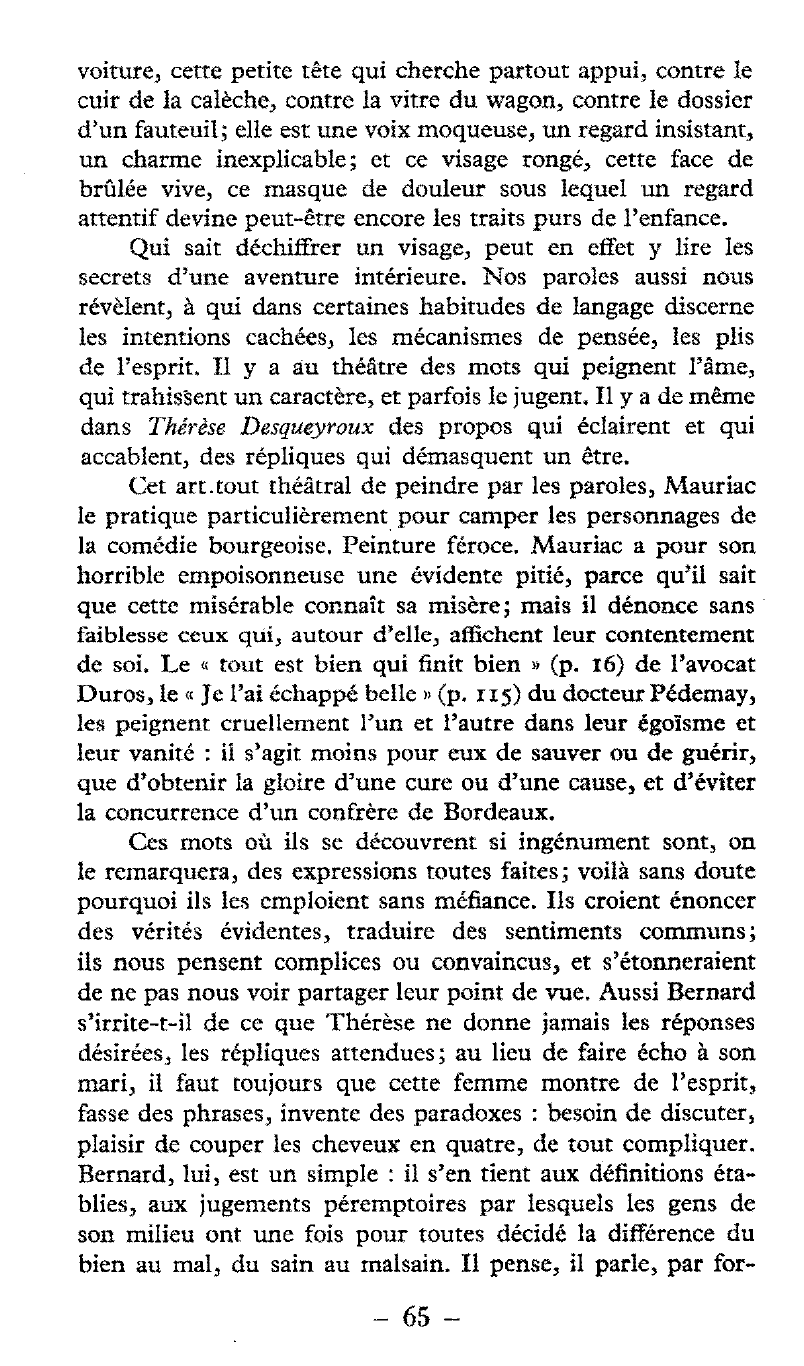Thérèse Desqueyroux de Mauriac: L’art du romancier
Publié le 23/01/2020

Extrait du document
celui de Balion, ni le wagon du petit train. Mauriac ne décrit pas davantage la campagne landaise, pas même la forêt qui cerne Argelouse.
Ici encore, il ne peint pas, il suggère; il ne compose pas de vastes tableaux, mais esquisse de brèves images, note sans s’attarder quelques impressions, relève quelques détails un instant entrevus : ce qu’éclairent dans la nuit les lanternes d’une voiture en marche, ou une lampe devant une gare : des « talus, une frange de fougères, la base des pins géants », ou un « mur crépi... une carriole arrêtée » (p. 18, 22); ce que l’on sent, sans le voir : des chrysanthèmes dans un jardin ténébreux. C’est encore la rumeur qui monte d’une rue parisienne, le grondement des autobus entendu par la fenêtre ouverte; le papier de tenture (mais quels en sont le dessin, la couleur?) que la moisissure détache des murs d’une chambre; un canapé de reps rouge dans un salon obscur. De quelques promenades, nous rapportons des souvenirs plus précis, mais eux aussi fragmentaires : le vert acide des nouvelles crosses de fougères, perçant au printemps les feuillages secs qui jonchent le sol; la fraîcheur des eaux de source pendant l’été brûlant; à l’automne, les fumées des herbes brûlées, et dans le champ d’Argelouse, les tiges coupées du seigle, qui blessent les pieds; les troupeaux de brebis courant sous les chênes, ou coulant par la brèche d’un talus, « comme du lait sale » (p. 90); leur piétinement, le bruit des cloches et les cris des bergers. Du voyage de Thérèse retenons aussi les mugissements et les bêlements qui viennent d’un train garé dans la nuit, ou ce rapide croquis de deux métayères qui, dans une salle d’attente, tricotent « assises, un panier sur les genoux et branlant la tête » (p. 23).
Peu de formes précises, ou même de couleurs. Des mouvements plutôt, des bruits, et des sensations tactiles : de chaleur, de froid, de contact; et surtout des odeurs : de marécage, de résine, de fumée, de menthe, de brume, de cuir, de fleurs ou de tabac.
De ces impressions fugitives, mais puissantes dans leur brièveté, naît peu à peu une sensation d’étrange présence. Ces maisons, ces champs et ces forêts qui semblent s’effacer dans l’obscurité, la brume ou le poudroiement de la lumière, s’imposent pourtant à notre imagination. Au parfum de la résine, nous devinons dans la nuit la masse des pins. Dans
mules qu’il répète. « C’est la santé », aime-t-il à dire en comptant les gouttes de son médicament. C’est une maladie, par contre, d’être juif : les Azévédo ne sont-ils pas, » avec ça, tuberculeux; toutes les maladies... « (p. 42). Son opinion est celle de toutes les personnes de bon sens; aussi évalue-t-il avec assurance les choses, les êtres, les sentiments, à leur prix exact : prix d’un repas au restaurant : « Il ne faut ' pas leur en laisser : au prix que ça coûte, ce serait dommage », - d’un vin : « Pristi, ils ne le donnent pas », - ou d’une passion : s’éprendre, comme Anne du fils Azévédo, c’est, pour lui, « s’amouracher » (p. 56, 55, 49). Les mots de Bernard résument la pauvreté de son imagination, la sécheresse de son cœur, sa mesquinerie, son amour de soi et son mépris des autres; la médiocrité enfin de ses ambitions : « la famille » : peu de phrases de lui où ne figure ce mot clef qui renvoie à la seule valeur qu’il connaisse, la respectabilité bourgeoise.
Avec Madame de la Trave, nous parvenons à une sorte de virtuosité dans le maniement du cliché; ses propos constituent un recueil d’expressions stéréotypées, de lieux communs mis bout à bout. La banalité du langage atteint un comble et révèle la banalité totale d’un esprit uniquement occupé de petites malveillances, de petits calculs : « Le père pense mal, c’est entendu » disait-elle de Monsieur Larroque, avant le mariage ; mais « il a le bras long. On a besoin de tout le monde » : n’est-il pas bon » d’avoir un pied dans les deux camps »? (P- 39, 32)-
Mêmes proverbes, mêmes formules, même platitude, dans le langage de Monsieur de la Trave ou du fils Deguilhem : « On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs... elle nous remerciera un jour », dit l’un pour excuser sa sévérité envers Anne; « ces salons de campagne, il ne faut pas essayer de les chauffer » dit l’autre, attendant que Thérèse paraisse; ou encore : « Il y a toujours tant de choses à faire dans une maison » (p. 64, 160, 164). Et les beaux discours de Jean Azévédo lui-même ne sauraient faire longtemps illusion : ils offrent seulement une autre variété de clichés. Tous ces fantoches parlent un langage également impersonnel, et pourtant chacun a sa façon à lui de répéter des formules, qui traduit la nuance particulière de sa médiocrité. Madame de la Trave a le bavardage méchant, son mari cache mal sa faiblesse, Jean est affecté et prétentieux, et le fils Deguilhem terre à terre.
«
voiture, cette petite tête qui cherche partout appui, contre le
cuir de la calèche, contre la vitre du wagon, contre le dossier
d'un fauteuil; elle est une voix moqueuse, un regard insistant,
un charme inexplicable; et ce visage rongé, cette face de
brûlée vive, ce masque de douleur sous lequel un regard
attentif devine peut-être encore les traits purs de l'enfance.
Qui sait déchiffrer un visage, peut en effet y lire les
secrets d'une aventure intérieure.
Nos paroles aussi nous
révèlent, à qui dans certaines habitudes de langage discerne
les intentions cachées, les mécanismes de pensée, les plis
de l'esprit.
Il y a au théâtre des mots qui peignent l'âme,
qui trahissent un caractère, et parfois le jugent.
Il y a de même
dans Thérèse Desqueyroux des propos qui éclairent et qui
accablent, des répliques qui démasquent un être.
Cet art.tout théâtral de peindre par les paroles, Mauriac
le pratique particulièrement pour camper les personnages de
la comédie bourgeoise.
Peinture féroce.
Mauriac a pour son
horrible empoisonneuse une évidente pitié, parce qu'il sait
que cette misérable connaît sa misère; mais il dénonce sans
faiblesse ceux qui, autour d'elle, affichent leur contentement
de soi.
Le " tout est bien qui finit bien » (p.
16) de l'avocat
Duros, le" Je l'ai échappé belle» (p.
n5) du docteur Pédemay,
les peignent cruellement l'un et l'autre dans leur égoïsme et
leur vanité : il s'agit moins pour eux de sauver ou de guérir,
que d'obtenir la gloire d'une cure ou d'une cause, et d'éviter
la concurrence d'un confrère de Bordeaux.
Ces mots où ils se découvrent si ingénument sont, on
le remarquera, des expressions toutes faites; voilà sans doute
pourquoi ils les emploient sans méfiance.
Ils croient énoncer
des vérités évidentes, traduire des sentiments communs;
ils nous pensent complices ou convaincus, et s'étonneraient
de ne pas nous voir partager leur point de vue.
Aussi Bernard
s'irrite-t-il de ce que Thérèse ne donne jamais les réponses
désirées, les répliques attendues; au lieu de faire écho à son
mari, il faut toujours que cette femme montre de l'esprit,
fasse des phrases, invente des paradoxes : besoin de discuter,
plaisir de couper les cheveux en quatre, de tout compliquer.
Bernard, lui, est un simple : il s'en tient aux définitions éta
blies, aux jugements péremptoires par lesquels les gens de
son milieu ont une fois pour toutes décidé la différence du
bien au mal, du sain au malsain.
Il pense, il parle, par for-
- 65 -.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’art du romancier - THÉRÈSE DESQUEYROUX de MAURIAC
- Analyse du roman Thérèse Desqueyroux de François Mauriac
- THÉRÈSE DESQUEYROUX de François Mauriac (résumé & analyse)
- Commentaire littéraire Thérèse Desqueyroux, François Mauriac Chapitre IV de « Ce dernier soir avant le retour au pays » à « déjà il se rapprochait.
- Thérèse Desqueyroux de François Mauriac (analyse détaillée)