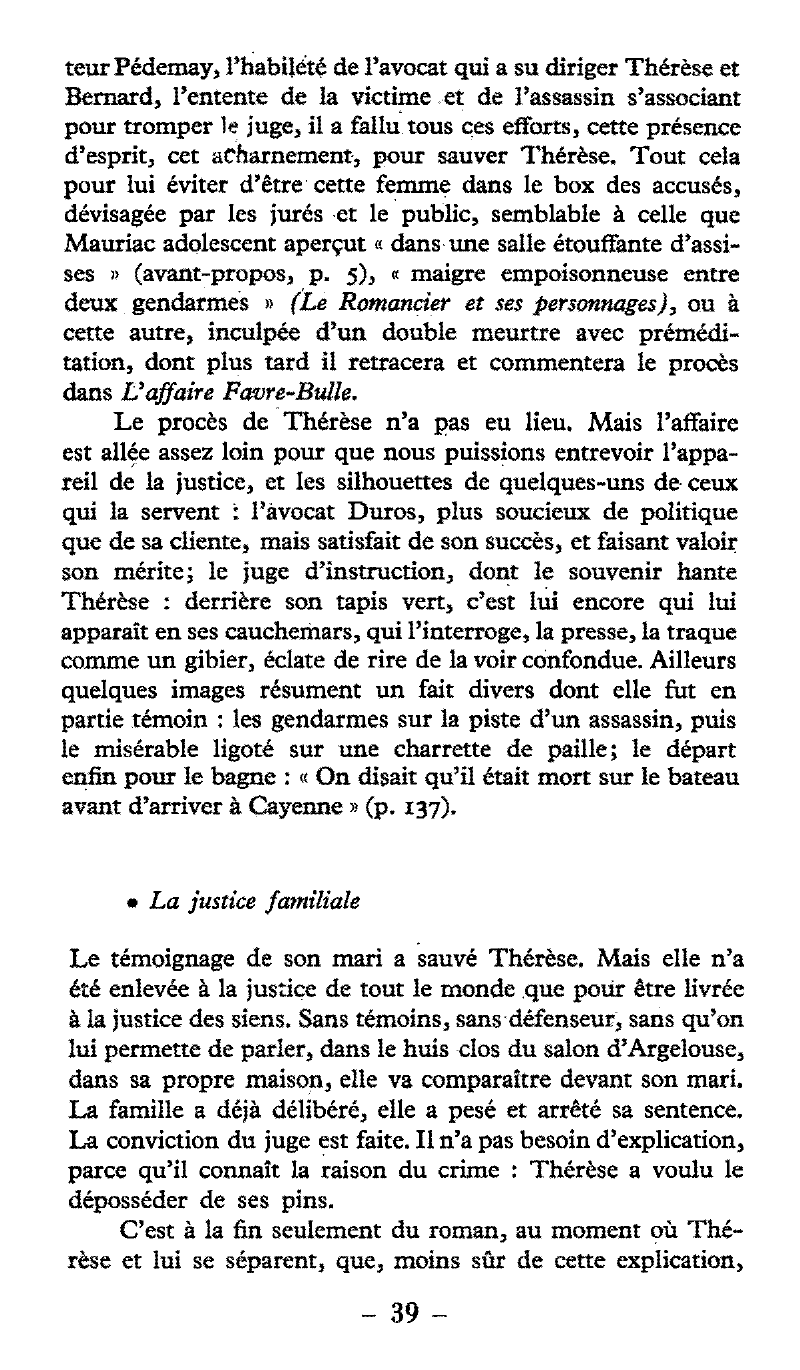Thérèse Desqueyroux de Mauriac: L’histoire d’un monstre
Publié le 23/01/2020

Extrait du document

volonté et une part de fatalité, dans son crime, comme sans doute dans la plupart des crimes. Mais ces deux parts sont dans le sien inextricables, si bien que chaque geste apparaît selon l’éclairage, tantôt comme prémédité, tantôt comme exécuté à son insu.
Le premier geste meurtrier, c’est Bernard qui l’accomplit; la seule responsabilité de Thérèse est de n’être pas intervenue quand il forçait la dose d’arsenic, de ne pas lui avoir répondu quand il demandait s’il avait déjà pris ses gouttes - mais il n’a pas attendu la réponse de s’être tue » par paresse, sans doute, par fatigue ■■ (p. 112); même mutisme, sans raison apparente cette fois, devant le médecin appelé la nuit; et ce silence - cette absence de Thérèse - est son premier acte criminel : « L’acte qui... était déjà en elle à son insu, commença alors d’émerger du fond de son être - informe encore, mais à demi baigné de conscience ■■ (p. 113). Thérèse donne naissance à son crime, comme à un être qu’elle a porté, mais maintenant autonome, doué d’une volonté propre, assez puissante pour la soumettre, assez rusée pour se faire accepter. Elle n’y voit d’abord que « curiosité un peu dangereuse à satisfaire ■■ (p. 113); une sorte de vérification expérimentale en somme, pour constater si les mêmes causes ont bien les mêmes effets : versant le poison dans le verre, Thérèse répète : « Une seule fois, pour en avoir le cœur net ■■ (p. 113). Puis il n’y a plus rien qu’un long vertige, qu’une chute à pic : « Elle s’est engouffrée dans le crime béant; elle a été aspirée par le crime » (p. 115). Formules où la responsabilité de Thérèse est à la fois affirmée et niée : sans doute est-elle coupable de s’être approchée du crime : on ne s’expose pas impunément au vertige. Mais le crime a une réalité extérieure à Thérèse; il est un piège où elle se prend; un tourbillon trop près duquel elle a imprudemment navigué; ou si l’on veut, un dieu mauvais qui fait d’elle sa proie.
• Thérèse et Phèdre
Dans sa Vie de Jean Racine (1928), Mauriac a consacré quelques pages remarquables au personnage de Phèdre. Thérèse et Phèdre ont bien des points communs. Dans le visage que Mauriac prête à l’héroïne racinienne, dans » sa figure morte, ses lèvres sèches, ses yeux brûlés qui demandent grâce
troublé et curieux, intéressé à nouveau par ce passé qu’il croyait « réglé », Bernard pose la question essentielle, « celle même qui fût d’abord venue à l’esprit de Thérèse si elle avait été à sa place » : « Thérèse... je voulais vous demander... je voudrais savoir... pourquoi vous avez fait cela? » (p. 173, 174)-
Pourquoi Thérèse a-t-elle voulu le tuer? Bernard manque de l’imagination et de la patience nécessaires pour suivre Thérèse dans le dédale de ses souvenirs, sur le chemin tortueux de ses pensées, de ses désirs, de ses tentations. Il veut tout de suite des faits, des gestes, une réponse rapide et simple. Autant dire qu’il ne saura rien.
• La lumière de la conscience
Ce chemin compliqué et incertain qui l’a menée à son acte, Thérèse s’est efforcée, elle, de le reconnaître, obstinément, à tâtons, revenant sur ses pas chaque fois qu’elle se trompait, cette nuit de son retour à Argelouse. Elle s’est penchée sur son passé pour y chercher la réponse à cette même question : pourquoi a-t-elle voulu tuer ? Car ce crime dont on la charge, elle-même ne le connaît pas : comment en saurait-elle la raison? « Je ne sais pas ce que j’ai voulu »; il lui semble qu’a agi en elle une « puissance forcenée » étrangère à sa volonté (p. 22). Plus tard, quand Bernard enfin l’interroge, elle croit découvrir cette raison : « J’allais vous répondre : « je ne sais pas pourquoi j’ai fait cela »; mais maintenant peut-être le sais-je, figurez-vous ! Il se pourrait que ce fût pour voir dans vos yeux une inquiétude, une curiosité - du trouble enfin, tout ce que depuis une seconde j’y découvre » (p. 175). « Peut-être... Il se pourrait que... » : point de certitude en cette simple hypothèse, rien qui ressemble à la solution exacte du problème.
Les hommes ont jugé Thérèse et ne l’ont pas reconnue coupable; son mari l’a jugée et condamnée; mais Thérèse est soumise aussi au jugement de sa conscience. Conscience toute raisonnable, qui ne se mêle pas de décider du bien ou du mal, mais seulement de distinguer le vrai et le faux; exigence de clarté, lucidité sans complaisance : « Sa conscience est son unique et suffisante lumière » disait d’elle, au lycée, une de ses maîtresses (p. 26). C’est de cette lumière

«
teur Pédemay, l'habilété de l'avocat qui a su diriger Thérèse et
Bernard, l'entente de la victime et de l'assassin s'associant
pour tromper le juge, il a fallu.tous ces efforts, cette présence
d'esprit, cet acharnement, pour sauver Thérèse.
Tout cela
pour lui éviter d'être cette femme dans le box des accusés,
dévisagée par les jurés ·et le ·public, semblable à celle que
Mauriac adolescent aperçut" dans une salle étouffante d'assi
ses » (avant-propos, p.
5), « maigre empoisonneuse entre
deux gendarmes >> (Le Romancier et ses personnages), ou à
cette autre, inculpée d'un double meurtre avec prémédi
tation, dont plus tard il retracera et commentera le procès
dans L'affaire Favre-Bulle.
Le procès de ·Thérèse n'a pas eu lieu.
Mais l'affaire
est allée assez loin pour que nous puissions entrevoir l'appa
reil d~ la justice, et les silhouettes de quelques-uns de· ceux
qui la servent : l'àvocat Duros, plus soucieux de politique
que de sa cliente, mais satisfait de son succès, et faisant valoir
son mérite; le juge d'instruction, dont le souvenir hante
Thérèse : derrière son tapis vert, c'est lui encore qui lui
apparaît en ses cauchemars, qui l'interroge, la presse, la traque
comme un gibier, éclate de rire de la voir confondue.
Ailleurs
quelques images résument un fait divers dont elle fut en
partie témoin : les gendarmes sur la piste d'un assassin, puis
le misérable ligoté sur une charrette de paille; le départ enfin pour le bagne : « On disait qu'il était mort sur le bateau
avant d'arriver à Cayenne >l (p.
137).
• La justice familiale
Le témoignage de son mari a sauvé Thérèse.
Mais elle n'a
été enlevée à la justice de tout le monde que polir être livrée
à la justice des siens.
Sans témoins, sans·défenseur' sans qu'on
lui permette de parler, dans le huis dos du salon d'Argelouse,
dans sa propre maison, elle va comparaître devant son mari.
La famille a déjà délibéré, elle a pesé et arrêté sa sentence.
La conviction du juge est faite.
Il n'a pas besoin d'explication,
parce qu'il connaît la raison du crime : Thérèse a voulu le
déposséder de ses pins.
C'est à la fin seulement du roman, au moment où Thé
rèse et lui se séparent, que, moins sûr de cette explication,
- 39 -.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’histoire d’un monstre - THÉRÈSE DESQUEYROUX de MAURIAC
- THÉRÈSE DESQUEYROUX de François Mauriac (résumé & analyse)
- Commentaire littéraire Thérèse Desqueyroux, François Mauriac Chapitre IV de « Ce dernier soir avant le retour au pays » à « déjà il se rapprochait.
- Thérèse Desqueyroux de François Mauriac (analyse détaillée)
- Thérèse Desqueyroux de François Mauriac