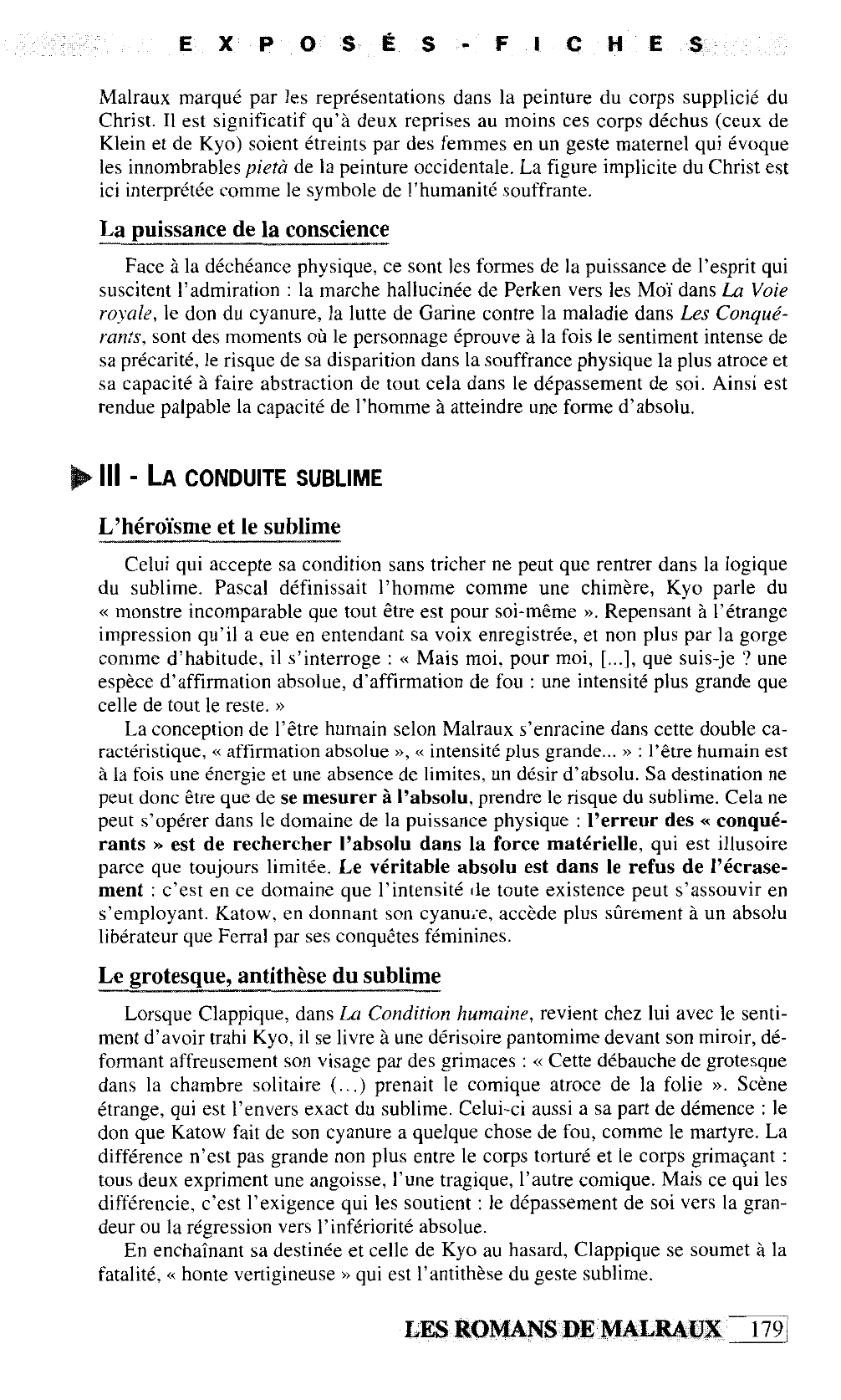Une esthétique du sublime dans Les romans de Malraux
Publié le 27/03/2015

Extrait du document
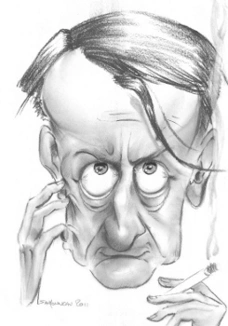
Il faut ajouter que le sublime, comme le suggère la Pensée de Pascal, naît aussi du fait que la contrainte extérieure fait prendre conscience de la disproportion entre la faiblesse physique de l'homme face aux forces qui le menacent et la puissance de l'esprit. C'est donc à la fois de ses limites, de son caractère fini et de sa vocation à les dépasser, de sa part d'infini, qu'il fait l'expérience. Celle-ci ne peut susciter que la crainte : en effet cette disproportion est très exactement la conscience de la mort possible et la grandeur de l'homme tient en entier dans cette conscience. C'est pourquoi tous les romans de Malraux mettent en scène des personnages qui risquent leur vie et font l'épreuve de leur courage à cet instant.
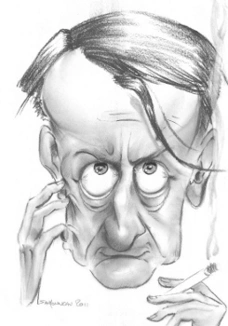
«
E X P 0 S É S F C H E S
Malraux marqué par les représentations dans la peinture du corps supplicié du
Christ.
Il est significatif qu'à deux reprises au moins ces corps déchus (ceux de
Klein et de Kyo) soient étreints par des femmes en un geste maternel qui évoque
les innombrables pietà de la peinture occidentale.
La figure implicite du Christ est
ici interprétée comme le symbole de l'humanité souffrante.
La puissance de la conscience
Face à la déchéance physique, ce sont les formes de la puissance de l'esprit qui
suscitent l'admiration: la marche hallucinée de
Perken vers les Moï dans La Voie
royale,
le don du cyanure, la lutte de Garine contre la maladie dans Les Conqué
rants, sont des moments où
le personnage éprouve à la fois le sentiment intense de
sa précarité,
le risque de sa disparition dans la souffrance physique la plus atroce et
sa capacité à faire abstraction de tout cela dans
le dépassement de soi.
Ainsi est
rendue palpable la capacité de l'homme à atteindre une forme d'absolu.
IJli- Ill -LA CONDUITE SUBLIME
L'héroïsme et le sublime
Celui qui accepte sa condition sans tricher ne peut que rentrer dans la logique
du sublime.
Pascal définissait l'homme comme une chimère, Kyo parle du
«monstre incomparable que tout être est pour soi-même».
Repensant à l'étrange
impression qu'il a eue en entendant sa voix enregistrée, et non plus par la gorge
comme d'habitude,
il s'interroge : «Mais moi, pour moi, [ ...
],que suis-je? une
espèce d'affirmation absolue, d'affirmation de
fou: une intensité plus grande que
celle de tout le reste.
»
La conception de l'être humain selon Malraux s'enracine dans cette double ca
ractéristique,« affirmation absolue»,« intensité plus grande ...
» : l'être humain est
à la fois une énergie et une absence de limites, un désir d'absolu.
Sa destination
ne peut donc être que de se mesurer à l'absolu, prendre le risque du sublime.
Cela ne
peut s'opérer dans
le domaine de la puissance physique : l'erreur des« conqué
rants » est de rechercher l'absolu dans la force matérielle, qui est illusoire
parce que toujours limitée.
Le véritable absolu est dans le refus de l'écrase ment : c'est en ce domaine que l'intensité ile toute existence peut s'assouvir en
s'employant.
Katow, en donnant son cyanu;e, accède plus sûrement à un absolu
libérateur que Ferrai par ses conquêtes féminines.
Le grotesque, antithèse du sublime
Lorsque Clappique, dans La Condition humaine, revient chez lui avec le senti
ment d'avoir trahi Kyo,
il se livre à une dérisoire pantomime devant son miroir, dé
formant affreusement son visage par des grimaces :
« Cette débauche de grotesque
dans la chambre solitaire ( ...
) prenait
le comique atroce de la folie ».
Scène
étrange, qui est l'envers exact du sublime.
Celui-ci aussi a sa part de démence:
Je
don que Katow fait de son cyanure a quelque chose de fou, comme le martyre.
La
différence
n'est pas grande non plus entre le corps torturé et le corps grimaçant:
tous deux expriment une angoisse, l'une tragique, l'autre comique.
Mais ce qui les
différencie,
c'est l'exigence qui les soutient: le dépassement de soi vers la gran
deur
ou la régression vers l'infériorité absolue.
En enchaînant sa destinée et celle de Kyo
au hasard, Clappique se soumet à la
fatalité,
« honte vertigineuse » qui est !'antithèse du geste sublime.
LES ROMANS DE MALRAUX =-u.2J.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Madame de Staël écrit on 1800 dans De la Littérature (Première Partie, chap. 11 ) : « Ce que l'homme a fait de plus grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Les esprits médiocres sont, en général, assez satisfaits de la vie commune: ils arrondissent, pour ainsi dire, leur existence, et suppléent a ce qui peut leur manquer encore par les illusions de la vanité: mais le sublime de l'esprit, des sentiments et des actions doit son essor au besoin d'échapper
- À la parution de La Condition humaine en 1933, le critique Robert Brasillach, dans un article sur les romans de Malraux, affirme: «ses livres apparaîtront en définitive comme des manuels de cruauté». En vous appuyant sur des exemples précis extraits du roman de Malraux que vous avez étudié, discutez cette affirmation.
- Présentation des romans de Malraux
- «Ses romans dressent les uns à côté et en face des autres (bien souvent aussi, au moins pour finir, les uns contre les autres) des personnages dont chacun est une existence unique, enfermée parfois malgré elle dans sa différence foncièrement impuissante à faire société avec les autres» (Claude-Edmonde Magny, Esprit, 1948). En vous appuyant sur des exemples précis, commentez ces propos de C.-E. Magny sur les romans de Malraux.
- Principaux thèmes des romans de Malraux