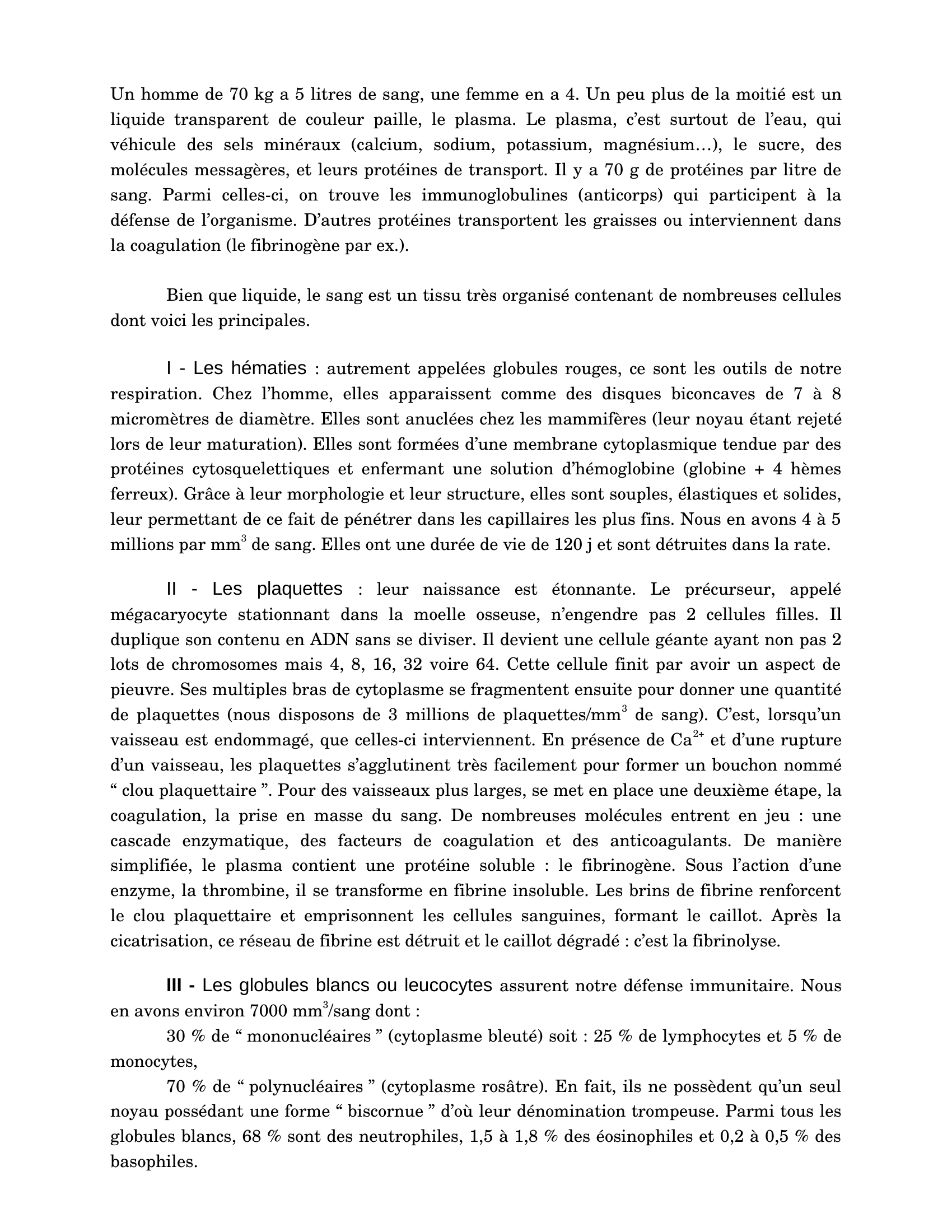ORGANISATION TISSULAIRE
Publié le 19/11/2012

Extrait du document
TP3 INTRODUCTION On reconnaît dans l'organisme différents niveaux d'organisation structurale. On retrouve ainsi, au niveau le plus élémentaire, les molécules qui s'associent entre elles pour former les organites, composants de base des cellules. A un niveau plus complexe, les cellules s'organisent en tissus, qui, à leur tour, constitueront les différents organes. Les tissus, qui représentent donc le premier niveau d'organisation supra- cellulaire, se répartissent en 4 grandes familles : les épithéliums, les tissus conjonctifs, les tissus nerveux et les tissus musculaires. A ces 4 grandes familles, il faut adjoindre les populations cellulaires libres que l'on retrouve notamment dans le sang. Si certains organes sont composés d'un seul type de tissu, d'autres par contre résultent de l'association fonctionnelle de plusieurs types tissulaires. Au cours du TP, 2 organes seront observés afin d'illustrer les différents types d'organisation que l'on peut rencontrer. Ainsi, dans un premier temps vous observerez un organe un peu particulier, constitué de cellules libres : le sang. Dans un deuxième temps vous observerez une coupe transversale d'intestin grêle de lapin constitué de 2 types tissulaires. A/ LE SANG : un organe à part entière. Fluide vital pulsé par le coeur au long des 200km de l'arborescence des vaisseaux, le sang irrigue tous les tissus et les organes, les nourrit, les nettoie, les défend. Au travers des capillaires, il fournit aux cellules l'oxygène et le glucose qu'elles brûlent pour en tirer de l'énergie. Prenant le relais du tube digestif, il leur distribue les nutriments indispensables à leur métabolisme. Au passage, il récupère le gaz carbonique, qu'il libère dans les poumons, et les déchets du fonctionnement cellulaire, qu'il évacue vers le rein. Du sang dépendent aussi les défenses de notre organisme face aux agressions extérieures. Pour se faire, il dispose d'une batterie de cellules aussi diverses que spécialisées. Le sang assure aussi lui-même la surveillance et la réparation de son circuit. En cas de blessure d'un vaisseau, il répare la brèche. Loin d'être une simple suspension cellulaire, il véhicule aussi d'innombrables molécules d'information - des hormones, des messagers chimiques - permettant une communication rapide entre tous nos organes. Respiration, immunité, réparation, nutrition et communication. Ces cinq fonctions majeures font bien du sang un organe aussi primordial que le cerveau ou le coeur. De quoi est-il composé ? Un homme de 70 kg a 5 litres de sang, une femme en a 4. Un peu plus de la moitié est un liquide transparent de couleur paille, le plasma. Le plasma, c'est surtout de l'eau, qui véhicule des sels minéraux (calcium, sodium, potassium, magnési...
«
Un homme de 70 kg a 5 litres de sang, une femme en a 4. Un peu plus de la moitié est un
liquide transparent de couleur paille, le plasma.
Le plasma, c’est surtout de l’eau, qui
v
éhicule des sels min éraux (calcium, sodium, potassium, magn ésium…), le sucre, des
mol
écules messag ères, et leurs prot éines de transport. Il y a 70 g de prot éines par litre de
sang.
Parmi cellesci, on trouve les immunoglobulines (anticorps) qui participent
à la
d
éfense de l’organisme. D’autres prot éines transportent les graisses ou interviennent dans
la coagulation (le fibrinog
ène par ex.).
Bien que liquide, le sang est un tissu tr
ès organis é contenant de nombreuses cellules
dont voici les principales.
I - Les hématies : autrement appel
ées globules rouges, ce sont les outils de notre
respiration.
Chez l’homme, elles apparaissent comme des disques biconcaves de 7
à 8
microm
ètres de diam ètre. Elles sont anucl ées chez les mammif ères (leur noyau étant rejet é
lors de leur maturation). Elles sont form
ées d’une membrane cytoplasmique tendue par des
prot
éines cytosquelettiques et enfermant une solution d’h émoglobine (globine + 4 h èmes
ferreux). Gr
âce à leur morphologie et leur structure, elles sont souples, élastiques et solides,
leur permettant de ce fait de p
énétrer dans les capillaires les plus fins. Nous en avons 4 à 5
millions par mm 3
de sang. Elles ont une dur
ée de vie de 120 j et sont d étruites dans la rate.
II - Les plaquettes : leur naissance est
étonnante.
Le pr écurseur, appel é
m
égacaryocyte stationnant dans la moelle osseuse, n’engendre pas 2 cellules filles.
Il
duplique son contenu en ADN sans se diviser. Il devient une cellule g
éante ayant non pas 2
lots de chromosomes mais 4, 8, 16, 32 voire 64.
Cette cellule finit par avoir un aspect de
pieuvre. Ses multiples bras de cytoplasme se fragmentent ensuite pour donner une quantit
é
de plaquettes (nous disposons de 3 millions de plaquettes/mm 3
de sang).
C’est, lorsqu’un
vaisseau est endommag
é, que cellesci interviennent. En pr ésence de Ca 2+
et d’une rupture
d’un vaisseau, les plaquettes s’agglutinent tr
ès facilement pour former un bouchon nomm é
“ clou plaquettaire ”. Pour des vaisseaux plus larges, se met en place une deuxi
ème étape, la
coagulation, la prise en masse du sang.
De nombreuses mol
écules entrent en jeu : une
cascade enzymatique, des facteurs de coagulation et des anticoagulants.
De mani
ère
simplifi
ée, le plasma contient une prot éine soluble : le fibrinog ène.
Sous l’action d’une
enzyme, la thrombine, il se transforme en fibrine insoluble. Les brins de fibrine renforcent
le clou plaquettaire et emprisonnent les cellules sanguines, formant le caillot.
Apr
ès la
cicatrisation, ce r
éseau de fibrine est d étruit et le caillot d égrad é : c’est la fibrinolyse.
III - Les globules blancs ou leucocytes assurent notre d
éfense immunitaire. Nous
en avons environ 7000 mm 3
/sang dont :
30 % de “ mononucl
éaires ” (cytoplasme bleut é) soit : 25 % de lymphocytes et 5 % de
monocytes,
70 % de “ polynucl
éaires ” (cytoplasme ros âtre).
En fait, ils ne poss èdent qu’un seul
noyau poss
édant une forme “ biscornue ” d’o ù leur d énomination trompeuse. Parmi tous les
globules blancs, 68 % sont des neutrophiles, 1,5
à 1,8 % des éosinophiles et 0,2 à 0,5 % des
basophiles..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- THÈME 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant Thème 1A : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique Chapitre 1 : Les divisions cellulaires, transmission du programme génétique chez les eucaryotes
- THEME 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant Partie A : Génétique et évolution Chapitre 1 : L’origine du génotype des individus
- Compte-rendu critique 5 « La transformation des modèles d’organisation et de démocratie dans les partis. L’émergence du parti-cartel », Richard Katz
- Comment les littoraux participent-ils à l’organisation des espaces productifs dans le monde ?
- organisation et coordination du travail