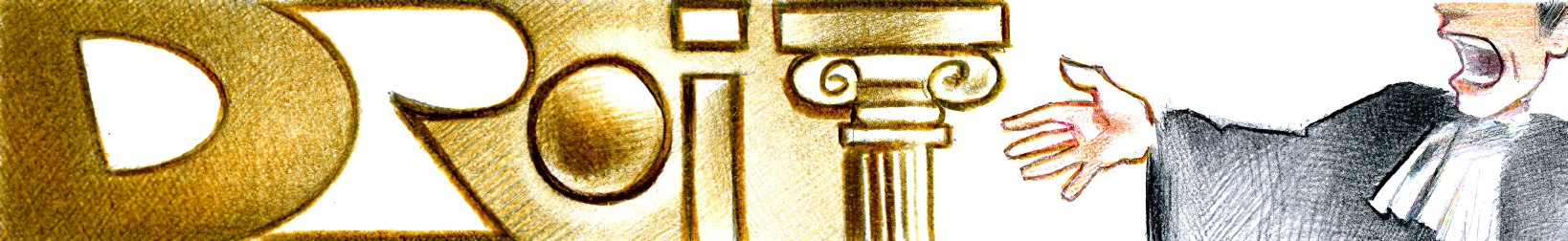L’AFFAIRE Dominici
Publié le 13/12/2018
Extrait du document
L’AFFAIRE
Dominici
5 août 1952. Tout annonce une journée splendide à Lurs, un village au bord de la nationale 16, dans cette région des Alpes de Haute-Provence où le tourisme n'est pas encore très développé. Cette région, qu’a chantée Giono, s’appelle encore les Basses-Alpes.
Mais voici que, dès 6 heures du matin, un motocycliste qui se rendait à son travail, M. Olivier, s’arrête à la gendarmerie:
— Venez vite, il y a un cadavre, une petite fille, près de la ferme de la Grand-Terre. C'est le fils Dominici, Gustave, qui vient de me le dire.
Les gendarmes découvrent non pas un mais trois cadavres. Il s’agit d'une famille de touristes anglais qui s’étaient installés là la veille au soir pour camper. On les identifie : un grand spécialiste de la diététique, sir Jack Drummond, son épouse, lady Ann, et leur fille Elizabeth, âgée de dix ans. La femme, étendue sur le ventre, à cinq mètres de la voiture, a été frappée de trois balles dans la poitrine. Le mari, encore en pyjama, gît de l’autre côté de la route. Il a reçu deux balles dans le dos et porte une blessure à une main. Enfin, le cadavre de la fillette est beaucoup plus à l’écart, près d’un chemin qui mène à la Durance. Elle a le crâne broyé, et l’on trouve sous sa tête un éclat de bois qui paraît provenir d’une crosse de fusil. Sur place encore, une
«
.
__ , __ ____ , _ _____
__ ........._ _ _
mare de sang, ainsi que deux douilles de carabine et deux cartouches
non percutées.
Lenquête est confiée au commissaire Sébeille, de la police
judiciaire de Marseille, assisté de ses collègues du commissariat de
Digne.
Le jour même, on découvre dans un trou de la Durance une
vieille carabine américaine, brisée.
C'est l'arme du crime, puisque
l'éclat de bois s'adapte parfaitement.
Pourtant, les enquêteurs, qui
veulent surtout faire «parler» la carabine, négligent deux détails im
portants: d'une part, dans la ferme voisine des Dominici, un pantalon
fraîchement lavé sèche au soleil -a-t-on voulu faire disparaître des
traces de sang? Il eût été intéressant de le saisir et de faire une
analyse.
D'autre part, les gendarmes ont repéré sur les lieux des traces
de chaussures de pointure 42, avec des semelles comportant des signes
très repérables.
Pourtant, aucun moulage ne sera fait, et aucune re
cherche ne sera effectuée pour trouver le propriétaire des chaussures.
Tout d'abord, l'attention des enquêteurs se fixe sur le •clan
Dominici»: il s'agit d'une famille exploitant la ferme de la Grand
Terre, à cent cinquante mètres de l'endroit où les Anglais s'étaient
arrêtés pour la nuit.
li y a le père, Gaston, patriarche à la moustache
blanche et qui s'exprime surtout en patois, sa femme, dite «la Sar
dine», un de leurs fils, Gustave, et l'épouse de ce dernier.
Le commissaire Sébeille note en tout cas avec intérêt que
Clovis Dominici, le fils aîné de Gaston, est littéralement bouleversé
quand il lui présente la carabine, dans le but d'en identifier le proprié
taire: - Je n'ai jamais vu cette arme, affirme Clovis.
Pourtant le commissaire note:
- Il est pris d'un tel saisissement qu'il tremble, se mord les lèvres et
ouvre de grands yeux.
Clovis ment, c'est certain, mais les enquêteurs, qui ont suivi
plusieurs pistes (on a même déliré sur une histoire de services secrets
et de règlement de comptes puisque sir Jack aurait appartenu à l'Intel
ligence Service pendant la guerre, alors qu'en réalité il occ upait des
fonctions au ministère du Ravitaillement!), ne s'intéressent plus qu'à
la Grand-Terre, et singulièrement à Gustave.
En effet, celui-ci a men
ti.
On en a la preuve.
Que dit Gustave?
- La veille, en arrosant trop un champ au-dessus de la voie ferrée,
j'ai craint un éboulement et j'ai été prévenir un brigadier-chef de la
SNCF.
Dans la nuit, alors que j'étais couché, j'ai entendu des détona
tions mais je n'ai pas bougé, j'étais terrorisé.
Et c'est vers 5 heures,
pour aller voir les risques d'éboulement, que j'ai vu sur le chemin le
cadavre de la petite fille.
J'ai alors demandé à M.
Olivier, qui passait
là, d'aller chercher les gendarmes.
Contrairement à ses affirmations, il n'a pu voir le cadavre de
l'enfant qui ne se trouvait pas vraiment sur le chemin, mais dans un
petit ravin.
En outre, il aurait dû bien évidemment se diriger vers la
voiture des Anglais, ne serait-ce que pour les prévenir.
Il affirme ne
pas l'avoir fait, alors que M.
Olivier dit qu'il a été interpellé par
Gustave, qui se trouvait à côté de la voiture_ Interrogé, Gustave finit
par avouer que, lorsqu'il a vu la fillette, celle-ci vivait encore, qu'elle
«ronronnait• et qu'elle a agité faiblement un bras_ S'il a vu l'enfant,
ce n'est donc pas comme ille dit vers 5 heures et demie puisque le
médecin légiste affirme qu'à cette heure la petite était déjà morte.
C'était donc plus tôt.
Or des camionneurs, passant à petite vitesse
entre 4 h 30 et 4 h 50 (nous sommes en plein été, le jour se lève très
tôt), ont vu ceci: le premier, que la voiture était recouverte d'une
bâche et qu'un lit de camp se trouvait à quelques mètres du capot;
l'autre, qu'il y avait bien la voiture mais ni lit de camp ni bâche.
Conclusion: «quelqu'un» a organisé une mise en scène pendant ces
vingt minutes à un moment où, fort probablement, la petite Elizabeth
vivait encore.
Enfin, plusieurs témoins ont entendu cinq coups de feu
et deux douilles seulement ont été retrouvées.
Il a donc fallu que
quelqu'un ramasse les trois douilles manquantes.
Finalement, Gus
tave Dominici est inculpé pour non-assistance à personne en danger et
condamné à deux mois de prison !
Lenquête continue.
Elle piétine.
Pourtant, trois témoins
disent des choses intéressantes.
M.
Paul Maillet, un voisin:
- Gustave m'a déclaré: «Si tu avais vu et entendu ces cris d'horreur!
Je ne savais plus où me mettre."
Gustave, cependant, a toujours déclaré qu'il n'avait rien vu,
et n'avait entendu que des coups de feu.
M.
Roure (de la SNCF) puis
M.
Ricard, eux, sont passés sur les lieux respectivement à 6 h 45 et
7 h 30.
M.
Roure verra le corps de lady Ann enveloppé dans une
couverture et allongé sur Je dos alors que M.
Ricard ne verra pas de
couverture.
Quant aux gendarmes, arrivés vers 7 h 30, ils trouveront le
corps couché sur le ventre.
Il est donc évident que l'on a touché au
corps de la femme.
Après une reconstitution effectuée le 12 novembre 1953,
Gustave est emmené au palais de justice de Digne.
Il reconnaît qu'il a
menti sur cinq points.
Oui, il a entendu des cris (il dira «de ma
fenêtre», alors que M.
Maillet évoque un «champ de luzerne où se
trouvait Gustave»).
Oui, il a découvert Elizabeth encore vivante, et il
était 4 heures du matin.
Oui, il a attendu plusieurs heures avant de
prévenir M.
Olivier, et alors que plusieurs camions étaient passés sur
la route.
Oui, il a interpellé M.
Olivier à la hauteul' de la voiture: il ne
pouvait plus faire autrement, puisque Olivier l'avait vu là.
Oui, il a
modifié la position du cadavre de la femme, en se cachant dans un
ravin lors du passage de M.
Ricard.
Gustave Dominici est alors suspect numéro un.
Pourtant,
les enquêteurs s'intéressent également à un garçon de seize ans, Roger
Perrin, neveu de Gustave et de Clovis.
Il a donné des versions tout à
fait contradictoires sur son emploi du temps.
Enfin, on continue à
s'interroger sur Clovis.
Mais, le 13 novembre, la situation évolue brus
quement: Gustave s'effondre et déclare que l'assassin n'est autre que
son père, le vieux Gaston!
Gaston Dominici est alors âgé de soixante-seize ans, il a
vingt et un petits-enfants, il est conseiller municipal.
Jusqu'ici, il n'a
jamais varié dans ses déclarations, et l'on n'imagine guère un criminel
de cet âge, à la belle figure de patriarche!
Présenté au palais de justice de Digne le 13 au soir, il est
interrogé sans relâche.
Il proteste de son innocence.
Le 14, vers 18
heures, il se repose sous la surveillance du gardien de paix Guérino.
Celui-ci le met en confiance (sans doute sur ordre), lui parle en patois,
et brusquement le vieillard se met à pleurer en pailant de ses petits
enfants.
Guérino ne comprend pas ces larmes, les interprète différem
ment, et lui dit:
- On tiendra compte de votre âge.
C'est peut-être un accident?
- Eh bé! oui, c'est un accident.
Au brigadier Brocc a, ensuite, il déclare au contraire que
c'est Gustave qui a fait le coup, mais qu'il doit s'accuser pour sauver
l'honneur de ses petits-enfants.
Puis, interrogé par le commissaire
Prudhomme (son préféré, parce qu'il est «du pays»), il raconte:
- Dans la soirée, vers 11 h 30, je suis sorti avec la carabine pour tirer
quelques lapins.
En passant près des Anglais, j'ai vu la femme qui se
déshabillait, nous avons parlé, puis je me suis permis quelques privau
tés.
C'est alors que le mari s'est jeté sur moi: je l'ai tué, puis j'ai tiré
sur la femme, enfin j'ai assommé la fille qui s'était sauvée.
Ce récit, extravagant, ne tient pas: les coups de feu ont été
tirés vers l h 30 de matin, et même si l'on admet la tentative d'un
vieillard lubrique, force est de constater que lady Ann n'était pas
déshabillée et qu'on la voit mal engager un dialogue galant avec un.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'affaire Dominici
- L'AFFAIRE DOMINICI
- affaire boris johnson
- l'affaire dreyffus et le socialisme
- Affaire des pandora papers