BAUDELAIRE Charles Pierre : sa vie et son oeuvre
Publié le 15/11/2018
Extrait du document
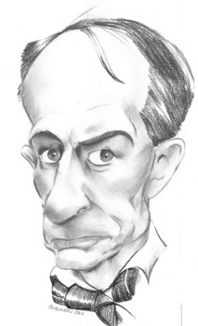
BAUDELAIRE Charles Pierre (1821-1867). Méconnu ou maudit durant son existence, dont on a trop souvent dit qu’« il ne l’avait pas méritée », Baudelaire s’est vu salué et reconnu par toutes les générations poétiques du xxc siècle, de Valéry et des surréalistes à Pierre-Jean Jouve et Yves Bonnefoy. Unanimité spectaculaire mais bien compréhensible, dans la mesure où la poésie de Baudelaire, par sa « situation » même, autorise un évident pluralisme de lectures. Lecture classique de l’œuvre d'un incontestable héritier de la grande tradition formaliste et esthétique; lecture romantique du drame d’un homme dont le « spleen » n’est étranger ni à l’aliénation socio-historique du « mal du siècle » ni aux rêveuses divagations du «vague des passions»; lecture « moderne » du discours d'un écrivain et d’un critique pour qui la poésie ne saurait être autre chose que poiêsis, instauration ou restauration de l’être dans le verbe, au gré des miracles ou des mirages de cette suprême puissance d’évocation et d’« élévation », l’imagination. La modernité de l’auteur des Fleurs du mal n’est sans doute d’ailleurs rien d’autre que l’expression et l’acceptation inconditionnelle du pluralisme : celui de l’existence déchirée entre ses fortunes diverses, celui de la conscience écartelée entre ses postulats contradictoires, celui de l’écriture « éprouvée », elle aussi, dans la multiplicité de ses tentations, mais chargée, au bout du « voyage », d’imposer l’évidence unique, heureuse et salvatrice du poème.
« Et s'il avait mérité sa vie... »
En commençant son essai de 1947, Jean-Paul Sartre posait en des termes crus, sans complaisance, les données du « cas » Baudelaire : « “Il n’a pas eu la vie qu'il méritait”. De cette maxime consolante, la vie de Baudelaire semble une illustration magnifique. Il ne méritait pas, certes, cette mère, cette gêne perpétuelle, ce conseil
de famille, cette maîtresse avaricieuse, ni cette syphilis — et quoi de plus injuste que sa fin prématurée? Pourtant, à la réflexion, un doute surgit : si l'on considère l’homme lui-même, il n’est pas sans faille ni, semble-t-il, sans contradictions (...). Est-il donc si différent de l’existence qu’il a menée? Et s’il avait mérité sa vie? Si, au contraire des idées reçues, les hommes n’avaient jamais que la vie qu’ils méritent? Il faut y regarder de plus près ». A suivre le conseil du philosophe, que voit-on? Une existence en effet constamment fissurée, lézardée, contradictoire. Si Baudelaire n’a pas su, ou pas pu, se peindre autrement que l'homo duplex qui hante d’un bout à l’autre son écriture, c’est que son destin d'homme et d’artiste est constamment parcouru du fil brûlant qui sépare le bonheur de la détresse, la réussite de l’échec, l'enthousiasme de la rumination, la grandeur aussi de la faiblesse. Sur le versant maudit de cette vie [voir Écrivains maudits], sur son ubac ténébreux, il y a la souffrance de l’enfant orphelin de son père à six ans, la longue haine de l’adolescent pour sa mère, Caroline Baudelaire, remariée dès 1828 avec le fantasque commandant Aupick, la solitude renfrognée de l’écolier de Lyon et de Paris, la dépravation du bohème syphilitique de 1840, l’infortune de l'amant aussi volage que trompé, la servitude de l’adulte « en tutelle », l’amertume de l’écrivain traîné en justice, le supplice du malade muré dans le silence de sa paralysie et qui « regarde passer les têtes de mort » en attendant de faire, seul, son dernier « voyage ». Mais sur l’adret de cette vie, dans un contrepoint déconcertant, s’épand la lumière d’une volonté et d’une « ressource » peu communes. Ce sont celles du bambin dévoreur de la bibliothèque paternelle, du collégien brillant, du dandy élégant qui croit au défi de Rasti-gnac, du voyageur impromptu, du critique audacieux et vigoureux, du poète ingénieux et obstiné, celles enfin de l’homme d’autant plus grand devant la souffrance et la mort qu’il est seul et, jusqu’au bout, incompris. Non seulement Baudelaire a mérité son existence, mais encore il l'a assumée pleinement, sans dérobade, au point que c’est son existence qui a mérité son œuvre. Une œuvre imprégnée dans la moindre de ses phrases ou le moindre de ses vers de cette dualité existentielle qu’il n’a pas cherché à fuir puisqu’elle était lui, puisqu’elle était le terreau et le terroir de son génie. Certes, d’aucuns diront que cette ténacité à assumer toutes les contradictions de son destin n’est pas sans rappeler la complaisance d’un Chateaubriand ou d’un Laforgue à vivre et à décrire leur « mal du siècle ». Mal à l’aise dans sa peau, mal à l’aise dans la société et l’histoire de 1848, l’auteur des Fleurs du mal devrait-il prendre place entre celui des Martyrs et celui des Complaintes, dans la longue et triste lignée de ces « malades moraux » que le xixe siècle engendra si nombreux? Non pas, car, à la différence des romantiques de 1830 comme des décadents de 1880, il fait preuve, par tempérament et par formation, d’une lucidité critique et d’une capacité d’autocritique souvent étrangères à ceux-là. C’est même cette étonnante qualité de jugement et de discernement qui fonde l’originalité de la « situation » littéraire de Baudelaire. Par son intelligence humaine, sa clairvoyance esthétique et sa « prévoyance » poétique, il a tout « mérité » dans son destin d’homme et d’artiste parce qu’il a su d'abord tout « méditer » et presque tout comprendre dans le grand tournant de notre histoire littéraire que fut la décennie 1850-1860, où l’âge classique bascule, avec la faillite du romantisme, dans l’ère de la modernité. Une modernité qui est d’abord son fait, puisque le premier, il l’a désirée et identifiée en tant que telle.
L'œuvre critique
Longtemps négligée, la somme des écrits journalistiques et critiques de Baudelaire (Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains, Salons de 1845, de 1846 et 1859, l'Exposition universelle de 1855, le Peintre de la vie moderne et autres Curiosités esthétiques) apparaît aujourd'hui décisive pour la bonne intelligence d’une œuvre poétique que, chronologiquement et, en tout cas, ontologiquement, elle précède pour une bonne part. Cette épreuve du goût et du jugement que lui imposèrent les aléas de l’existence, et particulièrement la gêne financière, est indiscutablement à l’origine de la rigueur et de la maîtrise qui caractérisent sa propre esthétique. Dans le domaine littéraire, outre l’intérêt de réflexions pertinentes et souvent définitives sur ses contemporains (sur le dandysme de Chateaubriand, la grandeur et l’« universalité » de Hugo, l’« ardeur vitale » et le « génie » de Balzac, sur l’« ironie » de Flaubert ou les « descriptions trop bien faites » de Leconte de Lisle), on retiendra de la critique baudelairienne qu’elle lui est un permanent prétexte à se situer dans le grand débat littéraire du demi-siècle qui voit se croiser les dernières voix déchirées du romantisme et les déclarations tapageuses du formalisme d’un côté, du réalisme et du positivisme de l'autre. Ses analyses répétées du phénomène romantique comme des tentations de l’« art pour l’art » ou de la science lui ont en effet permis d’en dénoncer les excès respectifs, d’en prendre la mesure et de se frayer une voie personnelle, à l’abri des pièges où certains, même parmi ses amis, allaient se fourvoyer.
Si Baudelaire accorde tant de place dans son œuvre critique au romantisme et aux romantiques, c’est que, par tempérament et parfois par conviction, il se sent proche de cette génération d'écrivains où se trouvent les plus évidents de ses inspirateurs : Chateaubriand, grande figure du « dandysme du malheur »; Pétrus Borel, le lycanthrope, dont les « élucubrations » comblent ses ardeurs de bohème débraillé dans les années 40; Balzac,
chez qui, à la même époque, il s’initie au système idéaliste de Swedenborg; Sainte-Beuve surtout, dont les Poésies et pensées de Joseph Delorme s’imposeront longtemps à lui comme le modèle du recueil lyrique. Ce dernier engouement suffit à esquisser le profil psychologique et émotionnel du jeune critique des deux premiers Salons ou de l'Art romantique de 1851. Un frère jumeau probablement de Samuel Cramer, le héros de son unique nouvelle, la Fanfarlo (1847) : «une nature ténébreuse, bariolée de vifs éclairs — paresseuse et entreprenante à la fois —, féconde en desseins difficiles et en risibles avortements ». Un tel aveu de tourment, d’écartèlement entre les forces du désir ou de la volonté et l’impuissance de l’action ou de la création n’autorise pourtant pas une identification complète entre le jeune écrivain et ses aînés romantiques. L’admiration qu’il leur porte ne va pas sans son lot de reproches, parfois très durs. Le mépris qu’il affiche pour Musset, par exemple, témoigne assez tôt de la double distance qu’il prend sur les plans formel et thématique avec la plupart des poètes de 1830. Musset est « un croque-mort langoureux », écrit-il. Entendons par là que le critique refuse l’épanchement systématique et larmoyant des émotions du cœur dans le langage. Et si Baudelaire dit encore de l’auteur des Nuits, sur le mode paradoxal, qu’il a « la faculté poétique » mais qu'« il est mauvais poète », c’est qu'il est aussi coupable à ses yeux du péché capital de laxisme formel, d’abus des licences et des « facilités » de l’écriture.
On comprend dès lors la fascination qu’a pu exercer un long temps sur Baudelaire un écrivain comme Théophile Gautier, qu’il connaît depuis ses années de collège à Louis-le-Grand. L’ancien militant du romantisme conquérant de Juillet, devenu à partir de 1840 le pionnier de l’« art pour l’art », va l’initier aux vertus du formalisme, et c’est par lui qu’il approche les nombreux cercles et « écoles » (école plastique, école païenne, etc.) qui fleurissent sur les décombres du romantisme moribond. Auprès du « poète impeccable », il prend une leçon de rigueur et de perfection formelles, dont l’écriture des Fleurs du mal restera profondément marquée. Mais, s’il salue en Gautier le « métier » de l'écrivain et le courage du théoricien qui fait front contre l’entreprise positiviste, Baudelaire, là encore, sait garder ses distances vis-à-vis de son « modèle » et des milieux littéraires qu’il fréquente. Ni le « matérialisme païen » de certains, qui heurte sa spiritualité, ni l’esthétisme gratuit ou le « naturalisme » de bon aloi des écoles à la mode ne peuvent combler son génie, plus enclin à soupçonner le beau et à dénoncer le naturel qu’à s’y complaire ou à l’encenser. La flatteuse dédicace des Fleurs du mal cachera mal ainsi une désaffection grandissante à l’égard de l’auteur & Émaux et camées, en qui il ne reconnaîtra plus le créateur passionné et pittoresque de la Comédie de la mort. Il est vrai que, dans le temps où celui-ci évolue vers un formalisme sclérosant, qui sera l’un des derniers pièges du classicisme, Baudelaire comprend, lui, qu'il ne saurait y avoir de perfection sans émotion, de beauté sans authenticité, de métier sans tempérament. L’un croit encore en l'éternité du style et en une rédemption purement esthétique; l’autre parie déjà sur la modernité — c’est-à-dire sur la pertinence sociale — de l'écriture.
De ce pari, la critique esthétique de Baudelaire, et notamment la critique picturale, rend encore mieux compte que ses chroniques littéraires. Non seulement l’auteur des Salons accorde aux peintres une place primordiale dans ses écrits, mais il apparaît à leur lecture que c’est d’eux souvent qu’il se sent le plus proche, que c’est en leurs œuvres qu’il voit le plus nettement se dessiner le tracé de la modernité qu’il appelle de tous ses vœux. Quelles raisons ont favorisé cette connivence de l'écrivain et des peintres? Outre l’ouverture d'esprit du poète, qui fait dire à G. Blin que Baudelaire est de ceux qui acceptent « que le chant n’appartienne pas toujours à la voix ni la poésie au poète », il est certain que celui-ci a reconnu dans la peinture de ses contemporains la qualité qui, pour lui, doit être au cœur de toute création : le mouvement, c’est-à-dire cette essentielle énergie qui « dynamise » l’œuvre et bouscule l’état émotionnel de qui la contemple. Une énergie qu’il retrouvera d’ailleurs plus tard chez certains musiciens, dans les envolées de Liszt, dans les grandes « houles » des symphonies de Beethoven, dans les « extases » wagnériennes, surtout, dont le compositeur, dira-t-il dans sa Lettre à Wagner, excelle à « peindre l’espace et la profondeur ». La sculpture, en revanche, à propos de laquelle il commet sans doute ses seules graves fautes de jugement en sous-estimant Rude ou Pradier et en ignorant curieusement Carpeaux, « l’ennuie » parce que « brutale et positive comme la nature », trop immédiate et trop esclave de l’objet auquel elle s’attache.
De l’artiste « moderne » c’est donc le peintre — et, en l’occurrence, Constantin Guys, dans la célèbre chronique parue en 1863 dans le Figaro — qui est la meilleure incarnation : « Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il? A coup sûr, cet homme, tel que je l’ai dépeint, ce solitaire doué d’une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d’hommes, a un but plus élevé que celui d’un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance ». Par le dynamisme de sa démarche, par son mouvement, le peintre échappe au dilemme qui était déjà celui de la confrontation entre romantisme et formalisme, entre le pur, mais contestable, épanchement de l’émotion et le fixisme injustifiable de la beauté éternelle. La modernité qu’impose le Peintre de la vie moderne est, au contraire, dépassement et résolution du dualisme puisqu’« il s’agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire ». La modernité, dit encore Baudelaire, « c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable ». Voici réconciliées d’un coup par ce « pari » l’exigence d’authenticité émotionnelle que seule garantit l’ancrage de l’œuvre dans le fugitif du quotidien, et celle d’éternité qu’assure le dégagement de l’invariable du relatif et du circonstanciel par le « travail » poétique.
On voit ainsi que la notion de modernité baudelai-rienne ne saurait se confondre ni avec celle d’actualité ni avec celle de contemporanéité : « Le mouvement de la modernité, écrit encore G. Blin, va toujours dans le sens de la spécification, introduisant les idiotismes de race, de province, de métier — et point seulement chronologiques. Baudelaire dépasse ainsi la “contemporanéité” balzacienne, qui magnifie naïvement son époque comme le sommet de l’histoire; lui, dégage de son temps ce qu’il tient d’épique et de transitoirement éternel, il réussit à se déprendre, à se situer déjà au futur passé ». Des peintres « modernes », ou tout du moins des initiateurs de la modernité, il en existe donc déjà dans le
passé : Brueghel le Drôle et son chaos onirique et fantasmatique; Goya, le maître du « monstrueux vraisemblable »; Watteau et ses artifices aussi délicieux qu’intrigants... Parmi ses contemporains, s’il salue le talent d’Ingres et de David, ses préférences vont naturellement à Daumier, à Courbet et, plus tard, à Manet et Cézanne. Mais de tous, il en est un dont, à force de l’observer, de le commenter et de le « remodeler » dans son commentaire, il partage toute l’esthétique : c’est Eugène Delacroix, « peintre complet et homme complet ». L’auteur des Femmes d'Alger, moderne par sa volonté de rester passionné tout en maîtrisant dans l’œuvre le jeu des passions, le confirme dans son espérance d’une esthétique nouvelle. Chez lui, en effet, l’art semble se refuser à toutes les servitudes de l’imitation d’une nature dont on sait que Baudelaire la juge aussi laide que « coupable », pour se faire expression, ou plutôt suggestion, d’une émotion et d’une spiritualité résolument individuelles et originales. Delacroix, écrit Baudelaire, est un peintre « suggestif; ce qu’il traduit c’est l’invisible, l’impalpable, c’est le rêve, c’est les nerfs, c’est l’âme ». Autrement dit, comme l’affirme J. Lacoste dans sa Philosophie de l'art, à partir de Delacroix « le vrai sujet, c’est le peintre lui-même et ses émotions ».
Ce n’est pas que l’artiste, salué aussi par Baudelaire comme le plus grand des romantiques, se complaise exclusivement dans l’évocation de son intimité. En rompant, par le choix de certains sujets et la hardiesse des couleurs de sa palette, avec les canons de l’esthétique classique (imitation, fidélité, vraisemblance, sobriété, etc.), Delacroix ouvre au contraire l’espace de la toile à l’imaginaire. Sans nier ni dédaigner le monde des choses et des apparences, il le remodèle dans l’acte même du regard qu’il porte sur lui. Et ce regard pour lui, pour Baudelaire comme pour Edgar Poe, autre initiateur de la modernité, a nom « imagination »; non la fancy des fictions-impostures, mais la « constructive imagination », l’imagination combinatrice, celle qui décompose les données du réel pour les imposer dans l’évidence étrange et heureuse de l’œuvre. Si « le beau est toujours bizarre » pour Baudelaire, s’il apprécie tant les contrastes de Delacroix, les « chinoiseries » de l’Exposition universelle de 1855, les caricatures de Daumier, les croquis de C. Guys, les « mensonges » des décors de théâtre, s’il vante chez le dandy le raffinement et le goût des artifices et ne tolère dans la féminité que l’« art du maquillage », c’est qu’il ne conçoit pas le beau autrement que comme la tenace et active contestation du vrai. « Je préfère, écrit-il dans le Salon de 1859, contempler quelques décors de théâtre, où je trouve artistement exprimés et tragiquement concentrés mes rêves les plus chers. Ces choses, parce qu’elles sont fausses, sont infiniment plus près du vrai, tandis que la plupart de nos paysagistes sont des menteurs justement parce qu’ils ont négligé de mentir ». La poétique des Fleurs du mal et du Spleen de Paris ne sera pas autre chose que l’épreuve personnelle de cette grande leçon d’esthétique.
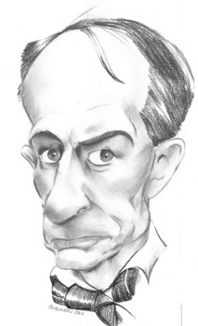
«
mort
qu'il est seul et, jusqu'au bout, incompris.
Non
seulement Baudelaire a mérité son existence, mais
encore ill' a assumée pleinement, sans dérobade, au point
que c'est son existence qui a mérité son œuvre.
Une
œuvre imprégnée dans la moindre de ses phrases ou le
moindre de ses vers de cette dualité existentielle qu'il
n'a pas cherché à fuir puisqu'elle était lui, puisqu'elle
était le terreau et le terroir de son génie.
Certes, d'aucuns
diront que cette ténacité à assumer toutes les contradic
tions de son destin n'est pas sans rappeler la complai
sance d'un Chateaubriand ou d'un Laforgue à vivre et à
décrire leur« mal du siècle >>.
Mal à l'aise dans sa peau,
mal à 1 'aise dans la société et l'histoire de 1848.
1' auteur
des Fleurs du mal devrait-il prendre place entre celui des
Martyrs et celui des Complaintes, dans la longue et triste
lignée de ces « malades moraux » que le xrx • siècle
engendra si nombreux? Non pas, car, à la différence des
romantiques de 1830 comme des décadents de 1880, il
fait preuve, par tempérament et par formation, d'une
lucidité critique et d'une capacité d'autocritique souvent
étrangères à ceux-là.
C'est même cette étonnante qualité
de jugement et de discernement qui fonde l'originalité
de la« situation >> littéraire de Baudelaire.
Par son intelli
gence humaine, sa clairvoyance esthétique et sa «p ré
voyance » poétique, il a tout > de Hugo, l'> ou de la science lui ont
en effet permis d'en dénoncer les excès respectifs, d'en
prendre la mesure et de se frayer une voie personnelle, à
l'abri des pièges où certains, même parmi ses amis,
allaient se fourvoyer.
Si Baudelaire accorde tant de place dans son œuvre
critique au romantisme et aux romantiques.
c'est que,
par tempérament et parfois par conviction, il se sent
proche de cette génération d'écrivains où se trouvent les
plus évidents de ses inspirateurs : Chateaubriand, grande
figure du «dandysme du malheur>> ; Pétrus Borel, le
lycanthrope, dont les « élucubrations >> comblent ses
ardeurs de bohème débraillé dans les années 40; Balzac, chez
qui, à la même époque, il s'initie au système idéa
liste de Swedenborg; Sainte-Beuve surtout, dont les Poé
sies et pensées de Joseph Delorme s'imposeront long
temps à lui comme le modèle du recueil lyrique.
Ce
dernier engouement suffit à esquisser le profil psycholo
gique et émotionnel du jeune critique des deux premiers
Salons ou de l'Art romantique de 1851.
Un frère jumeau
probablement de Samuel Cramer, le héros de son unique
nouvelle, la Fanfarlo (184 7) : « une nature ténébreuse,
bariolée de vifs éclairs -paresseuse et entreprenante à
la fois -, féconde en desseins difficiles et en risibles
avortements>>.
Un tel aveu de tourment, d'écartèlement
entre les forces du désir ou de la volonté et 1' impuissance
de l'action ou de la création n'autorise pourtant pas une
identification complète entre le jeune écrivain et ses
aînés romantiques.
L'admiration qu'il leur porte ne va
pas sans son lot de reproches, parfois très durs.
Le mépris
qu'il affiche pour Musset, par exemple, témoigne assez
tôt de la double distance qu'il prend sur les plans formel
et thématique avec la plupart des poètes de 1830.
Musset
est « un croque-mort langoureux », écrit-il.
Entendons
par là que le critique refuse l'épanchement systématique
et larmoyant des émotions du cœur dans le langage.
Et
si Baudelaire dit encore de l'auteur des Nuits, sur Je
mode paradoxal, qu'il a «la faculté poétique» mais
qu'« il est mauvais poète», c'est qu'il est aussi coupable
à ses yeux du péché capital de laxisme formel, d'abus
des licences et des , va l'initier aux vertus du forma
lisme, et c'est par lui qu'il approche les nombreux cer
cles et «écoles >> (école plastique, école païenne, etc.)
qui fleurissent sur les décombres du romantisme mori
bond.
Auprès du «poète impeccable >>, il prend une leçon
de rigueur et de perfection formelles, dont l'écriture des
Fleurs du mal restera profondément marquée.
Mais, s'il
salue en Gautier Je« métier» de l'écrivain et le courage
du théoricien qui fait front contre l'entreprise positiviste,
Baudelaire, là encore, sait garder ses distances vis-à-vis
de son «modèle» et des milieux littéraires qu'il fré
quente.
Ni le « matérialisme païen » de certains, qui
heurte sa spiritualité, ni l'esthétisme gratuit ou Je « natu
ralisme» de bon aloi des écoles à la mode ne peuvent
combler son génie, plus enclin à soupçonner le beau et à
dénoncer le naturel qu'à s'y complaire ou à l'encenser.
La flatteuse dédicace des Fleurs du mal cachera mal
ainsi une désaffection grandissante à l'égard de l'auteur
d' tmaux et camées, en qui il ne reconnaîtra plus Je créa
teur passionné et pittoresque de la Comédie de la mort.
Il est vrai que, dans le temps oll celui-ci évolue vers un
formalisme sclérosant, qui sera l'un des derniers pièges
du classicisme, Baudelaire comprend, lui, qu'il ne saurait
y avoir de perfection sans émotion, de beauté sans
authenticité, de métier sans tempérament.
L'un croit
encore en 1' éternité du style et en une rédemption pure
ment esthétique; J'autre parie déjà sur la modernité -
c'est-à-dire sur la pertinence sociale- de J'écriture.
De ce pari, la critique esthétique de Baudelaire, et
notamment la critique picturale, rend encore mieux
compte que ses chroniques littéraires.
Non seulement
l'auteur des Salons accorde aux peintres une place pri
mordiale dans ses écrits, mais il apparaît à leur lecture
que c'est d'eux souvent qu'il se sent le plus proche, que
c'est en leurs œuvres qu'il voit le plus nettement se
dessiner le tracé de la modernité qu'il appelle de tous ses
vœux.
Quelles raisons onl favorisé cette connivence de
J'écrivain et des peintres? Outre l'ouverture d'esprit du
poète, qui fait dire à G.
Blin que Baudelaire est de ceux.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SAINT-PIERRE, Charles Irénée Castel, abbé de (vie et oeuvre)
- Vie et oeuvre de Charles Baudelaire
- COLARDEAU Charles Pierre : sa vie et son oeuvre
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- Fleurs DU mal (les). Recueil poétique de Charles Baudelaire (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)


