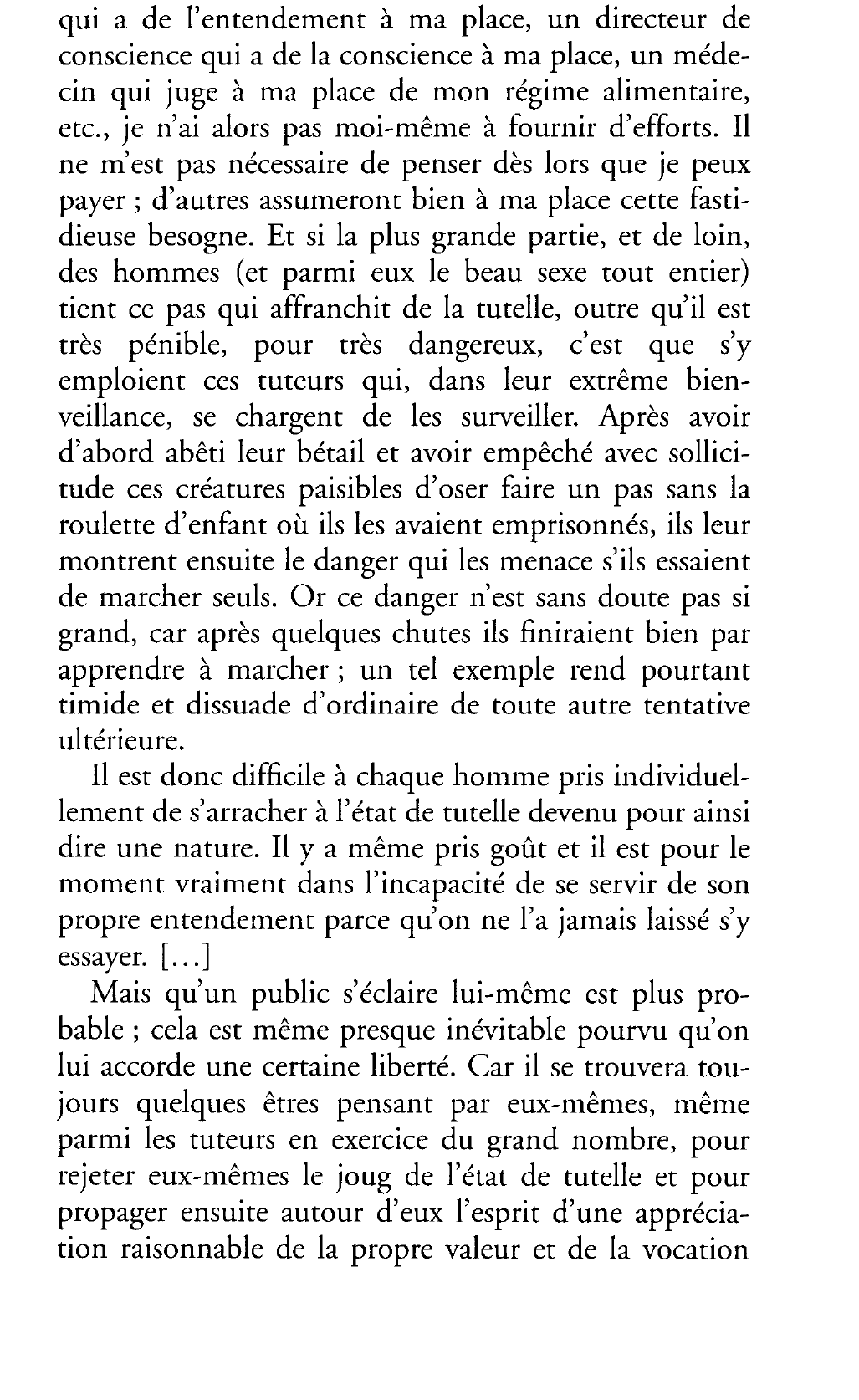Anthologie - Philosophie:
Publié le 25/03/2015
Extrait du document

qui a de l'entendement à ma place, un directeur de conscience qui a de la conscience à ma place, un médecin qui juge à ma place de mon régime alimentaire, etc., je n'ai alors pas moi-même à fournir d'efforts. Il ne m'est pas nécessaire de penser dès lors que je peux payer ; d'autres assumeront bien à ma place cette fastidieuse besogne. Et si la plus grande partie, et de loin, des hommes (et parmi eux le beau sexe tout entier) tient ce pas qui affranchit de la tutelle, outre qu'il est très pénible, pour très dangereux, c'est que s'y emploient ces tuteurs qui, dans leur extrême bienveillance, se chargent de les surveiller. Après avoir d'abord abêti leur bétail et avoir empêché avec sollicitude ces créatures paisibles d'oser faire un pas sans la roulette d'enfant où ils les avaient emprisonnés, ils leur montrent ensuite le danger qui les menace s'ils essaient de marcher seuls. Or ce danger n'est sans doute pas si grand, car après quelques chutes ils finiraient bien par apprendre à marcher ; un tel exemple rend pourtant timide et dissuade d'ordinaire de toute autre tentative ultérieure.
Il est donc difficile à chaque homme pris individuellement de s'arracher à l'état de tutelle devenu pour ainsi dire une nature. Il y a même pris goût et il est pour le moment vraiment dans l'incapacité de se servir de son propre entendement parce qu'on ne l'a jamais laissé s'y essayer. [...]
Mais qu'un public s'éclaire lui-même est plus probable ; cela est même presque inévitable pourvu qu'on lui accorde une certaine liberté. Car il se trouvera toujours quelques êtres pensant par eux-mêmes, même parmi les tuteurs en exercice du grand nombre, pour rejeter eux-mêmes le joug de l'état de tutelle et pour propager ensuite autour d'eux l'esprit d'une appréciation raisonnable de la propre valeur et de la vocation
dirigés, en vertu d'une unanimité artificielle, par le gouvernement vers des fins publiques ou, du moins, d'être empêchés de détruire ces fins. Sans doute n'est-il alors pas permis de raisonner ; on est obligé d'obéir. Mais dans la mesure où cette partie de la machine se considère en même temps comme membre de toute une communauté, voire de la société cosmopolite, il peut par suite, en sa qualité de savant qui s'adresse avec des écrits à un public au sens propre du terme, en tout état de cause raisonner sans qu'en pâtissent les activités auxquelles il est préposé en partie comme membre passif.
2. La religion naturelle
Hermann Samuel Reimarus, Les Vérités les plus éminentes de la religion naturelle [1754], trad. Gérard Raulet, in Aufkkirung. Les Lumières allemandes, ibid., p. 168-170.
Dans l e vaste plan du système de toutes choses où nous apparaît d'emblée la religion purement rationnelle, règne une totale cohérence qui non seulement ne laisse subsister dans l'âme aucune obscurité et aucune confusion mais la forme à toutes les perfections et assouvit ses aspirations naturelles. Nous y trouvons l'archétype de toute perfection, dont la contemplation nous plonge continuellement dans l'admiration, le respect, la vénération et l'amour. Nous commençons nous-mêmes à devenir intelligents et sages dans la mesure même où nous prenons conscience de la grande intelligence qui se révèle dans cet arrangement et cet ordre du monde, ainsi que de l'infinie noblesse des intentions qui y sont mises en application avec la plus grande sagacité. Notre science de la nature, dans toute sa diversité allant du plus grand au plus petit, notre connaissance des lois générales et particulières du mouvement, du cours des planètes, des causes des changements dans le ciel, dans l'atmosphère et sur la terre, de la constitution, de la reproduction, de la nutrition, de la croissance des plantes et des bêtes, et toutes autres choses encore qu'il est donné à notre entendement de connaître, tout cela n'est rien qu'un pâle reflet de cette sagesse et des règles que Dieu a réellement mises en oeuvre dans sa Création. Cette science n'est du reste attirante et nourrissante que dans la mesure où nous y percevons la perfection et la concordance des choses
3. L'aspect politique des Lumières
Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ? « [1784], trad. Jean-François Poirier et Françoise Proust, in Aufkliirung. Les Lumières allemandes, ibid., p. 336-338.
Un homme peut, certes pour sa personne, et même alors pour quelque temps seulement, ajourner les Lumières quant à ce qui lui incombe de savoir ; mais y renoncer, que ce soit pour sa personne, mais plus encore pour les descendants, c'est attenter aux droits sacrés de l'humanité et les fouler aux pieds. Mais ce que même un peuple n'est pas autorisé à décider pour lui-même, un monarque est encore bien moins autorisé à le décider pour un peuple ; car son statut de législateur repose sur ceci qu'il réunit toute la volonté du peuple dans la sienne. Pourvu qu'il ait seulement en vue que toute amélioration vraie ou supposée soit compatible avec l'ordre civil, il ne peut au demeurant que laisser ses sujets faire eux-mêmes ce qu'ils estiment nécessaire au salut de leur âme ; cela n'est aucunement son affaire, qui est bien plutôt de prévenir qu'un individu n'empêche, de tout son pouvoir et par la violence, les autres de travailler à définir et à accomplir leur salut. Il porte même préjudice à sa majesté s'il s'en mêle, en faisant les honneurs d'une surveillance gouvernementale aux écrits par lesquels ses sujets tentent de clarifier leurs vues, qu'il le fasse à partir de sa propre vue élevée des choses, ce en quoi il s'expose au reproche : Caesar non est supra grammaticos, ou, pis encore, qu'il abaisse son pouvoir suprême à soutenir dans son État le despotisme spirituel de quelques tyrans contre le reste de ses sujets.
Si on pose à présent la question : vivons-nous maintenant à une époque éclairée? la réponse est : non, mais bien à une époque de progrès des Lumières. Il s'en faut encore de beaucoup que les hommes dans leur ensemble, en l'état actuel des choses, soient déjà, ou puissent seulement être mis en mesure de se servir dans les choses de la religion de leur entendement avec assurance et justesse sans la conduite d'un autre. Cependant nous avons des indices évidents qu'ils ont le champ libre pour travailler dans cette direction et que les obstacles à la généralisation des Lumières, ou à la sortie de cet état de tutelle dont ils sont eux-mêmes responsables se font de moins en moins nombreux. À cet égard, cette époque est l'époque des Lumières, ou le siècle de Frédéric.
Un prince qui ne trouve pas indigne de lui de dire qu'il tient pour un devoir de ne rien prescrire aux hommes dans les choses de la religion, mais de leur laisser entière liberté en la matière, un prince qui va jusqu'à récuser le nom hautain de tolérance, est lui-même éclairé et mérite d'être glorifié par le monde contemporain et la postérité reconnaissants comme celui qui le premier a délivré le genre humain de l'état de tutelle, du moins pour ce qui est du gouvernement, et laissé chacun libre de se servir de sa propre raison pour toutes les questions de conscience. Sous son règne, il est permis à de vénérables ecclésiastiques, sans préjudice des devoirs de leurs fonctions, de soumettre librement et publiquement à l'examen du monde, en leur qualité de savants, des jugements et des réflexions s'écartant ici ou là du symbole admis ; mais plus encore à tous les autres qui ne sont pas limités par les obligations de leurs fonctions. Cet esprit de liberté s'étend même au-dehors, même là où il doit lutter contre les obstacles extérieurs d'un gouvernement qui se méprend
sur son propre compte. Qu'il ne soit nullement besoin de veiller à la paix et à l'unité de la communauté lorsque règne la liberté sert en effet d'exemple à ce gouvernement. Ces hommes travaillent d'eux-mêmes à sortir peu à peu de leur grossièreté dès lors qu'on ne s'ingénie pas à les y maintenir.
J'ai placé le point essentiel des Lumières, la sortie des hommes hors de l'état de tutelle dont ils sont eux-mêmes responsables, surtout dans les choses de la religion, parce que, au regard des arts et des sciences, nos souverains n'ont pas intérêt à exercer leur tutelle sur leurs sujets ; au reste, cet état de tutelle est, en même temps que le plus préjudiciable, le plus déshonorant de tous. Mais la manière de penser d'un chef d'État qui favorise les Lumières va encore plus loin et discerne que même au regard de sa législation, il est sans danger d'autoriser ses sujets à faire publiquement usage de leur propre raison et à exposer publiquement au monde leurs idées sur une meilleure rédaction de ladite législation, même si elles sont assorties d'une franche critique de celle qui est en vigueur ; nous en avons un exemple éclatant par lequel aucun monarque n'a encore devancé celui que nous vénérons.
Mais seul celui qui, lui-même éclairé, n'est pas sujet à des peurs chimériques et qui a en même temps à sa disposition une armée nombreuse et bien disciplinée pour maintenir l'ordre public, peut dire ce qu'un État libre ne peut oser dire : raisonnez autant que vous voulez et sur ce que vous voulez ; mais obéissez ! Ainsi les choses humaines prennent ici un cours déconcertant et inattendu ; et d'ailleurs, si on observe les choses dans les grands traits, tout y est paradoxal. Un degré supérieur de liberté civile semble bénéfique à la liberté de l'esprit du peuple et lui impose cependant des bornes infranchissables ; un moindre degré de liberté civile ménage
4. « Une constitution faite pour toutes les nations n'est faite pour aucune «
Joseph de Maistre, Considérations sur la France [1797], Lyon, Rusand, 1829, chap. vi, p. 93-95.
Les plus grands ennemis de la Révolution française doivent convenir avec franchise que la commission des onze qui a produit la dernière constitution a, suivant toutes les apparences, plus d'esprit que son ouvrage, et qu'elle a fait peut-être tout ce qu'elle pouvait faire. Elle disposait de matériaux rebelles, qui ne lui permettaient pas de suivre les principes ; et la division seule des pouvoirs, quoiqu'ils ne soient divisés que par une muraille 1, est cependant une belle victoire remportée sur les préjugés du moment.
Mais il ne s'agit que du mérite intrinsèque de la constitution. Il n'entre pas dans mon plan de rechercher les défauts particuliers qui nous assurent qu'elle ne peut durer ; d'ailleurs, tout a été dit sur ce point. J'indiquerai seulement l'erreur de théorie qui a servi de base à cette construction, et qui a égaré les Français depuis le premier instant de leur Révolution.
La Constitution de 1795, tout comme ses aînées, est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu, dans ma vie, des Français, des Italiens, des Russes, etc. ; je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être Persan : mais quant à l' homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie ; s'il existe, c'est bien à mon insu.
1. Selon la Constitution de 1795, les deux conseils ne peuvent en aucun cas se réunir dans une même salle (titre V, art. 60).
5. La théorie des sentiments
Mendelssohn, Lettres sur les sentiments [1755],
trad. Gérard Raulet, in Aufkliirung.
Les Lumières allemandes, op. cit., p. 428-429.
C'est là une vérité établie : ni un concept distinct, ni non plus un concept complètement obscur ne sont compatibles avec le sentiment de la beauté. Le premier parce que notre âme limitée n'est capable de percevoir aucune diversité en une seule fois de façon distincte. Il lui est en quelque sorte nécessaire de détourner son attention du tout pour réfléchir sur les parties de l'objet les unes après les autres. Le second en revanche parce que la diversité de l'objet est pour ainsi dire plongée dans l'obscurité et échappe à notre perception. Toutes les notions qui existent de la beauté doivent donc se situer dans les limites de la clarté. Plus encore : plus est claire la représentation d'un bel objet, plus le sentiment qu'elle suscite est vif et fougueux le plaisir qui en résulte. Une représentation plus claire nous fait percevoir une plus grande diversité, un plus grand nombre d'aspects de cette diversité les uns par rapport aux autres. Autant de sources de plaisir !
Prête donc attention, noble jeune homme, à la façon dont je me prépare à jouir d'un plaisir ! Je contemple l'objet de ce plaisir, je réfléchis sur chacune de ses parties et je m'efforce de les saisir distinctement. Je porte ensuite mon attention sur leur relation d'ensemble ; je m'élève des parties au tout. Les différents concepts distincts reculent en quelque sorte dans un lointain obscur. Ils conservent leur effet sur moi, mais ils l'exercent en gardant un tel équilibre les uns par rapport aux autres qu'il n'en émane en somme pour moi
membres du monstre et qu'elle ne peut même pas voir du tout la bien trop petite mite. Cette vérité est d'une extrême importance pour les poètes dramatiques.
En revanche, la contemplation du tout est pour le sage une source intarissable de plaisir. Elle agrémente ses heures de solitude, elle emplit son âme des sentiments les plus sublimes, détourne ses pensées du tumulte des choses terrestres et les rapproche du siège de la divinité. Élève-toi, cher adolescent, à la dignité de cette contemplation ! Applique mon enseignement à la beauté de la nature universelle ! Elle est la preuve la plus noble de la vérité de ma théorie. Tire d'elle la leçon qu'il est infiniment avantageux pour le sentiment du tout d'avoir auparavant réfléchi de la façon la plus distincte sur toutes ses parties.
Applique mon enseignement ! Je te le dis. Car si tu ne savais rien du merveilleux arrangement des corps célestes, si tu ignorais qu'une chaîne infinie d'êtres habite chacune des planètes, si tu ignorais que du centre de chacun des systèmes planétaires un courant tempéré de lumière et de vie rayonne dans toutes les directions, si donc tu ne savais rien de toutes ces vérités si importantes et si tu ne percevais ici et maintenant que la liaison générale des corps célestes, leur situation, leur grandeur, leur éloignement, c'est-à-dire en somme seulement le squelette de la construction copernicienne du monde, cette connaissance, je te le dis, te procurerait certes du plaisir mais elle ne comblerait pas ton âme. Sa pauvreté en diversité laisserait dans ton concept du tout des lacunes étonnantes et l'harmonie censée te ravir se ramènerait à un petit nombre de lois de la nature par lesquelles les corps célestes sont régis dans leurs évolutions.
la vérité. Dans ce sens, nous parlons aussi d'une éthique cognitiviste. Celle-ci doit pouvoir répondre à la question de savoir comment des énoncés normatifs peuvent être fondés. Bien que Kant choisisse la forme impérative (« Agis seulement selon la maxime par laquelle tu puisses en même temps vouloir qu'elle devienne une loi universelle «), l'impératif catégorique assume le rôle d'un principe de justification qui permet de déclarer valides des normes d'action universali-sables : ce qui est justifié d'un point de vue moral doit pouvoir être voulu par tous les êtres rationnels. Dans cette perspective, nous parlons d'une éthique formaliste. Dans l'éthique de la discussion, c'est la procédure de l'argumentation morale qui prend la place de l'impératif catégorique. Elle établit le principe « D « selon lequel seules peuvent prétendre à la validité les normes qui pourraient trouver l'accord de tous les concernés en tant qu'ils participent à une discussion pratique.
En même temps, l'impératif catégorique est ramené au rang d'un principe d'universalisation, « U «, qui dans les discussions pratiques assume le rôle d'une règle d'argumentation : dans le cas de normes valides, les conséquences et les effets secondaires qui d'une manière prévisible découlent d'une observation universelle de la norme dans l'intention de satisfaire les intérêts de tout un chacun doivent pouvoir être acceptés sans contrainte par tous.
Enfin, nous nommons universaliste une éthique qui affirme que ce principe moral (ou un autre analogue) n'exprime pas seulement les intuitions d'une culture ou d'une époque déterminées, mais vaut de façon universelle. Seule une fondation du principe moral qui n'est pas d'emblée renvoyée à un fait de raison peut désamorcer le soupçon d'un paralogisme ethnocen-triste. On doit pouvoir montrer que notre principe
moral ne fait pas que refléter les préjugés d'un citoyen adulte, blanc, mâle, bourgeois, issu de la Mitteleuropa. Je ne m'engagerai pas dans cette partie, la plus difficile, de l'éthique, mais je rappellerai simplement la thèse qu'établit dans ce contexte l'éthique de la discussion : quiconque entreprend sérieusement la tentative de participer à une argumentation s'engage implicitement dans des présuppositions pragmatiques universelles qui ont un contenu moral ; le principe moral se laisse déduire à partir du contenu de ces présuppositions d'argumentation, pour peu que l'on sache ce que cela veut dire de justifier une norme d'action.
Voilà pour les hypothèses déontologiques, cogniti-vistes, formalistes et universalistes fondamentales que défendent toutes les éthiques de type kantien, dans l'une ou l'autre de leur version. J'aimerais encore rapidement expliquer la procédure de discussion pratique évoquée dans le principe « D «.
Le point de vue à partir duquel les questions morales peuvent être évaluées impartialement, nous le nommons le « point de vue moral «. Les éthiques formalistes fournissent une règle qui explique comment l'on considère quelque chose sous l'égide du point de vue moral. Comme on le sait, John Rawls propose une position originelle dans laquelle tous les participants se font face en tant que décideurs rationnels, contractants égaux en droit, ignorant évidemment leur statut social effectivement adopté, position originelle qui est « la situation de départ adéquate assurant que les accords qui y sont conclus sont équitables «. Au lieu de cela, G.H. Mead recommande une adoption idéale de rôle qui exige que le sujet effectuant un jugement moral se mette à la place de tous ceux qui seraient concernés par l'accomplissement d'une action problématique ou par la mise en vigueur d'une norme litigieuse. La
procédure de la discussion pratique a des avantages par rapport aux deux constructions. Dans les argumentations, les participants doivent partir du fait qu'en principe tous les concernés prennent part, libres et égaux, à une recherche coopérative de la vérité dans laquelle seule peut valoir la force sans contrainte du meilleur argument. La discussion pratique est considérée comme une forme exigeante de formation argumenta-tive de la volonté qui (comme la position originelle de Rawls) doit garantir par les seules présuppositions universelles de la communication la justesse (ou l'équité, la fairness) de tout accord normatif possible conclu dans ces conditions. La discussion peut jouer ce rôle grâce aux présuppositions idéalisantes que les participants doivent effectivement opérer dans leur pratique argumentative ; c'est pourquoi disparaît le caractère fictif de la position originelle, ainsi que celui de cette mise en place d'une ignorance artificielle. D'autre part, la discussion pratique se laisse concevoir comme un processus d'intercompréhension qui, d'après sa forme même, assigne à tous les participants en même temps l'adoption idéale du rôle. Il transforme donc cette adoption idéale de rôle effectuée (chez Mead) par chacun en particulier et privatim en une opération publique pratiquée par tous intersubjectivement en commun.

«
72 1 PHILOSOPHIE DU PROGRÈS
qui a de l'entendement à ma place, un directeur de
conscience qui a de la conscience
à ma place, un méde
cin qui juge
à ma place de mon régime alimentaire,
etc., je n'ai alors pas moi-même
à fournir d'efforts.
Il
ne
rn' est pas nécessaire de penser dès lors que je peux
payer ; d'autres assumeront bien
à ma place cette fasti
dieuse besogne.
Et si la plus grande partie, et de loin,
des hommes (et parmi eux
le beau sexe tout entier)
tient
ce pas qui affranchit de la tutelle, outre qu'il est
très pénible,
pour très dangereux, c'est que s'y
emploient
ces tuteurs qui, dans leur extrême bien
veillance,
se chargent de les surveiller.
Après avoir
d'abord abêti leur bétail et avoir empêché avec sollici
tude
ces créatures paisibles d'oser faire un pas sans la
roulette d'enfant
où ils les avaient emprisonnés, ils leur
montrent ensuite le danger qui les menace s'ils essaient
de marcher seuls.
Or ce danger n'est sans doute pas si
grand, car après quelques chutes ils finiraient bien par
apprendre
à marcher ; un tel exemple rend pourtant
timide et dissuade d'ordinaire de toute autre tentative
ultérieure.
Il est
donc difficile à chaque homme pris individuel
lement de s'arracher
à l'état de tutelle devenu pour ainsi
dire une nature.
Il y a même pris goût et
il est pour le
moment vraiment dans l'incapacité de se servir de son
propre entendement parce
qu'on ne l'a jamais laissé s'y
essayer.
[
...
]
Mais
qu'un public s'éclaire lui-même est plus pro
bable ; cela est même presque inévitable pourvu
qu'on
lui accorde une certaine liberté.
Car il se trouvera tou
jours quelques êtres pensant par eux-mêmes, même
parmi
les tuteurs en exercice du grand nombre, pour
rejeter eux-mêmes le joug de l'état de tutelle et pour
propager ensuite autour d'eux l'esprit d'une apprécia
tion raisonnable de la propre valeur et de la vocation.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Rudolf Eucken: Einführung in die Geschichte der Philosophie Anthologie.
- Hegel, Principes de la philosophie du droit (extrait) (anthologie de textes juridiques).
- Lamarck, Philosophie zoologique (extrait) - anthologie.
- Hegel, Principes de la philosophie du droit (extrait) - anthologie.
- Anthologie sur la philosophie de Karl Popper