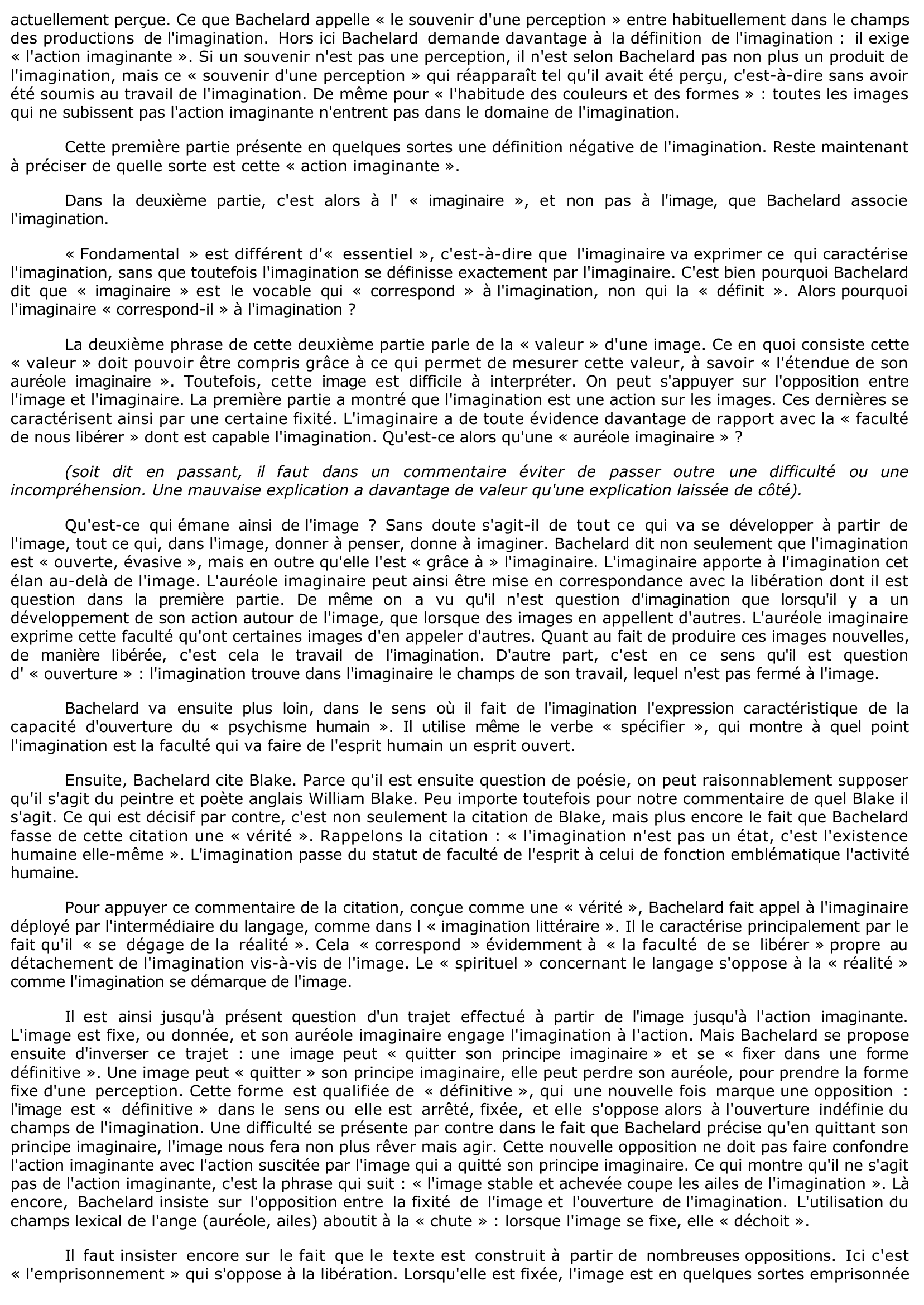BACHELARD ET L'IMAGINATION
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
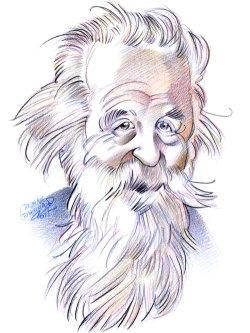
L'analyse de l'imagination faite par Bachelard dans cet extrait s'efforce de cerner la spécificité décisive de cette faculté. Loin d'être une simple capacité à former des images, l'imagination est bien plutôt caractérisée par sa mobilité et la vie qui l'anime.
La thèse de l'extrait peut en effet se formuler ainsi : l'imagination ne forme pas simplement des images, elle est une faculté dynamique et vivante, caractérisée par la mobilité mise en œuvre lors de la construction d'un imaginaire.
Pour construire cette thèse, le texte s'organise en trois parties.
Dans la première partie, qui va jusqu'à « … des couleurs et des formes. «, Bachelard commence à caractériser l'imagination en la distinguant de ce à quoi on la réduit habituellement, à savoir une simple faculté de former des images.
Ensuite, de « Le vocable fondamental… « jusqu'à « … caractérise le psychisme humain. «, Bachelard associe l'imagination à l'action de l'imaginaire plutôt qu'à la fixité des images.
Enfin, la troisième partie dresse le bilan de l'extrait, en exprimant la caractéristique décisive de la vie de l'imagination, c'est-à-dire son type de mobilité spirituelle.
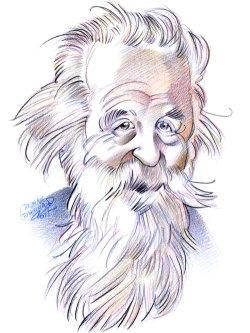
«
actuellement perçue.
Ce que Bachelard appelle « le souvenir d'une perception » entre habituellement dans le champsdes productions de l'imagination.
Hors ici Bachelard demande davantage à la définition de l'imagination : il exige« l'action imaginante ».
Si un souvenir n'est pas une perception, il n'est selon Bachelard pas non plus un produit del'imagination, mais ce « souvenir d'une perception » qui réapparaît tel qu'il avait été perçu, c'est-à-dire sans avoirété soumis au travail de l'imagination.
De même pour « l'habitude des couleurs et des formes » : toutes les imagesqui ne subissent pas l'action imaginante n'entrent pas dans le domaine de l'imagination.
Cette première partie présente en quelques sortes une définition négative de l'imagination.
Reste maintenant à préciser de quelle sorte est cette « action imaginante ».
Dans la deuxième partie, c'est alors à l' « imaginaire », et non pas à l'image, que Bachelard associe l'imagination.
« Fondamental » est différent d'« essentiel », c'est-à-dire que l'imaginaire va exprimer ce qui caractérise l'imagination, sans que toutefois l'imagination se définisse exactement par l'imaginaire.
C'est bien pourquoi Bachelarddit que « imaginaire » est le vocable qui « correspond » à l'imagination, non qui la « définit ».
Alors pourquoil'imaginaire « correspond-il » à l'imagination ?
La deuxième phrase de cette deuxième partie parle de la « valeur » d'une image.
Ce en quoi consiste cette « valeur » doit pouvoir être compris grâce à ce qui permet de mesurer cette valeur, à savoir « l'étendue de sonauréole imaginaire ».
Toutefois, cette image est difficile à interpréter.
On peut s'appuyer sur l'opposition entrel'image et l'imaginaire.
La première partie a montré que l'imagination est une action sur les images.
Ces dernières secaractérisent ainsi par une certaine fixité.
L'imaginaire a de toute évidence davantage de rapport avec la « facultéde nous libérer » dont est capable l'imagination.
Qu'est-ce alors qu'une « auréole imaginaire » ?
(soit dit en passant, il faut dans un commentaire éviter de passer outre une difficulté ou une incompréhension.
Une mauvaise explication a davantage de valeur qu'une explication laissée de côté).
Qu'est-ce qui émane ainsi de l'image ? Sans doute s'agit-il de tout ce qui va se développer à partir de l'image, tout ce qui, dans l'image, donner à penser, donne à imaginer.
Bachelard dit non seulement que l'imaginationest « ouverte, évasive », mais en outre qu'elle l'est « grâce à » l'imaginaire.
L'imaginaire apporte à l'imagination cetélan au-delà de l'image.
L'auréole imaginaire peut ainsi être mise en correspondance avec la libération dont il estquestion dans la première partie.
De même on a vu qu'il n'est question d'imagination que lorsqu'il y a undéveloppement de son action autour de l'image, que lorsque des images en appellent d'autres.
L'auréole imaginaireexprime cette faculté qu'ont certaines images d'en appeler d'autres.
Quant au fait de produire ces images nouvelles,de manière libérée, c'est cela le travail de l'imagination.
D'autre part, c'est en ce sens qu'il est questiond' « ouverture » : l'imagination trouve dans l'imaginaire le champs de son travail, lequel n'est pas fermé à l'image.
Bachelard va ensuite plus loin, dans le sens où il fait de l'imagination l'expression caractéristique de la capacité d'ouverture du « psychisme humain ».
Il utilise même le verbe « spécifier », qui montre à quel pointl'imagination est la faculté qui va faire de l'esprit humain un esprit ouvert.
Ensuite, Bachelard cite Blake.
Parce qu'il est ensuite question de poésie, on peut raisonnablement supposer qu'il s'agit du peintre et poète anglais William Blake.
Peu importe toutefois pour notre commentaire de quel Blake ils'agit.
Ce qui est décisif par contre, c'est non seulement la citation de Blake, mais plus encore le fait que Bachelardfasse de cette citation une « vérité ».
Rappelons la citation : « l'imagination n'est pas un état, c'est l'existencehumaine elle-même ».
L'imagination passe du statut de faculté de l'esprit à celui de fonction emblématique l'activitéhumaine.
Pour appuyer ce commentaire de la citation, conçue comme une « vérité », Bachelard fait appel à l'imaginaire déployé par l'intermédiaire du langage, comme dans l « imagination littéraire ».
Il le caractérise principalement par lefait qu'il « se dégage de la réalité ».
Cela « correspond » évidemment à « la faculté de se libérer » propre audétachement de l'imagination vis-à-vis de l'image.
Le « spirituel » concernant le langage s'oppose à la « réalité »comme l'imagination se démarque de l'image.
Il est ainsi jusqu'à présent question d'un trajet effectué à partir de l'image jusqu'à l'action imaginante. L'image est fixe, ou donnée, et son auréole imaginaire engage l'imagination à l'action.
Mais Bachelard se proposeensuite d'inverser ce trajet : une image peut « quitter son principe imaginaire » et se « fixer dans une formedéfinitive ».
Une image peut « quitter » son principe imaginaire, elle peut perdre son auréole, pour prendre la formefixe d'une perception.
Cette forme est qualifiée de « définitive », qui une nouvelle fois marque une opposition :l'image est « définitive » dans le sens ou elle est arrêté, fixée, et elle s'oppose alors à l'ouverture indéfinie duchamps de l'imagination.
Une difficulté se présente par contre dans le fait que Bachelard précise qu'en quittant sonprincipe imaginaire, l'image nous fera non plus rêver mais agir.
Cette nouvelle opposition ne doit pas faire confondrel'action imaginante avec l'action suscitée par l'image qui a quitté son principe imaginaire.
Ce qui montre qu'il ne s'agitpas de l'action imaginante, c'est la phrase qui suit : « l'image stable et achevée coupe les ailes de l'imagination ».
Làencore, Bachelard insiste sur l'opposition entre la fixité de l'image et l'ouverture de l'imagination.
L'utilisation duchamps lexical de l'ange (auréole, ailes) aboutit à la « chute » : lorsque l'image se fixe, elle « déchoit ».
Il faut insister encore sur le fait que le texte est construit à partir de nombreuses oppositions.
Ici c'est « l'emprisonnement » qui s'oppose à la libération.
Lorsqu'elle est fixée, l'image est en quelques sortes emprisonnée.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EAU ET LES RÊVES. ESSAI SUR L’IMAGINATION DE LA MATIERE (L’) Gaston Bachelard (résumé & analyse)
- BACHELARD : l'imagination, fonction de l'irréel
- Gaston Bachelard: l'imagination soit la faculte de former des images...
- L'imagination n'est rien d'autre que le sujet transporté dans les choses. BACHELARD. Commentez cette citation.
- Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez. BACHELARD. Commentez cette citation.