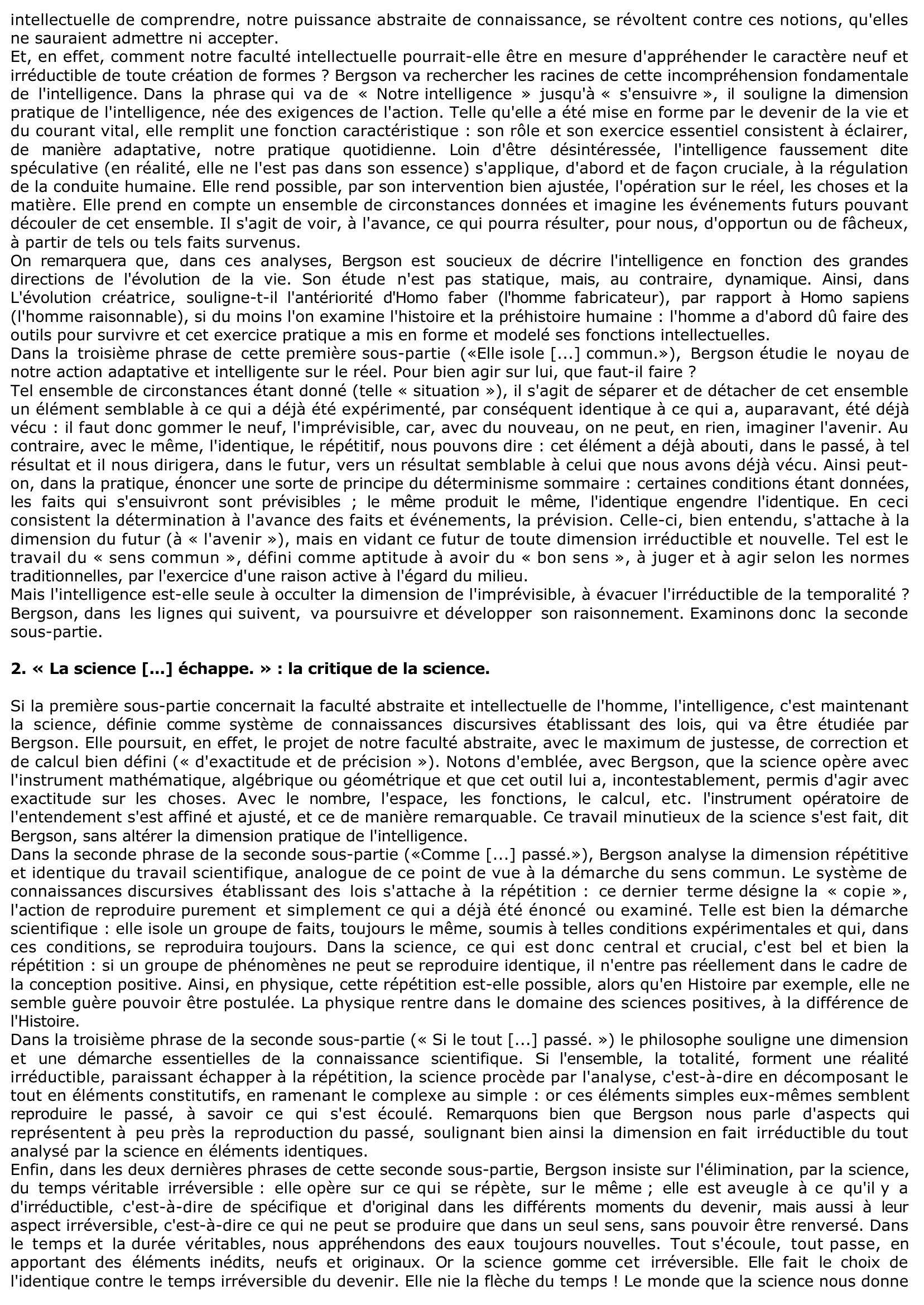BERGSON: Intelligence et Elan vital
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
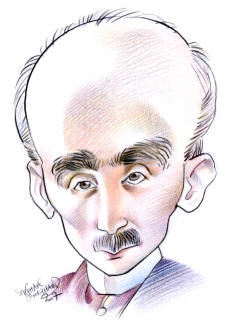
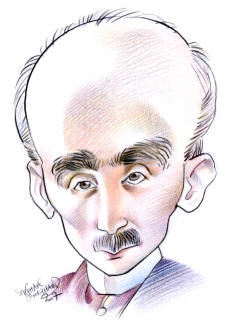
«
intellectuelle de comprendre, notre puissance abstraite de connaissance, se révoltent contre ces notions, qu'ellesne sauraient admettre ni accepter.Et, en effet, comment notre faculté intellectuelle pourrait-elle être en mesure d'appréhender le caractère neuf etirréductible de toute création de formes ? Bergson va rechercher les racines de cette incompréhension fondamentalede l'intelligence.
Dans la phrase qui va de « Notre intelligence » jusqu'à « s'ensuivre », il souligne la dimensionpratique de l'intelligence, née des exigences de l'action.
Telle qu'elle a été mise en forme par le devenir de la vie etdu courant vital, elle remplit une fonction caractéristique : son rôle et son exercice essentiel consistent à éclairer,de manière adaptative, notre pratique quotidienne.
Loin d'être désintéressée, l'intelligence faussement ditespéculative (en réalité, elle ne l'est pas dans son essence) s'applique, d'abord et de façon cruciale, à la régulationde la conduite humaine.
Elle rend possible, par son intervention bien ajustée, l'opération sur le réel, les choses et lamatière.
Elle prend en compte un ensemble de circonstances données et imagine les événements futurs pouvantdécouler de cet ensemble.
Il s'agit de voir, à l'avance, ce qui pourra résulter, pour nous, d'opportun ou de fâcheux,à partir de tels ou tels faits survenus.On remarquera que, dans ces analyses, Bergson est soucieux de décrire l'intelligence en fonction des grandesdirections de l'évolution de la vie.
Son étude n'est pas statique, mais, au contraire, dynamique.
Ainsi, dansL'évolution créatrice, souligne-t-il l'antériorité d'Homo faber (l'homme fabricateur), par rapport à Homo sapiens(l'homme raisonnable), si du moins l'on examine l'histoire et la préhistoire humaine : l'homme a d'abord dû faire desoutils pour survivre et cet exercice pratique a mis en forme et modelé ses fonctions intellectuelles.Dans la troisième phrase de cette première sous-partie («Elle isole [...] commun.»), Bergson étudie le noyau denotre action adaptative et intelligente sur le réel.
Pour bien agir sur lui, que faut-il faire ?Tel ensemble de circonstances étant donné (telle « situation »), il s'agit de séparer et de détacher de cet ensembleun élément semblable à ce qui a déjà été expérimenté, par conséquent identique à ce qui a, auparavant, été déjàvécu : il faut donc gommer le neuf, l'imprévisible, car, avec du nouveau, on ne peut, en rien, imaginer l'avenir.
Aucontraire, avec le même, l'identique, le répétitif, nous pouvons dire : cet élément a déjà abouti, dans le passé, à telrésultat et il nous dirigera, dans le futur, vers un résultat semblable à celui que nous avons déjà vécu.
Ainsi peut-on, dans la pratique, énoncer une sorte de principe du déterminisme sommaire : certaines conditions étant données,les faits qui s'ensuivront sont prévisibles ; le même produit le même, l'identique engendre l'identique.
En ceciconsistent la détermination à l'avance des faits et événements, la prévision.
Celle-ci, bien entendu, s'attache à ladimension du futur (à « l'avenir »), mais en vidant ce futur de toute dimension irréductible et nouvelle.
Tel est letravail du « sens commun », défini comme aptitude à avoir du « bon sens », à juger et à agir selon les normestraditionnelles, par l'exercice d'une raison active à l'égard du milieu.Mais l'intelligence est-elle seule à occulter la dimension de l'imprévisible, à évacuer l'irréductible de la temporalité ?Bergson, dans les lignes qui suivent, va poursuivre et développer son raisonnement.
Examinons donc la secondesous-partie.
2.
« La science [...] échappe.
» : la critique de la science.
Si la première sous-partie concernait la faculté abstraite et intellectuelle de l'homme, l'intelligence, c'est maintenantla science, définie comme système de connaissances discursives établissant des lois, qui va être étudiée parBergson.
Elle poursuit, en effet, le projet de notre faculté abstraite, avec le maximum de justesse, de correction etde calcul bien défini (« d'exactitude et de précision »).
Notons d'emblée, avec Bergson, que la science opère avecl'instrument mathématique, algébrique ou géométrique et que cet outil lui a, incontestablement, permis d'agir avecexactitude sur les choses.
Avec le nombre, l'espace, les fonctions, le calcul, etc.
l'instrument opératoire del'entendement s'est affiné et ajusté, et ce de manière remarquable.
Ce travail minutieux de la science s'est fait, ditBergson, sans altérer la dimension pratique de l'intelligence.Dans la seconde phrase de la seconde sous-partie («Comme [...] passé.»), Bergson analyse la dimension répétitiveet identique du travail scientifique, analogue de ce point de vue à la démarche du sens commun.
Le système deconnaissances discursives établissant des lois s'attache à la répétition : ce dernier terme désigne la « copie »,l'action de reproduire purement et simplement ce qui a déjà été énoncé ou examiné.
Telle est bien la démarchescientifique : elle isole un groupe de faits, toujours le même, soumis à telles conditions expérimentales et qui, dansces conditions, se reproduira toujours.
Dans la science, ce qui est donc central et crucial, c'est bel et bien larépétition : si un groupe de phénomènes ne peut se reproduire identique, il n'entre pas réellement dans le cadre dela conception positive.
Ainsi, en physique, cette répétition est-elle possible, alors qu'en Histoire par exemple, elle nesemble guère pouvoir être postulée.
La physique rentre dans le domaine des sciences positives, à la différence del'Histoire.Dans la troisième phrase de la seconde sous-partie (« Si le tout [...] passé.
») le philosophe souligne une dimensionet une démarche essentielles de la connaissance scientifique.
Si l'ensemble, la totalité, forment une réalitéirréductible, paraissant échapper à la répétition, la science procède par l'analyse, c'est-à-dire en décomposant letout en éléments constitutifs, en ramenant le complexe au simple : or ces éléments simples eux-mêmes semblentreproduire le passé, à savoir ce qui s'est écoulé.
Remarquons bien que Bergson nous parle d'aspects quireprésentent à peu près la reproduction du passé, soulignant bien ainsi la dimension en fait irréductible du toutanalysé par la science en éléments identiques.Enfin, dans les deux dernières phrases de cette seconde sous-partie, Bergson insiste sur l'élimination, par la science,du temps véritable irréversible : elle opère sur ce qui se répète, sur le même ; elle est aveugle à ce qu'il y ad'irréductible, c'est-à-dire de spécifique et d'original dans les différents moments du devenir, mais aussi à leuraspect irréversible, c'est-à-dire ce qui ne peut se produire que dans un seul sens, sans pouvoir être renversé.
Dansle temps et la durée véritables, nous appréhendons des eaux toujours nouvelles.
Tout s'écoule, tout passe, enapportant des éléments inédits, neufs et originaux.
Or la science gomme cet irréversible.
Elle fait le choix del'identique contre le temps irréversible du devenir.
Elle nie la flèche du temps ! Le monde que la science nous donne.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'Elan vital chez Bergson
- Commentaire Texte Bergson L'évolution créatrice, l'élan vital et la conscience
- BERGSON: l’observation (l’expérience) et l’intelligence (la théorie)
- Commenter cette formule de Bergson : L'Instinct achevé est une faculté d’utiliser et même de construire des Instruments organisés ; l'intelligence achevée est la faculté de fabriquer et d'employer des Instruments inorganisés. PLAN.
- BERGSON ET L'INTELLIGENCE TECHNIQUE