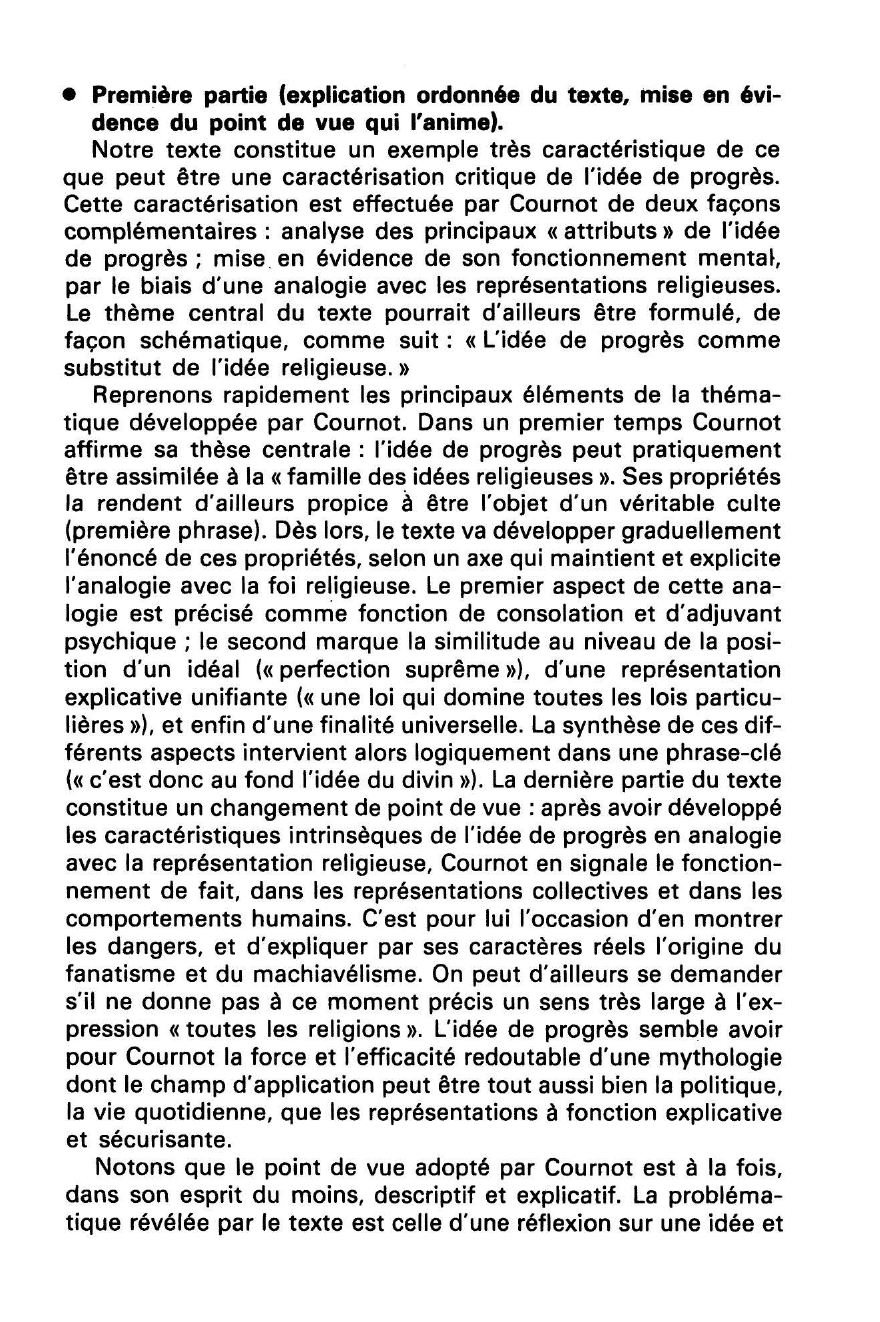Cournot et l'ordre naturel des choses
Publié le 10/10/2011

Extrait du document

Aucune idée, parmi celles qui se référent à l'ordre des faits naturels, ne tient de plus prés à la famille des idées religieuses que l'idée de progrès, et n'est plus propre à devenir le principe d'une sorte de foi religieuse pour ceux qui n'en ont plus d'autre. Elle a, comme la foi religieuse, la vertu de relever les âmes et les caractères. L'idée du progrès indéfini, c'est l'idée d'une perfection suprême, d'une loi qui domine toutes les lois particulières...
Il peut sembler pour le moins paradoxal de problématiser l'idée de progrès, dont les connotations immédiates sont habituellement positives. La tradition a cessé d'être une référence, un ciment social, comme à l'époque féodale. Cependant, le temps n'est plus où cette idée de progrès animait une grande part de la réflexion philosophique et mobilisait les enthousiasmes

«
• Première partie (explication ordonnée du texte, mise en évi dence du point de vue qui l'anime).
Notre texte constitue un exemple très caractéristique de ce
que peut être une caractérisation critique de l'idée de progrès.
Cette caractérisation est effectuée par Cournot de deux façons
complémentaires :
analyse des principaux « attributs» de l'idée de progrès ; mise.
en évidence de son fonctionnement mental, par le biais d'une analogie avec les représentations religieuses.
Le thème central du texte pourrait d'ailleurs être formulé, de
façon schématique, comme suit : « L'idée de progrès comme
substitut de
l'idée religieuse.
>> Reprenons rapidement les principaux éléments de la théma tique développée par Cournot .
Dans un premier temps Cournot
affirme sa thèse centrale : l'idée de progrès peut pratiquement
être assimilée à la «famille des idées religieuses».
Ses propriétés la rendent d'ailleurs propice à être l'objet d'un véritable culte (première phrase).
Dès lors, le texte va développer graduellement
l'énoncé
de ces propriétés, selon un axe qui maintient et explicite
l'analogie avec la foi religieuse.
Le premier aspect de cette ana
logie est précisé comrrie fonction de consolation et d'adjuvant
psychique ;
le second marque la similitude au niveau de la posi
tion d'un idéal («perfection suprême»).
d'une représentation
explicative unifiante (« une loi qui domine toutes les lois particu
lières»).
et enfin d'une finalité universelle .
La synthèse de ces dif férents aspects intervient alors logiquement dans une phrase-clé («c 'est donc au fond l'idée du divin»).
La dernière partie du texte
constitue un changement de point de vue : après avoir
développé
les caractéristiques intrinsèques de l'idée de progrès en analogie
avec la représentation religieuse, Cournot en signale le fonction
nement de fait, dans les représentations collectives et dans les
comportements humains.
C'est pour lui l'occasion d'en montrer
les dangers, et d'expliquer par ses caractères réels l'origine du
fanatisme et du machiavélisme.
On peut d'ailleurs se demander s'il ne donne pas à ce moment précis un sens très large à l'ex
pression «toutes les religions».
L'idée de progrès semble avoir
pour Cournot la force et l'efficacité redoutable d'une mythologie
dont le champ d'application peut être tout aussi bien la politique , la vie quotidienne, que les représentations à fonction explicative et sécurisante.
Notons que
le point de vue adopté par Cournot est à la fois,
dans son esprit du moins, descriptif et explicatif.
La probléma
tique révélée par le texte est celle d'une réflexion sur une idée et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La technique trouble-t-elle l'ordre des choses ?
- La technique trouble t-elle l'ordre des choses?
- « Et l'ordre des choses veut que, dès qu'un étranger puissant entre dans un pays, tous ceux qui y sont les moins puissants se rallient à lui, mus par l'envie qu'ils portent à qui les a dominés par sa puissance ».
- « L'homme, interprète et ministre de la nature, n'étend ses connaissances et son action qu'à mesure qu'il découvre l'ordre naturel des choses, soit par l'observation soit par la réflexion ; il ne sait et ne peut rien de plus. » Bacon, Novum Organum, 1620. Commentez.
- « La raison est la "faculté de saisir la raison des choses". » Cournot, Matérialisme, vitalisme, rationalisme, 1875. Commentez. ?