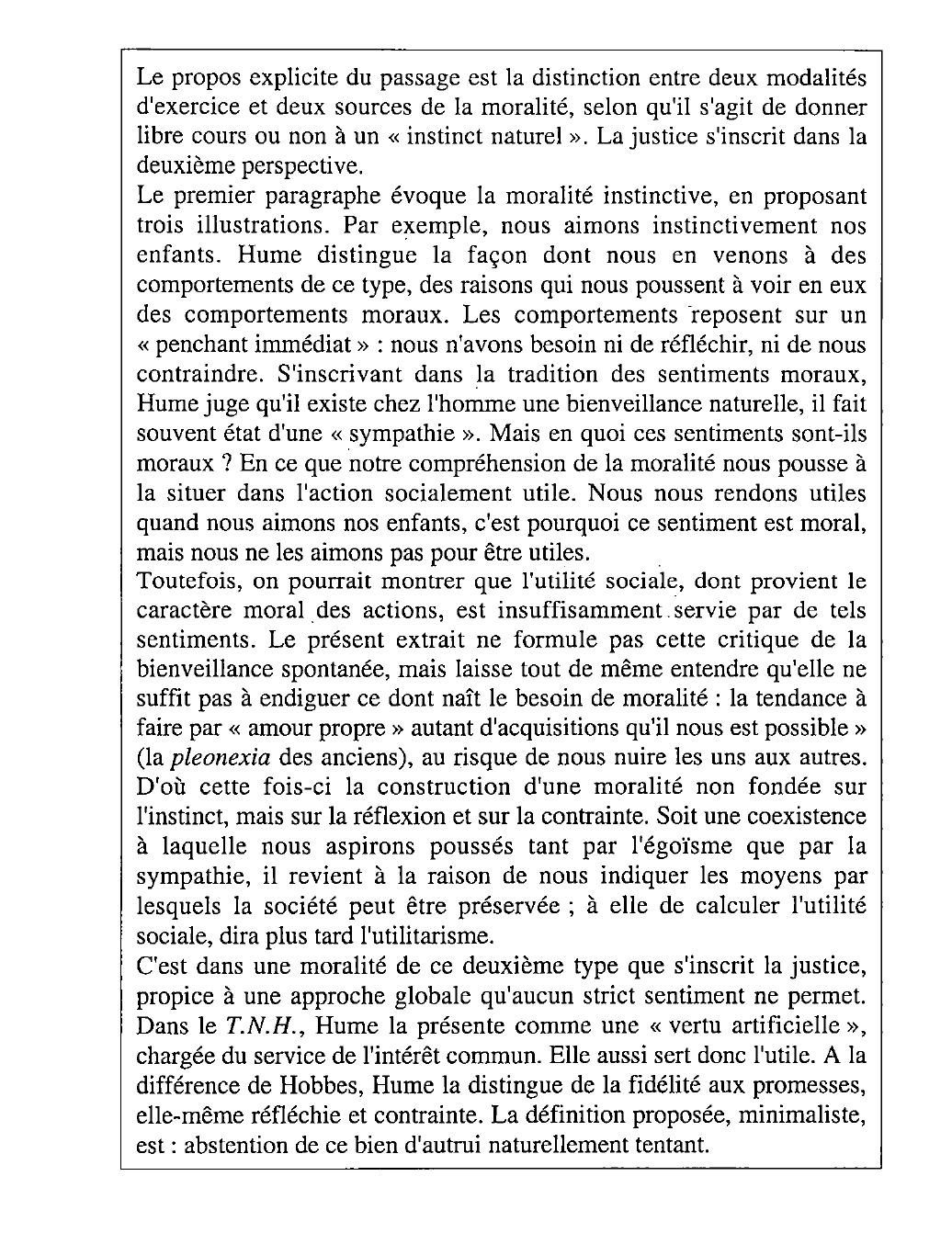David Hume, « Le contrat primitif »
Publié le 01/02/2020

Extrait du document
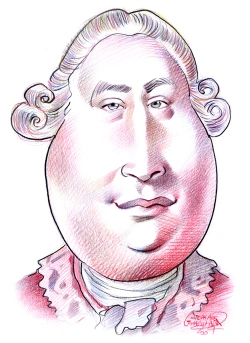
« Nos devoirs moraux sont de deux espèces. La première comprend ceux où nous sommes portés par un instinct naturel, par un penchant immédiat, qui agit en nous indépendamment de toute idée d'obligation, de toute vue relative, soit au bien public, soit au bien particulier. De cette sorte sont l'amour pour nos enfants, la reconnaissance envers nos bienfaiteurs, la compassion pour les infortunés. En réfléchissant aux avantages que la société retire de ces instincts, nous leur payons le juste tribut de l'approbation et de l'estime morale ; mais celui qui en est animé, sent leur pouvoir et leur influence antécédemment à toute réflexion.
Les devoirs renfermés sous la seconde espèce ne sont point fondés sur cet instinct originaire ; nous nous reconnaissons obligés de les pratiquer, après avoir considéré les besoins de la société humaine, et combien il est impossible qu'elle subsiste lorsque ces devoirs sont . négligés. C'est ainsi que la justice, qui consiste à s'abstenir du bien d'autrui, et la fidélité, qui consiste à tenir ses promesses, deviennent obligatoires et prennent de l'autorité sur nous. Comme chacun d'entre nous a plus d'amour propre que d'amour pour ses semblables, nous sommes tous naturellement portés à faire autant d'acquisitions qu'il nous est possible ; il n'y a que l'expérience et la réflexion qui puissent nous arrêter, en nous montrant les pernicieux effets de cette licence, et la société prête à se dissoudre, si elle n'est pas réprimée. Ici donc, le penchant naturel est réfréné par le jugement et par la réflexion ».
David Hume, « Le contrat primitif », traduction anonyme de 1752, puis 1788, reprise dans Essais politiques, © Vrin, 1972.
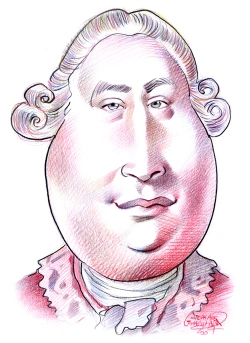
«
Textes commentés 47
Le propos explicite du passage est la distinction entre deux modalités
d'exercice et deux sources de la moralité, selon qu'il s'agit de donner
libre cours ou non à un « instinct naturel ».
La justice s'inscrit dans la
deuxième perspective.
Le premier paragraphe évoque la moralité instinctive, en proposant
trois illustrations.
Par exemple, nous aimons instinctivement nos
enfants.
Hume distingue la façon dont nous en venons à des
comportements de ce type, des raisons qui nous poussent à voir en eux
des comportements moraux.
Les comportements ·reposent sur un
« penchant immédiat» : nous n'avons besoin ni de réfléchir, ni de nous
contraindre.
S'inscrivant dans la tradition des sentiments moraux,
Hume juge qu'il existe chez l'homme une bienveillance naturelle, il fait
souvent état d'une «sympathie ».
Mais en quoi ces sentiments sont-ils
moraux ? En ce que notre compréhension de la moralité nous pousse à
la situer dans l'action socialement utile.
Nous nous rendons utiles
quand nous aimons nos enfants, c'est pourquoi ce sentiment est moral,
mais nous ne les aimons pas pour être utiles.
Toutefois, on pourrait montrer que l'utilité sociale, dont provient le
caractère moral _des actions, est insuffisamment.
servie par de tels
sentiments.
Le présent extrait ne formule pas cette critique de la
bienveillance spontanée, mais laisse tout de même entendre qu'elle ne
suffit pas à endiguer ce dont naît Je besoin de moralité : la tendance à
faire par « amour propre » autant d'acquisitions qu'il nous est possible »
(la pleonexia des anciens), au risque de nous nuire les uns aux autres.
D'où cette fois-ci la construction d'une moralité non fondée sur
l'instinct, mais sur la réflexion et sur la contrainte.
Soit une coexistence
à laquelle nous aspirons poussés tant par l'égoïsme que par la
sympathie, il revient à la raison de nous indiquer les moyens par
lesquels la société peut être préservée ; à elle de calculer l'utilité
sociale, dira plus tard l'utilitarisme.
C'est dans une moralité de ce deuxième type que s'inscrit la justice,
propice à une approche globale qu'aucun strict sentiment ne permet.
Dans le T.N.H., Hume la présente comme une «vertu artificielle»,
chargée du service de l'intérêt commun.
Elle aussi sert donc l'utile.
A la
différence de Hobbes, Hume la distingue de la fidélité aux promesses,
elle-même réfléchie et contrainte.
La définition proposée, minimaliste,
est : abstention de ce bien d'autrui naturellement tentant..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- David Hume, Traité de la nature humaine, II, 3e partie, section III. « Une passion est une existence primitive, ou, si vous le voulez, un mode primitif d'existence »
- David Hume: « Du contrat originel » - Essais moraux, politiques et littéraires; et autres essais
- David Hume - Sur la diversité des goûts - méthode de l'explication de texte
- DISSERTATION SUR LES PASSIONS, David Hume
- DIALOGUES SUR LA RELIGION NATURELLE, David Hume - résumé de l'œuvre