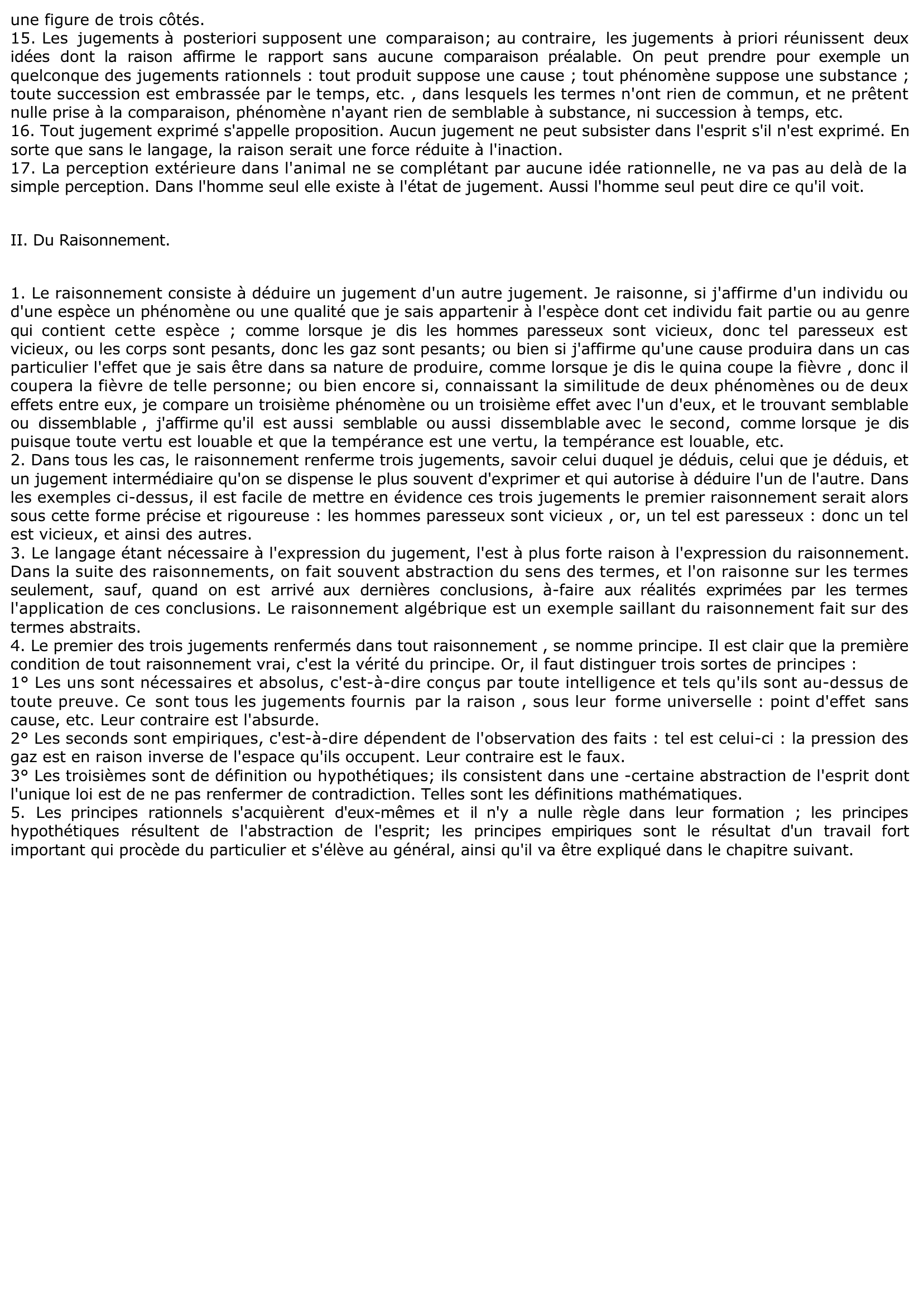Du Jugement.
Publié le 16/06/2011

Extrait du document
1. L'expérience et la raison sont les deux points de vue de la faculté de connaître; le moi et le non-moi, le dedans et le dehors, sont les deux champs que parcourt l'expérience et qui, par conséquent, fournissent à la raison les occasions dé ses développements. Mais comme, dans l'unité de notre intelligence, l'expérience ne se développe à aucun degré sans que la raison n'entre aussitôt en exercice, et que réciproquement la raison attend l'expérience pour produire les idées qui lui sont propres, il s'ensuit qu'aucune idée contingente n'apparaît dans notre esprit sans être unie étroitement à une idée nécessaire. A peine l'idée d'un phénomène est-elle formée, l'idée de la substance s'y unit soudainement et -étroitement ; de même pour l'idée de changement et l'idée de la cause et pour toutes les autres. 2. Ainsi notre intelligence ne débute pas par des idées isolées qu'elle rapproche ensuite par la comparaison. Elle débute par des affirmations, et dans ces affirmations, qui sont les faits primitifs de l'intelligence, il y a toujours et nécessairement deux idées, l'une contingente et l'autre nécessaire.
«
une figure de trois côtés.15.
Les jugements à posteriori supposent une comparaison; au contraire, les jugements à priori réunissent deuxidées dont la raison affirme le rapport sans aucune comparaison préalable.
On peut prendre pour exemple unquelconque des jugements rationnels : tout produit suppose une cause ; tout phénomène suppose une substance ;toute succession est embrassée par le temps, etc.
, dans lesquels les termes n'ont rien de commun, et ne prêtentnulle prise à la comparaison, phénomène n'ayant rien de semblable à substance, ni succession à temps, etc.16.
Tout jugement exprimé s'appelle proposition.
Aucun jugement ne peut subsister dans l'esprit s'il n'est exprimé.
Ensorte que sans le langage, la raison serait une force réduite à l'inaction.17.
La perception extérieure dans l'animal ne se complétant par aucune idée rationnelle, ne va pas au delà de lasimple perception.
Dans l'homme seul elle existe à l'état de jugement.
Aussi l'homme seul peut dire ce qu'il voit.
II.
Du Raisonnement.
1.
Le raisonnement consiste à déduire un jugement d'un autre jugement.
Je raisonne, si j'affirme d'un individu oud'une espèce un phénomène ou une qualité que je sais appartenir à l'espèce dont cet individu fait partie ou au genrequi contient cette espèce ; comme lorsque je dis les hommes paresseux sont vicieux, donc tel paresseux estvicieux, ou les corps sont pesants, donc les gaz sont pesants; ou bien si j'affirme qu'une cause produira dans un casparticulier l'effet que je sais être dans sa nature de produire, comme lorsque je dis le quina coupe la fièvre , donc ilcoupera la fièvre de telle personne; ou bien encore si, connaissant la similitude de deux phénomènes ou de deuxeffets entre eux, je compare un troisième phénomène ou un troisième effet avec l'un d'eux, et le trouvant semblableou dissemblable , j'affirme qu'il est aussi semblable ou aussi dissemblable avec le second, comme lorsque je dispuisque toute vertu est louable et que la tempérance est une vertu, la tempérance est louable, etc.2.
Dans tous les cas, le raisonnement renferme trois jugements, savoir celui duquel je déduis, celui que je déduis, etun jugement intermédiaire qu'on se dispense le plus souvent d'exprimer et qui autorise à déduire l'un de l'autre.
Dansles exemples ci-dessus, il est facile de mettre en évidence ces trois jugements le premier raisonnement serait alorssous cette forme précise et rigoureuse : les hommes paresseux sont vicieux , or, un tel est paresseux : donc un telest vicieux, et ainsi des autres.3.
Le langage étant nécessaire à l'expression du jugement, l'est à plus forte raison à l'expression du raisonnement.Dans la suite des raisonnements, on fait souvent abstraction du sens des termes, et l'on raisonne sur les termesseulement, sauf, quand on est arrivé aux dernières conclusions, à-faire aux réalités exprimées par les termesl'application de ces conclusions.
Le raisonnement algébrique est un exemple saillant du raisonnement fait sur destermes abstraits.4.
Le premier des trois jugements renfermés dans tout raisonnement , se nomme principe.
Il est clair que la premièrecondition de tout raisonnement vrai, c'est la vérité du principe.
Or, il faut distinguer trois sortes de principes :1° Les uns sont nécessaires et absolus, c'est-à-dire conçus par toute intelligence et tels qu'ils sont au-dessus detoute preuve.
Ce sont tous les jugements fournis par la raison , sous leur forme universelle : point d'effet sanscause, etc.
Leur contraire est l'absurde.2° Les seconds sont empiriques, c'est-à-dire dépendent de l'observation des faits : tel est celui-ci : la pression desgaz est en raison inverse de l'espace qu'ils occupent.
Leur contraire est le faux.3° Les troisièmes sont de définition ou hypothétiques; ils consistent dans une -certaine abstraction de l'esprit dontl'unique loi est de ne pas renfermer de contradiction.
Telles sont les définitions mathématiques.5.
Les principes rationnels s'acquièrent d'eux-mêmes et il n'y a nulle règle dans leur formation ; les principeshypothétiques résultent de l'abstraction de l'esprit; les principes empiriques sont le résultat d'un travail fortimportant qui procède du particulier et s'élève au général, ainsi qu'il va être expliqué dans le chapitre suivant..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le jugement de Salomon
- VISION DU JUGEMENT (Une)
- Fiche de lecture : POUR EN FINIR AVEC LE JUGEMENT DE DIEU d'Antonin Artaud
- CRITIQUE DE LA FACULTÉ DE JUGER ou CRITIQUE DU JUGEMENT, Emmanuel Kant
- mosaïque de la cathédrale Santa Maria Assunta (Jugement dernier)