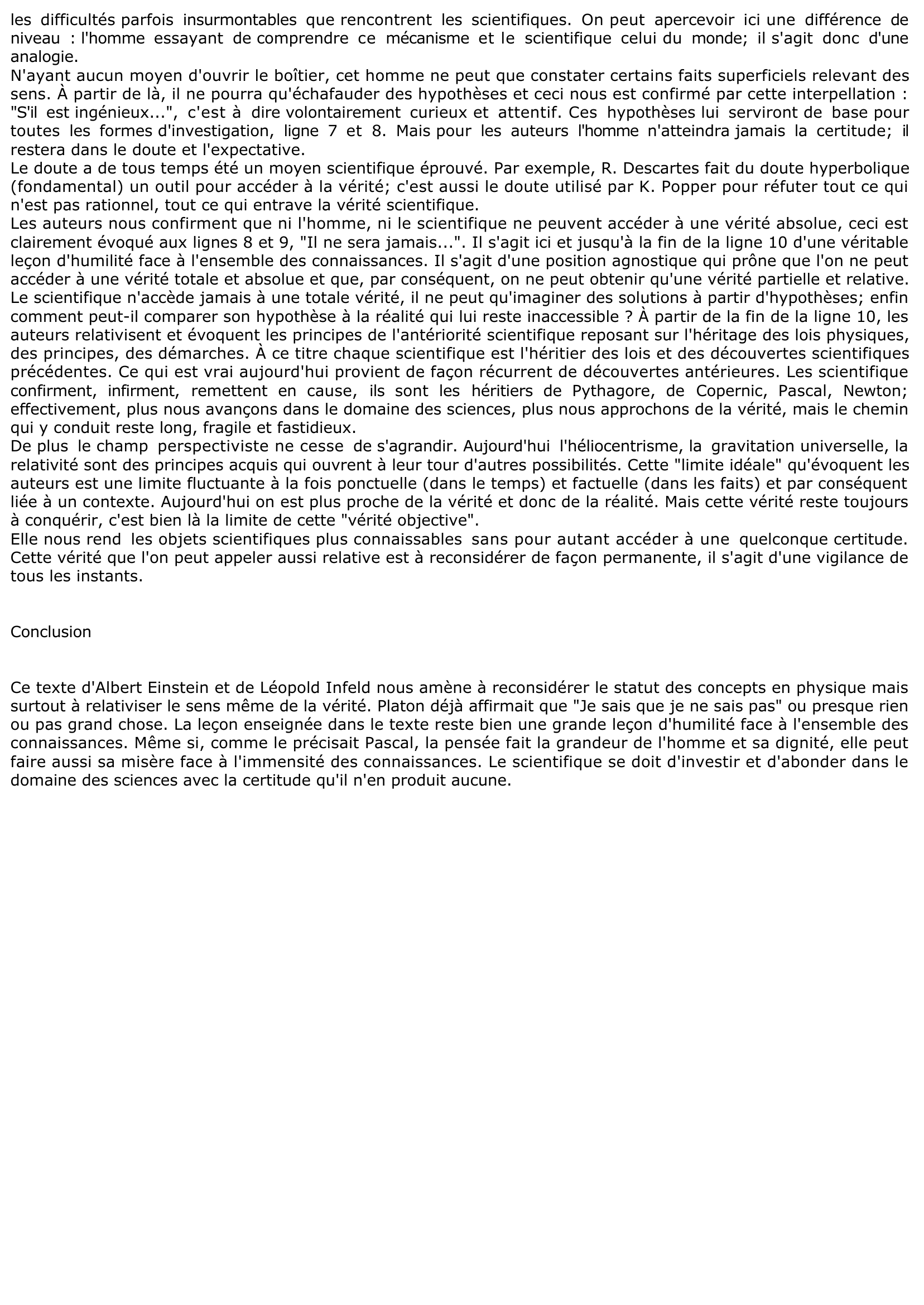Einstein et Infeld: Les concepts physiques
Publié le 17/04/2009

Extrait du document
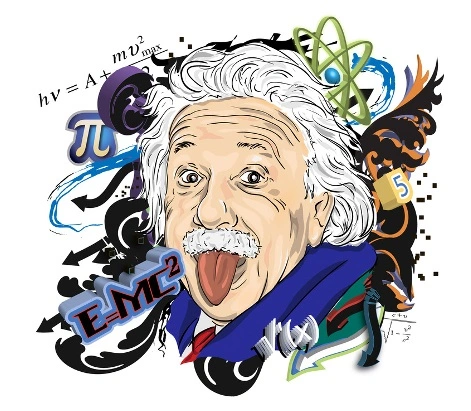
Les auteur nous avertissent et nous affirment que les concepts physiques qui sont des moyens, des outils pour appréhender le réel et le maîtriser proviennent de l'intellect humain; ils sont échafaudés, construits et entretenus par l'homme; ils sont le résultat d'une interprétation. Cependant, ils ne sont pas exclusivement la représentation du réel; ici, le mot "uniquement" évoque bien l'aspect relatif et non absolu de la concordance entre le théorique et le réel, c'est-à-dire que le "monde extérieur" est retranscrit par l'homme, mais pas seulement. Cette première phrase possède un double aspect. De plus, les auteur emploient l'expression "déterminés par le monde extérieur". Un déterminisme scientifique est à l'origine d'une loi physique; il affirme qu'il est possible de formuler un lien entre une cause et un effet. Mais il s'agit, contrairement au principe de causalité qui stipule que les mêmes causes ne produisent pas toujours les même effets, de faire de cette relation une véritable nécessité effective. Exemple : la loi de la gravitation universelle.
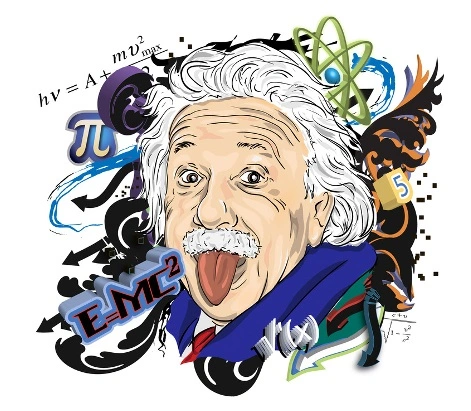
«
les difficultés parfois insurmontables que rencontrent les scientifiques.
On peut apercevoir ici une différence deniveau : l'homme essayant de comprendre ce mécanisme et le scientifique celui du monde; il s'agit donc d'uneanalogie.N'ayant aucun moyen d'ouvrir le boîtier, cet homme ne peut que constater certains faits superficiels relevant dessens.
À partir de là, il ne pourra qu'échafauder des hypothèses et ceci nous est confirmé par cette interpellation :"S'il est ingénieux...", c'est à dire volontairement curieux et attentif.
Ces hypothèses lui serviront de base pourtoutes les formes d'investigation, ligne 7 et 8.
Mais pour les auteurs l'homme n'atteindra jamais la certitude; ilrestera dans le doute et l'expectative.Le doute a de tous temps été un moyen scientifique éprouvé.
Par exemple, R.
Descartes fait du doute hyperbolique(fondamental) un outil pour accéder à la vérité; c'est aussi le doute utilisé par K.
Popper pour réfuter tout ce quin'est pas rationnel, tout ce qui entrave la vérité scientifique.Les auteurs nous confirment que ni l'homme, ni le scientifique ne peuvent accéder à une vérité absolue, ceci estclairement évoqué aux lignes 8 et 9, "Il ne sera jamais...".
Il s'agit ici et jusqu'à la fin de la ligne 10 d'une véritableleçon d'humilité face à l'ensemble des connaissances.
Il s'agit d'une position agnostique qui prône que l'on ne peutaccéder à une vérité totale et absolue et que, par conséquent, on ne peut obtenir qu'une vérité partielle et relative.Le scientifique n'accède jamais à une totale vérité, il ne peut qu'imaginer des solutions à partir d'hypothèses; enfincomment peut-il comparer son hypothèse à la réalité qui lui reste inaccessible ? À partir de la fin de la ligne 10, lesauteurs relativisent et évoquent les principes de l'antériorité scientifique reposant sur l'héritage des lois physiques,des principes, des démarches.
À ce titre chaque scientifique est l'héritier des lois et des découvertes scientifiquesprécédentes.
Ce qui est vrai aujourd'hui provient de façon récurrent de découvertes antérieures.
Les scientifiqueconfirment, infirment, remettent en cause, ils sont les héritiers de Pythagore, de Copernic, Pascal, Newton;effectivement, plus nous avançons dans le domaine des sciences, plus nous approchons de la vérité, mais le cheminqui y conduit reste long, fragile et fastidieux.De plus le champ perspectiviste ne cesse de s'agrandir.
Aujourd'hui l'héliocentrisme, la gravitation universelle, larelativité sont des principes acquis qui ouvrent à leur tour d'autres possibilités.
Cette "limite idéale" qu'évoquent lesauteurs est une limite fluctuante à la fois ponctuelle (dans le temps) et factuelle (dans les faits) et par conséquentliée à un contexte.
Aujourd'hui on est plus proche de la vérité et donc de la réalité.
Mais cette vérité reste toujoursà conquérir, c'est bien là la limite de cette "vérité objective".Elle nous rend les objets scientifiques plus connaissables sans pour autant accéder à une quelconque certitude.Cette vérité que l'on peut appeler aussi relative est à reconsidérer de façon permanente, il s'agit d'une vigilance detous les instants.
Conclusion
Ce texte d'Albert Einstein et de Léopold Infeld nous amène à reconsidérer le statut des concepts en physique maissurtout à relativiser le sens même de la vérité.
Platon déjà affirmait que "Je sais que je ne sais pas" ou presque rienou pas grand chose.
La leçon enseignée dans le texte reste bien une grande leçon d'humilité face à l'ensemble desconnaissances.
Même si, comme le précisait Pascal, la pensée fait la grandeur de l'homme et sa dignité, elle peutfaire aussi sa misère face à l'immensité des connaissances.
Le scientifique se doit d'investir et d'abonder dans ledomaine des sciences avec la certitude qu'il n'en produit aucune..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Sans la croyance qu'il est possible de saisir la réalité avec nos constructions théoriques, sans la croyance en l'harmonie interne de notre monde, il ne pourrait pas y avoir de science. > A. Einstein et L. Infeld, L'Évolution des idées en physique. Commentez cette citation.
- Histoire du cinéma – Liste des concepts
- Le rêve d'Einstein
- Jacques Derrida (Vie, œuvre, Apports, Concepts, Commentaires).
- Jean Piaget (Vie, œuvre, Apports, Concepts, Commentaires).