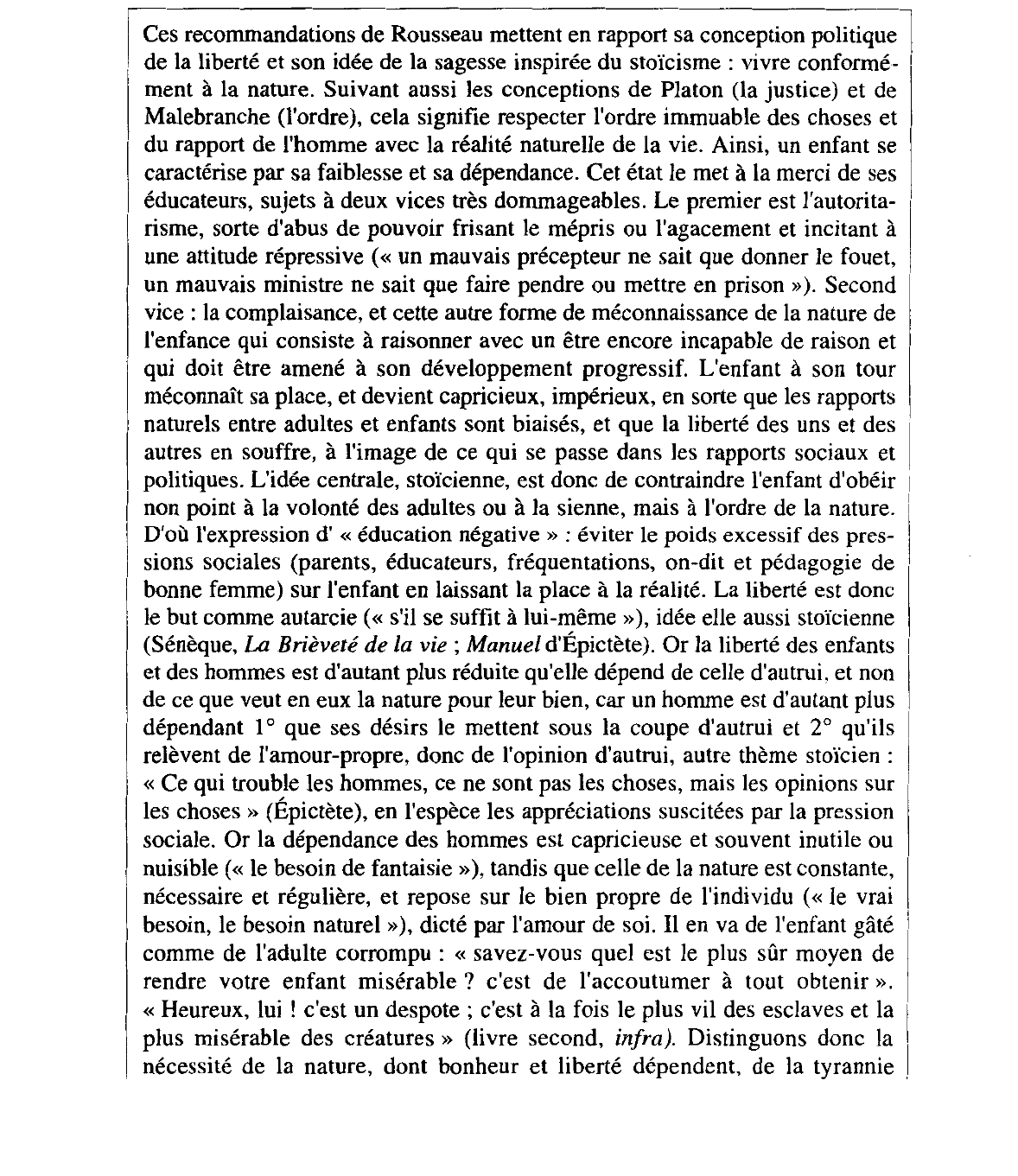Émile, ou de l'éducation, livre second (1762). Commentaire
Publié le 24/03/2015

Extrait du document
«
Textes commentés 55
Ces recommandations de Rousseau mettent en rapport sa conception politique
de la liberté et son idée de la sagesse inspirée du stoïcisme : vivre conformé
ment à la nature.
Suivant aussi les conceptions de
Platon (la justice) et de
Malebranche (l'ordre), cela signifie respecter l'ordre immuable des choses et
du rapport de l'homme avec la réalité naturelle de la vie.
Ainsi, un enfant se
caractérise par
sa faiblesse
et sa dépendance.
Cet état le met à la merci de ses
éducateurs, sujets à deux vices très dommageables.
Le premier est l'autorita
risme, sorte d'abus de pouvoir frisant le mépris ou l'agacement et incitant à
une attitude répressive (
« un mauvais précepteur ne sait que donner le fouet,
un mauvais ministre ne sait que faire pendre ou mettre en prison
» ).
Second
vice : la complaisance, et cette autre forme de méconnaissance de la nature de
l'enfance qui consiste
à raisonner avec un être encore incapable de raison et
qui doit être amené à son développement progressif.
L'enfant à son tour
méconnaît sa place, et devient capricieux, impérieux, en sorte que les rapports
naturels entre adultes et enfants sont biaisés, et que la liberté des uns et des
autres en souffre, à l'image de ce qui se passe dans les rapports sociaux et
politiques.
L'idée centrale, stoïcienne, est donc de contraindre l'enfant d'obéir
non point
à la volonté des adultes ou à la sienne, mais à l'ordre de la nature.
D'où l'expression d'
« éducation négative » : éviter le poids excessif des pres
sions sociales (parents, éducateurs, fréquentations, on-dit et pédagogie de
bonne femme) sur l'enfant en laissant la place
à la réalité.
La liberté est donc
le but comme autarcie ( « s'il se suffit à lui-même»), idée elle aussi stoïcienne
(Sénèque,
La Brièveté de la vie; Manuel d'Épictète).
Or la liberté des enfants
et des hommes est d'autant plus réduite qu'elle dépend de celle d'autrui, et
non
de ce que veut en eux la nature pour leur bien, car un homme est d'autant plus
dépendant
1° que ses désirs le mettent sous la coupe d'autrui et 2° qu'ils
relèvent de l'amour-propre, donc de l'opinion d'autrui, autre thème stoïcien :
« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions sur
les
choses» (Épictète), en l'espèce les appréciations suscitées par la pression
sociale.
Or la dépendance des hommes est capricieuse et souvent inutile ou
nuisible (
« le besoin de fantaisie » ), tandis que celle de la nature est constante,
nécessaire et régulière, et repose sur le bien propre de l'individu (
« le vrai
besoin, le besoin naturel
» ), dicté par l'amour de soi.
Il en va de l'enfant gâté
comme de l'adulte corrompu :
« savez-vous quel est le plus sûr moyen de
rendre votre enfant misérable
? c'est de l'accoutumer à tout obtenir ».
« Heureux, lui ! c'est un despote ; c'est à la fois le plus vil des esclaves et la
plus misérable des créatures
» (livre second, infra).
Distinguons donc la
nécessité de la nature, dont bonheur et liberté dépendent, de la tyrannie.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Rousseau " Conscience, conscience, conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. " (Rousseau, Émile ou De l'éducation, 1762, livre IV, GF-Flammarion, 1966, p. 378). Commentez cette citation.
- ÉMILE ou De l’éducation, 1762. Jean-Jacques Rousseau
- Rousseau, L'Émile ou de l'éducation, L. II, Pléiade, p. 311. Commentaire.
- Jean-Jacques Rousseau, Emile ou l'éducation (1792) - Commentaire Livre IV
- David HUME, Traité de la nature humaine, section V de la partie II du second livre (commentaire)